Visionnaire de l'invisible
Le Cinéma
Une prise de conscience sur la condition humaine et la condition animale
CORPS ET ÂME
Film hongrois de Ildiko ENYEDI – 2017
 Maria (Alexandra Borbeli), responsable du contrôle de qualité, un peu asociale, vient d’arriver dans un abattoir de bovins, dont Endre (Géza Morcsanyi) est le directeur financier. L’une et l’autre, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d’une biche et d’un cerf qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre apparence… Vainqueur de la plus prestigieuse récompense de la Berlinade 2017, l’Ours d’Or, Corps et Âme trouve son point de départ dans un poème hongrois d’Agnès Nemes Nagy. Le film a été tourné dans un véritable abattoir, une expérience inédite qui s’est transformée en prise de conscience immédiate de la réalisatrice sur l’éthique, le rapport à la consommation et, plus globalement, sur la condition humaine et sur la condition animale …
Maria (Alexandra Borbeli), responsable du contrôle de qualité, un peu asociale, vient d’arriver dans un abattoir de bovins, dont Endre (Géza Morcsanyi) est le directeur financier. L’une et l’autre, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d’une biche et d’un cerf qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre apparence… Vainqueur de la plus prestigieuse récompense de la Berlinade 2017, l’Ours d’Or, Corps et Âme trouve son point de départ dans un poème hongrois d’Agnès Nemes Nagy. Le film a été tourné dans un véritable abattoir, une expérience inédite qui s’est transformée en prise de conscience immédiate de la réalisatrice sur l’éthique, le rapport à la consommation et, plus globalement, sur la condition humaine et sur la condition animale …
Dans la fiche qui accompagne le film, Ildiko Enyedi livre au journaliste de l’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et Essai) la façon dont elle a conçue son œuvre :
‘’Après avoir lu ce poème d’Agnès Nemes Nagy, j’ai eu l’idée du film d’un seul coup : que se passerait-il si on rencontrait un jour quelqu’un qui fait exactement le même rêve que soi ? Comment réagirait-on ? Serait-on ravi ? Terrorisé ? Trouverait-on ça drôle ? Ou y verrait-on une atteinte à sa vie privée ?... Les situations qui s’enclenchent comme des engrenages sont celles qui conviennent le mieux au cinéma ; ce sont des situations qui suscitent des questions auxquelles on a vraiment envie de répondre, puis qui soulèvent de nouvelles questions…
… Nous avons tourné dans un abattoir pendant une semaine. Toute notre équipe a été émue par le respect instinctif et la tendresse dont ces salariés font preuve à l’égard des bêtes, par la manière dont ils touchent ces animaux et dont ils parlent avec eux. Le bétail passe une journée dans l’abattoir avant de mourir. Le plus émouvant n’était pas la mise à mort, mais ces animaux, bien vivants, assis en silence, attendant d’être tués. J’y ai vu une sorte d’alliance entre tueur et victime, entre animaux et humains, en rapport avec les connaissances des cultures tribales : ils chassaient l’animal, le tuaient puis le remerciaient pour sa viande qui contribuait à leur survie. Alexandra, exubérante et dynamique, a dû faire un énorme travail d’introspection pour créer Maria de l’intérieur : c’était extraordinaire de la voir entrer dans la peau du personnage. Dès l’instant où elle a fait émerger la Maria qui était en elle, elle ne pouvait plus faire d’erreur : elle fait une évolution émotionnelle et sensuelle, elle sort de sa coquille et se jette dans l’inconnu.
Je suis profondément et intimement attachée à ce film : je suis Maria, ou plutôt j’ai été Maria autrefois. Pour moi, faire du cinéma est une magnifique occasion de faire connaître la vie sociale. Sur un plateau où les gens travaillent de concert, de manière totalement solidaire, on voit bien qu’ils oublient les questions d’argent et leurs problèmes domestiques, pour se concentrer à fond sur un unique objectif : toucher l’âme de spectateurs inconnus partout dans le monde. Pour moi, la vie entremêle rêve et réalité. Chaque jour, on constate que son quotidien est un mélange des deux. Mais on parle de l’un et pas de l’autre…’’
Solitaires, prisonniers de leurs handicaps (l’un souffre d’une paralysie du bras gauche, l’autre d’une forme d’autisme troublante), Endre et Maria semblent condamnés à rester simples spectateurs de leurs vies, comme l’étranger de Camus. C’est en tout cas ce que suggère la réalisation d’Ildiko Enyedi, aux partis pris esthétiques tenus et assumés, jouant sur de nombreux cadrages et sur une très faible profondeur de champ pour signifier l’isolement et la détresse silencieuse des deux héros qui, chaque nuit, se retrouvent en rêve mais peinent à se retrouver ensuite dans la réalité.
Endre et Maria se parlent, se regardent, tombent amoureux l’un de l’autre en silence, mais ne se touchent pas, n’échangent même pas une poignée de main professionnelle. Et pourtant, leurs mains sont plus expressives que leurs bouches. Toutes leurs émotions, tous leurs sentiments, passent par leurs mains. Deux séquences, sobres et belles, montrent Maria, seule chez elle le soir, rejouant les brèves conversations qu’elle a eue dans la journée avec Endre, d’abord avec une salière et une poivrière, puis avec des jouets Playmobil. Sa voix parle en hors-champ tandis que seules ses mains se meuvent dans le cadre. Endre peine à se faire un sandwich avec sa main valide mais parvient à porter deux tasses de café pour passer un moment agréable avec Maria, jusqu’à l’inviter dans son restaurant préféré. L’appel du toucher, de la caresse, se fait de plus en plus sentir au fur et à mesure que progresse l’intrigue. Le sens de l’ouïe joue aussi un grand rôle : Maria s’offre pour la première fois un téléphone portable, pour garder contact avec Endre, découvre la musique, apprend à être plus féminine, s’ouvre peu à peu au monde, portée par les sentiments pudiques mais bien réels d’un homme qui l’aime au-delà de sa différence. Et de son côté, Endre réapprend à aimer, porté par cette femme surprenante qui le tire hors de la banalité de son quotidien. Comme le cerf et la biche dans les forêts enneigées.
Un beau plaidoyer cinématographique, autant pour le droit à l’amour que pour le droit à la différence. Corps et âme enchante par sa gravité et son ironie légère, sa suggestion délicate d’une solidarité entre le monde animal et les êtres humains, sa célébration du rêve et de la magie comme moyen d’échapper à un quotidien sans âme.
Le milieu professionnel où évoluent Endre et Maria n’est pas anodin. Lieu de mort, où sont tués les animaux domestiques voués à la consommation, ils se métamorphosent en bêtes sauvages dans un paysage immaculé de neige qui s’oppose à l’environnement rouge sang de l’abattoir. Endre sort d’une séparation douloureuse, Maria est une femme enfant réfractaire au contact physique. Le rêve va les mettre progressivement sur la voie d’une libération mutuelle de leur complexe. Comme si une instance supérieure y travaillait. Ildiko Enyedi ne fait pas une théorie psychanalytique, préférant privilégier le mystère, révélant la magie du monde.
On tombe sous le charme de ces deux êtres en recherche d’amour, dans un film sensible et touchant aux acteurs vibrants de vérité.
Décembre 2017 Jn.-C. Faivre d’Arcier
Un très beau film sur la souffrance des marginaux.
AU REVOIR LA-HAUT
Film français d’Albert DUPONTEL – 2017
 Albert Maillard et Edouard Péricourt, deux vétérans de la Grande Guerre, se retrouvent désemparés après l’Armistice. C’est le chômage et la misère pour l’un, le traumatisme et la douleur des gueules cassées pour l’autre. Albert (A.Dupontel), le prolo intrépide, et Edouard (Nahuel Perez Biscayart), l’aristo défiguré, sont liés à jamais car le second a perdu son visage en sauvant le premier. Ensemble, ils décident d’arnaquer les patriotes d’opérette en prétendant vendre des monuments aux morts, dessinés par Edouard. Celui-ci tente de dépasser son infirmité par des prothèses de sa fabrication. De son côté, leur ex-capitaine Pradelle (Laurent Lafitte) cherche à se faire de l’argent, avec l’aval de l’Etat, sur le commerce de cercueils vides, censés contenir les dépouilles de soldats disparus, qui sont rendus à leurs familles…
Albert Maillard et Edouard Péricourt, deux vétérans de la Grande Guerre, se retrouvent désemparés après l’Armistice. C’est le chômage et la misère pour l’un, le traumatisme et la douleur des gueules cassées pour l’autre. Albert (A.Dupontel), le prolo intrépide, et Edouard (Nahuel Perez Biscayart), l’aristo défiguré, sont liés à jamais car le second a perdu son visage en sauvant le premier. Ensemble, ils décident d’arnaquer les patriotes d’opérette en prétendant vendre des monuments aux morts, dessinés par Edouard. Celui-ci tente de dépasser son infirmité par des prothèses de sa fabrication. De son côté, leur ex-capitaine Pradelle (Laurent Lafitte) cherche à se faire de l’argent, avec l’aval de l’Etat, sur le commerce de cercueils vides, censés contenir les dépouilles de soldats disparus, qui sont rendus à leurs familles…
Au revoir là-haut est le 6e long-métrage réalisé par Albert Dupontel. Adapté du roman du même nom de Pierre Lemaire, Prix Goncourt 2013, le récit impose une reconstitution historique particulièrement détaillée. Pour cela, le cinéaste s’est imprégné de nombreux romans et films d’époque. Il se félicite du travail de son créateur d’effets visuels : ‘’La qualité du travail est telle que parfois je n’arrivais plus à distinguer le vrai du faux’’. Devant la caméra, on retrouve notamment Dupontel lui-même, l’excellent Laurent Lafitte et Nahuel Pérez Biscayart, la révélation du très beau film de Robin Campillo ‘’120 battements par minute’’
Albert Dupontel s’est jeté avec passion sur cette histoire pleine de rebondissements. En ce jour de novembre 1918, la fin de la guerre n’est plus très loin. Le lieutenant Pradelle, sur la ligne de front, vient d’en recevoir la confirmation. Le massacre va enfin s’arrêter. Mais l’officier veut terminer en beauté, avec panache. Aussi commande-t-il de lancer à l’attaque une dernière vague de misérables poilus qu’il envoie au casse-pipe, en toute conscience, usant même d’un procédé ignoble, passible de la cour martiale. Mais il y a un témoin de son exaction : Albert Maillard, pauvre bougre en vareuse crottée, l’un des survivants de cette boucherie, acharné à sauver son camarade d’infortune, Edouard Péricourt, dont le visage vient d’être arraché sous ses yeux. Avec son visage défiguré, luttant contre l’effroi que lui renvoie son miroir, Edouard, jeune artiste déjà rejeté avant-guerre par son père, est condamné à une solitude de reclus.
À leur retour à la vie civile, Albert décide de s’occuper de son camarade mutilé. Simple comptable, il cherche du travail dans son pays qui se soucie moins des rescapés que des disparus, et qui les repousse au profit des planqués. Constatant le culte patriotique qu’on voue aux martyrs de la guerre, l’idée vient aux deux amis, de monter une escroquerie aux faux monuments aux morts. Suite à diverses péripéties, Albert retrouve Pradelle, escroc cynique, sur le point d’épouser la fille de Marcel Péricourt, industriel et banquier, père d’Edouard, qui l’a rejeté à cause de son autoritarisme méprisant.
De son côté, Edouard, dissimulé sous une fausse identité pour fuir sa famille et porté disparu, n’a pas perdu l’habileté de ses mains ni son intelligence. Il fabrique une série de masques, très expressifs et sophistiqués, pour traduire sa pensée qu’il ne peut plus exprimer par la parole. C’est l’occasion pour Albert Dupontel de se lancer dans cette histoire, pleine de surprises. Dès la scène de l’attaque sur le front, il filme avec un grand réalisme les tranchées et les bombardements, avec des effets esthétiques étonnants, puis le retour à la vie civile dans le Paris des faubourgs miséreux, contrastant avec les beaux salons de la capitale. Il peint une société qui veut tourner la page de la guerre et qui est rongée par l’égoïsme, l’opportunisme et les arrangements, sans oublier une touche d’émotion.
Albert Dupontel livre ici un pamphlet anticapitaliste qui pourrait tout aussi bien avoir lieu de nos jours. L’effervescence d’après-guerre est le théâtre d’un mélodrame poignant et magistralement reconstitué. Son adaptation du best-seller de Pierre Lemaitre vient prouver que l’ancien humoriste est capable de réaliser autre chose que les comédies d’humour noir qui ont fait son succès. Basé sur une reconstitution des années 1918-1920, son film reprend un de ses sujets de prédilection sur la souffrance des marginaux. En effet, les deux personnages principaux, qui sont deux vétérans esquintés par la Grande Guerre, se montrent inaptes à reprendre le cours de leur ancienne vie au sein de la société civile.
La première qualité de sa réalisation est assurément le soin apporté à la direction artistique pour recréer cette période historique effervescente. Qu’il s’agisse des uniformes portés par les poilus dans les tranchées ou des tenues élégantes de la bourgeoisie parisienne, chaque costume est une grande réussite. Il en est de même pour les décors. Albert Dupontel est resté relativement fidèle au roman de Lemaitre, en effaçant les aspects les plus rocambolesques pour se concentrer sur le drame humain vécu par les deux personnages principaux, interprétés par Nahuel Perez Biscayart et lui-même. Le premier est la révélation du récent film 120 battements par minute qui devrait lui permettre de s’assurer une carrière florissante. Dupontel, en revanche, livre une prestation moins éblouissante car il assure un rôle assez proche de ce qu’on a l’habitude de le voir jouer, celui d’un être fragile qui va devoir se faire violence pour exister. Une des forces du scénario d’Albert Dupontel est le soin apporté aux personnages secondaires et l’excellent casting rassemblé pour cette occasion. Il aide à placer Au revoir là-haut parmi les meilleurs films français de la décennie. Parmi les acteurs qui permettent un tel rayonnement, Laurent Lafitte dans un rôle maléfique, est l’incarnation d’une classe dirigeante animée par le goût de l’argent et le besoin d’humilier les faibles. Niels Arestrup est brillant dans la façon qu’il a de faire de son personnage, lui aussi détestable, le père le plus poignant de cette histoire. De leur côté, Emilie Dequenne est parfaite dans le rôle de Madeleine Péricourt et Mélanie Thierry est charmante dans le rôle de Pauline, la servante des Péricourt.
Albert Dupontel dépeint ici un univers éminemment personnel et composite. C’est une richesse qui ne s’arrête pas à la stricte, et virtuose mise en scène, mais que l’on retrouve dans une langue qui sait retenir le meilleur du texte de Pierre Lemaître, avec un ton hâbleur issu du théâtre de boulevard. Alors que le réalisateur se frotte pour la première fois au difficile exercice de la reconstitution historique, il a trouvé ici un terrain de jeu à la hauteur de sa foisonnante créativité.
On ne peut qu’être comblé par toute cette palette de sentiments et d’émotions que nous réserve le spectacle de ce cinéaste décidément très doué, C’est un véritable festival qui sait savamment nous emmener du drame profond à une légèreté bienfaisante, et dont rien que la scène finale, qui est d’une intensité et d’une tension à couper le souffle, vaut à elle seule le coup d’être découverte. A voir sans hésitation…
Décembre 2017 Jn.-C. Faivre d’Arcier
Viva parle tout autant d’un amour filial
entre un père et son fils qu’il n’a pas vraiment connu.
VIVA
Film de Paddy Breathnach – 2015
 A la Havane, Jésus vit seul dans l’appartement de son père avec sa grand-mère. Le jeune homme se débrouille tant bien que mal entre ses amis et elle. Il est coiffeur de métier et s’occupe des perruques portées par les artistes du cabaret tenu par Mama. Dans son établissement nocturne, celui-ci propose des spectacles de travestis que Jésus admire en secret. Il souhaite lui aussi se produire sur scène et passe alors une audition. Quand son père réapparaît après de longues années d’incarcération, il ne l’entend pas de cette oreille. Jésus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel.
A la Havane, Jésus vit seul dans l’appartement de son père avec sa grand-mère. Le jeune homme se débrouille tant bien que mal entre ses amis et elle. Il est coiffeur de métier et s’occupe des perruques portées par les artistes du cabaret tenu par Mama. Dans son établissement nocturne, celui-ci propose des spectacles de travestis que Jésus admire en secret. Il souhaite lui aussi se produire sur scène et passe alors une audition. Quand son père réapparaît après de longues années d’incarcération, il ne l’entend pas de cette oreille. Jésus lui désobéit et finit par monter sur scène, non sans avoir été entraîné à la dure par Mama, son père spirituel.
Le réalisateur Paddy Breathnach se retrouve là où on ne l’attend pas… Après une comédie dans le milieu de la coiffure et un film d’horreur à base de champignons hallucinogènes, il revient avec une chronique cubaine douce et tendre sur un jeune gay qui se rêve chanteur de cabaret à La Havane. Produit par Benicio del Toro, ce joli film est un coup de cœur qui surprend par la densité de son propos sous des allures de film à destination du public gay. A y regarder de plus près Viva parle tout autant d’un amour filial entre un père qui sort de prison et son fils qu’il n’a pas vraiment connu. Le cabaret gay sert juste d’écrin à cette histoire touchante qui nous prend aux tripes. Et quel écrin ! Les scènes de chant dans ce cabaret miteux sont simples et réussies, portées par acteurs travestis ; loin de tous les clichés, ils chantent en play-back un répertoire savoureux. Leurs échanges sont drôles et le jeune Jorge Perrugoria est une vraie révélation, incarnant un jeune gay éloigné des sempiternelles caricatures propres à ce type de productions.
Drapant son film de scènes sublimes, le metteur en scène s’éloigne du tout-venant de la production indépendante grâce à de très beaux plans comme celui de ce vieux travesti répétant avec conviction son passage sur scène sur l’air de l’Ave Maria, majestueux et empli de grâce. Une réalisation soignée qui met en valeur la capitale cubaine qu’on a peu vue au cinéma. Et Viva nous faire découvrir La Havane interlope, celle qui est loin des lieux touristiques. Une ville colorée, vivante et filmée avec amour. On n’est pas face à un chef-d’œuvre mais devant un film qui vous charme par petites touches. Une relation entre un père et son fils qui apprennent à s’apprivoiser peu à peu ; elle grandit comme l’émotion qui nous étreint de plus en plus, au fur et à mesure qu’ils apprennent à se connaître et à s’aimer.
Viva, c’est d’abord l’apprentissage de la vie d’un jeune homme, presque sans famille, dont le maigre revenu repose sur des coiffures sur perruques, dans un cabaret de ‘’Drag Queens’’, situé dans un quartier populaire de La Havane. C’est aussi un aperçu sur la prostitution à laquelle est confronté cet adolescent, courageux et jamais mièvre. Comme individu autonome, à qui l’on peut faire confiance, il doit faire preuve de force et de détermination.
C’est particulièrement vrai quand son père, alcoolique et bourru violent, refait surface, après l’avoir abandonné à l’âge de 3 ans. Dès lors, Jésus doit mettre fin à ses exhibitions dans le cabaret où, aux yeux de son père ancien boxeur, les hommes abandonnent leur virilité. Pourtant ce fils, frêle, grand, dégingandé et gracieusement efféminé, semble y trouver sa voie, en suivant celle des divas locales.
Dans sa jeunesse, pleine de rêve et de paillettes dans une vie de marasme, où l’on évoque souvent d’autres lieux magnifiques comme Miami ou Barcelone, Jésus, lui, voyage à travers les chants d’amour espagnols qu’il interprète avec puissance. Ces chants lui permettent de se révéler lui-même à travers ses capacités artistiques.
Dans une société malade et vieillissante, où tout se monnaie, ce jeune homme progresse, comme miraculeusement préservé par son art, figure compatissante, loin du jugement de l’autre, mais plein d’un bon sens salvateur. Mais cette attitude ouverte n’ôte rien au combat que doit mener le jeune comédien (Hector Medina), au charisme fou, aussi bien en homme qu’en femme. Sa composition subtile et charismatique fait, à mon sens, l’intérêt principal de cette oeuvre, aussi chatoyante qu’exaltée dans sa réalisation.
Une belle découverte que ce joli film dont on se rappelle la simplicité et la ferveur avec laquelle il s’empare du sujet qu’il dépeint. On est émus et on se souviendra de Viva.
Décembre 2017 Jn.-C. Faivre d’Arcier
Ce drame satirique est ne réflexion générale sur les évolutions sociétales
THE SQUARE
Film franco-suédois de Rüben Östlund – 2017
 En Suède, Christian est un père divorcé, pétri de valeurs humanistes, qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée ‘’The Square’’, autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leur prochain. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, en pleine rue, sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle…
En Suède, Christian est un père divorcé, pétri de valeurs humanistes, qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée ‘’The Square’’, autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leur prochain. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, en pleine rue, sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle…
Drame satirique, réflexion générale sur les évolutions sociétales, The Square a reçu la palme d’Or du jury présidé par Pedro Almodovar, lors du dernier Festival de Cannes. La question du rôle des médias y tient également une place importante : ‘’Les médias influencent notre perception du monde et nous poussent à mal le comprendre’’, explique le réalisateur. ‘’L’image vidéo est le moyen d’expression le plus efficace que nous ayons jamais eu et, par conséquent, le plus dangereux…’’ Rüben Östlund a choisi le monde artistique pour illustrer son propos et bousculer le public en l’interrogeant sur son rapport aux médias.
De la projection à Cannes, les médias auront surtout retenu une séquence, très vite surnommée ‘’le passage du singe’’, qui a choqué plus d’un spectateur et agité bien des débats sur la Croisette. Évidemment cette séquence, qui montre un comédien jouant magnifiquement un singe en rut, ne laisse personne indifférent. Elle choque, non pas tant à cause de la violence de la scène qui se place au milieu du film, qu’à cause du fait qu’elle trouble la représentation qu’on commençait à se faire du film. Jusque-là, le ton était plutôt léger et très drôle, traitant avec un humour fin mais piquant, et beaucoup d’intelligence, des nouvelles mondanités des milieux culturels publics et subventionnés d’une grande ville européenne. Un humour de clins d’œil en direction d’un milieu que Ruben Östlund connaît bien, celui de l’art contemporain. À certains moments, on a même l’impression d’être dans une farce, une comédie loufoque qui fait semblant d’être sérieuse.
Östlund étudie la notion de partage dans une époque de repli sur soi, où les discours pétris de bonnes intentions sonnent creux et où les principes du vivre ensemble sont remis en question. ‘’Il y a un lien entre The Square et la société suédoise actuelle qui est secouée par la crise migratoire. L’arrivée massive d’immigrés chez nous et l’apparition de mendiants dans les rues est un phénomène assez nouveau, qui pose des questions : est-ce à l’Etat de s’occuper d’eux ou aux citoyens ? Faut-il donner ou non aux SDF ? Cette évolution m’a fait comprendre que quelque chose a changé en Suède et que l’idée du collectif a quasiment disparu en quelques années’’. The Square est un véritable signal d’alarme sur la difficulté actuelle de l’humanité à se connecter aux autres. ‘’The Square, le carré de l’exposition, est un sanctuaire où règnent confiance et altruisme. Dedans, nous sommes tous égaux en droits et en devoirs". Rien que ça ! Le pari de cette nouvelle installation d’art contemporain, au cœur du Musée X-Royal, à Stockholm, est pour le moins ambitieux : à l’intérieur d’un carré tracé au sol, d’à peu près 4 m2, doit régner cet état d’esprit de main tendue à l’autre et de confiance réciproque. Dès les premières minutes, Ruben Östlund donne le ton. Une interview totalement absurde sur l'art contemporain entre Christian, directeur de musée, (Claes Bang) et une journaliste américaine (Elisabeth Moss) ouvre The Square. Avec une mise en scène d'une virtuosité sans égale, le film se moque allègrement de l'art. Des expositions loufoques (des petits tas de gravats, des chaises empilées très bruyantes...) à l'impressionnant dîner avec l'homme-chimpanzé (Terry Notary, littéralement possédé par son rôle) il nous offre des séquences tordantes, grinçantes, choquantes, inattendues mais lourde de sens
Comme dans son film Snow Therapy (2014), Ruben Östlund met une nouvelle fois la confiance (perdue) des sociétés nordiques au centre du récit grâce à un personnage principal, superbement écrit et interprété par l'impérial Claes Bang. Le cinéaste se joue de ce directeur qui déplore une bourgeoisie hypocrite, regrette une société aux valeurs dissonantes – pleurant sur la situation des migrants mais sans chercher à les aider, en manque de confiance vis-à-vis des autres, égoïste et incapable de croire en qui que ce soit.
Ruben Östlund avait fait sensation il y a trois ans avec Snow Therapy, un drame mettant en scène une famille prisonnière d’un chalet après une avalanche, qui avait décroché le Prix du Jury au Festival de Cannes dans la sélection ‘’Un Certain Regard’’. Aujourd’hui, le réalisateur suédois de 43 ans n’en revient pas d’avoir remporté la Palme d'Or pour The Square, une satire jubilatoire doublée d'une fable humaniste. Cette chronique à l’humour tantôt grinçant tantôt absurde, dépeint avec un réalisme saisissant le monde fascinant de l’art contemporain, des installations énigmatiques aux énoncés abscons, aux performances qui provoquent le malaise voire dégénèrent carrément, en passant par les pique-assiette de vernissage, le tout rythmé par un Ave Maria entêtant. L’intrigue décline les préoccupations actuelles : les migrants, l’emprise des réseaux sociaux, la volonté de ‘’faire le buzz’’ à tout prix dans les médias, les stratégies de communication agressives pour attiser le scandale, le cynisme généralisé, les limites de la liberté d’expression et l’autocensure, le terrorisme… Révélation d’un talent à suivre, l'acteur principal ultra-charismatique Claes Bang.
Film remarquable par sa construction, son originalité et le goût amer qu'il laisse au spectateur. Le réalisateur, Östlund, débusque l'ambigüité de la bien-pensance, et montre comment des idées généreuses confrontées à la réalité peuvent produire un désastre moral. On sort très remué par les scènes finales. Mais certaines scènes remarquables font surgir des émotions inattendues chez le spectateur, comme celles qui mettent en scène des gens de la rue et surtout l'enfant immigré qui jouent un grand rôle symbolique dans le film.
Contrairement à ce que disent certains, à mon avis, ce film méritait sa Palme d'Or.
Décembre 2017 Jn.-C. Faivre d’Arcier
Comment obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?...
LA BELLE ET LA MEUTE
Film franco-tunisien de Kaouther BEN HANIA – 2017
 Mariam Chaouch (remarquable Mariam Al Ferjani), 21 ans, étudiante tunisienne loge dans un foyer de jeunes filles à Tunis, se rend à une fête organisée par son université dans un hôtel. Au cours de la soirée, des hommes, arborant un badge de la police, la violent. Youssef, qui était aussi à la soirée, la soutient et la persuade de se rendre dans une clinique privée. Mais, sur place, ils se heurtent à la machine administrative : la clinique a besoin des papiers d’identité de la jeune femme, qui sont restés dans la voiture des violeurs. A l’hôpital public, le médecin légiste refuse de délivrer un certificat avant qu’une enquête de police ne soit ouverte. Plus la nuit avance, plus les deux jeunes gens se heurtent à un mur d’incompréhension et d’hostilité pour les empêcher de porter plainte. Comment obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?...
Mariam Chaouch (remarquable Mariam Al Ferjani), 21 ans, étudiante tunisienne loge dans un foyer de jeunes filles à Tunis, se rend à une fête organisée par son université dans un hôtel. Au cours de la soirée, des hommes, arborant un badge de la police, la violent. Youssef, qui était aussi à la soirée, la soutient et la persuade de se rendre dans une clinique privée. Mais, sur place, ils se heurtent à la machine administrative : la clinique a besoin des papiers d’identité de la jeune femme, qui sont restés dans la voiture des violeurs. A l’hôpital public, le médecin légiste refuse de délivrer un certificat avant qu’une enquête de police ne soit ouverte. Plus la nuit avance, plus les deux jeunes gens se heurtent à un mur d’incompréhension et d’hostilité pour les empêcher de porter plainte. Comment obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?...
Considérant la fiction comme un genre très difficile, Kaouther Ben Hania a commencé au cinéma par le documentaire. Son film précédent Le Challat de Tunis (2005), évoquait déjà la question du machisme en Tunisie et la banalisation des attaques sexuelles envers les femmes. Librement adapté du livre Coupable d’avoir été violée, de Mériem Ben Mohamed, La belle et la meute va encore plus loin en dénonçant le mépris et la corruption policière face au viol. Le film a été présenté au dernier Festival de Cannes dans la section ‘’Un Certain Regard’’.
Interrogée par le journaliste du Groupement National des Cinémas de Recherche, la cinéaste tunisienne explique la démarche de son film :‘’Cette histoire est à la fois cruelle du point de vue de Mariam et paradoxalement anodine du point de vue des hôpitaux et de la police. Il s’agit de leur lot quotidien. Des victimes comme Mariam, il y en a tous les soirs. Le décalage entre ces deux attitudes, la tragédie personnelle et la froideur des institutions, donne le ton du film. Les personnages secondaires justifient les raisons de leurs comportements horribles par toutes les contraintes de leurs fonctions, qu’il s’agisse du fonctionnement de l’administration, de la solidarité policière ou du débordement des urgences à l’hôpital. Une logique de fonctionnement dans laquelle chacun pourrait se retrouver, qu’il s’agisse de petites lâchetés ou d’actes plus répréhensibles. On peut facilement perdre son humanité en multipliant les compromis. La tension du film est construite sur un compte à rebours qui n’aboutit pas à un écroulement de Mariam, mais au contraire à sa construction. Si elle ne perd pas pied, c’est parce qu’elle est entourée de personnages forts qui ne s’attendent pas à sa réaction. Je voulais construire un personnage de jeune femme normale, avec ses peurs, ses petites mensonges, son côté ‘’oie blanche’’. Elle finit par se révéler à elle-même parce qu’elle est confrontée à une situation exceptionnelle. Elle manifeste alors un instinct de survie dont elle ignorait l’existence. Au départ, elle est perdue mais Youssef se montre un soutien pour elle, même si on la pousse à douter de lui. On ignore s’il s’intéresse vraiment à elle ou si son comportement est la simple manifestation du militant qu’il incarne. Quand il n’est plus à ses côtés, Mariam se retrouve toute seule face à la ‘’meute’’ et elle est contrainte de s’en sortir seule. Elle fait alors basculer l’ordre, celui que tout le monde connaît et accepte.
Mariam souhaite seulement obtenir justice et réparation de ce qu’elle a subi, en réclamant un procès-verbal authentique. Elle devient militante à partir du moment où elle s’aperçoit que cela est impossible. En face d’elle, la ‘’meute’’ devient violente, non pas à cause de ce que Mariam représente, mais parce qu’elle ose porter plainte. Les policiers vont utiliser tout ce dont ils disposent pour la rabaisser, en puisant dans un imaginaire de mépris pour tout ce qui est provincial.
Mariam lutte aussi contre la banalisation du mal lorsque ses interlocuteurs traitent le viol comme une chose ordinaire, avec indifférence. Dans les universités, les victimes féminines ne parviennent pas souvent à obtenir justice car les administrations, placées dans un système compétitif, ne veulent pas voir leur réputation salie ; aussi, elles poussent les victimes à se taire. La belle et la meute est plus un film sur le diktat des institutions que sur la question du viol lui-même.
En utilisant la fiction, je souhaitais pouvoir parler du courage de nombreuses femmes qui luttent pour le respect de leurs droits. Derrière le courage de Mariam pour témoigner devant la justice, je voulais parler de toutes celles dont on n’entend pas la voix …’’
Le récit découpé en neuf épisodes comme autant de fragments du réel, filmés en plan-séquence, nous plonge sans garde-fou dans une réalité effrayante et démonte avec lucidité les rouages d’un système perverti, où les lois censées protéger les citoyens sont détournées en toute immoralité.
S’il reste cruel et âpre, ce film n’en demeure pas moins un bel espoir pour la jeune république tunisienne, car il est bien évident qu’il n’aurait pu exister avant 2011. Bien qu’il ne fasse pas un portrait tendre des garants de l’ordre dans le pays, il a été soutenu par les autorités culturelles, symbole d’un réel changement de mentalité dans un pays encore en proie à un régime autoritaire il y a peu de temps.
Comment obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?...
Après 12 ans d’absence, comment parler de sa mort prochaine à sa famille ?
JUSTE LA FIN DU MONDE
Film franco-canadien de Xavier DOLAN – 2016
 L’histoire est très simple : un fils, Louis, joué par Gaspard Ulliel, qui après 12 ans d’absence revient dans sa ville natale pour voir sa famille et l’informer de sa mort prochaine. Louis est écrivain et homosexuel. Son retour va évidemment faire resurgir avec violence d’anciens traumatismes, et des secrets bien sûr…
L’histoire est très simple : un fils, Louis, joué par Gaspard Ulliel, qui après 12 ans d’absence revient dans sa ville natale pour voir sa famille et l’informer de sa mort prochaine. Louis est écrivain et homosexuel. Son retour va évidemment faire resurgir avec violence d’anciens traumatismes, et des secrets bien sûr…
Juste la fin du monde de Xavier Dolan a reçu le Grand prix au Festival de Cannes avec un casting 100% français : Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, et Marion Cotillard. Le film est l’adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce qui est mort en 1995 du sida à 38 ans. Créée en 1999, cette pièce est entrée en 2007 au répertoire de la Comédie française. Le texte vient de reparaître aux éditions ‘’Les Solitaires intempestifs’’.
‘’Il arrive qu’on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu’ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s’éloigne. Volontairement. Douze ans. Et, tout à coup, l’idée d’un déjeuner. Rattraper le temps perdu, prévenir du temps qui reste. Douze ans, c’est long. Et rien depuis’’… Dans cette éclatante bande-annonce, Xavier Dolan résume l’argument de son nouveau film, très librement adapté de la pièce, qu’il améliore en y injectant son style débridé, sa palette hyper colorée, son imaginaire romantique.
Louis (Gaspard Ulliel) retrouve sa mère (Nathalie Baye) et sa famille après douze ans d’absence. Louis, 34 ans, dramaturge reconnu, a décidé de revenir sur ses pas, de faire le voyage pour annoncer à sa famille qu’il va bientôt mourir. Et qu’il ne reviendra pas. Il a choisi un dimanche et le rituel traditionnel qui réunit autour de Martine, sa mère hystérique et fardée, sa sœur Suzanne, tatouée et camée, qu’il n’a pas vue grandir, son frère aîné, Antoine, rude, brutal, grossier, et Catherine, sa belle-sœur qu’il n’a jamais rencontrée. Louis découvre un nid de névroses où les insultes et les affrontements tissent un lien d’affection très particulier.
Il a peur. Peur de ce qu’il veut leur dire. Peur d’eux, de ce qu’ils sont, de ce qu’ils sont devenus. Ils l’attendent avec une certaine nervosité. Mots hésitants, gestes empruntés, flottements, discussions mal engagées et déjà des craquements, bientôt des fissures inquiétantes vont se produire, qui annoncent des béances infranchissables. Enfermé dans son univers étroit, chacun ressasse ses insatisfactions, le regret de se contenter de peu, dans une ambiance électrique dont Antoine alimente la force par ses interventions provocatrices, dévastatrices. Son langage dynamite tous les rapports. Antoine manipule, terrorise, humilie pour mieux se plaindre d’être incompris.
Tenaillé par une mélancolie tenace qu’il ne peut exprimer, contraint d’assister à ce spectacle désolant qui l’enferme dans sa solitude, Louis ne trouve d’appui que dans les maladresses de Catherine, mouette égarée, maltraitée, apeurée elle aussi. Observateur silencieux et sidéré de ce huis clos terrifiant, Louis cherche à se protéger de ces assauts répétés. Il avait rendez-vous avec son passé et c’est ce présent insupportable qui lui saute à la figure : ‘’Pourquoi t’es là… ?’’, lui demandent-ils. Et lui, au milieu des cris, des larmes, se demande ce qu’il va pouvoir dire, et quelle sera leur réaction.
Par une série de gros plans, Xavier Dolan scrute les regards perdus, les élans suspendus, les frustrations accumulées, le temps compressé. Il filme au plus près sourires furtifs ou songeurs, non-dits explosifs ou navrés. Son film brûlant dégage une chaleur insoutenable. Virtuose de l’excès, il porte ce drame existentiel, cocktail de violence verbale et d’incommunicabilité, à un niveau d’incandescence volcanique. Avec son style, décrit trop souvent et à tort comme du maniérisme, Xavier Dolan, enfant de son siècle, affirme une liberté enthousiasmante et des audaces impressionnantes. Son cinéma pousse la tension psychologique à l’extrême, joue sur d’excitants effets de montage, se concentre, par des jeux de lumières éclatantes et contrastées, sur l’expression des visages, ces paysages de l’intime.
Il bénéficie de l’expérience de son directeur photographique, l’excellent André Turpin, cinéaste lui aussi. La musique lancinante, envoûtante, de Gabriel Yared enveloppe la polyphonie de cette famille qui se déchire, faute de savoir s’aimer. Le chœur des acteurs est exceptionnel et sa composition grandiose.
Un film passionnant sur la naissance du mouvement communiste
LE JEUNE KARL MARX
Film franco-germano-belge de Raoul PECK – 2016
 En Allemagne en 1844, une opposition intellectuelle fortement réprimée est en pleine ébullition. En France, les ouvriers du Faubourg Saint-Antoine, levain de toutes les révolutions, se sont remis en marche. En Angleterre aussi, le peuple est dans la rue, mais là il ne s’agit plus seulement de renverser les rois : à Manchester, la révolution est industrielle. A 26 ans, le jeune journaliste et philosophe Karl Marx entraîne sa femme, Jenny, sur les routes de l’exil. En 1844, à Paris, ils rencontrent le jeune Friedrich Engels, fils d’un propriétaire d’usines, qui a enquêté sur la naissance sordide du prolétariat anglais. Les deux hommes deviennent vite amis. Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident que “les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le but est de le changer". Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent.
En Allemagne en 1844, une opposition intellectuelle fortement réprimée est en pleine ébullition. En France, les ouvriers du Faubourg Saint-Antoine, levain de toutes les révolutions, se sont remis en marche. En Angleterre aussi, le peuple est dans la rue, mais là il ne s’agit plus seulement de renverser les rois : à Manchester, la révolution est industrielle. A 26 ans, le jeune journaliste et philosophe Karl Marx entraîne sa femme, Jenny, sur les routes de l’exil. En 1844, à Paris, ils rencontrent le jeune Friedrich Engels, fils d’un propriétaire d’usines, qui a enquêté sur la naissance sordide du prolétariat anglais. Les deux hommes deviennent vite amis. Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident que “les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors que le but est de le changer". Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la “bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent.
Le réalisateur haïtien Raoul Peck signe un film passionnant sur la naissance du mouvement communiste, présenté au public lors du 67e Festival de Berlin. Réalisateur du documentaire très récompensé I am not Your Negro (2016), Raoul Peck se lance dans cette biographie tout en se détachant volontairement des conventions du genre. ‘’Si je fais un biopic classique, je reproduis ce qu’Hollywood sait très bien faire et qui consiste à maintenir le spectateur dans sa bulle d’un monde maîtrisé…’’. Il choisit donc de montrer les aspects moins connus de la vie du jeune philosophe, dans l’intention d’étudier les étapes qui l’ont conduit à la figure politico-historique qu’il est devenu aujourd’hui.
A peine quatre mois après la sortie de son dernier film, Raoul Peck revient sur la voie de la fiction pour se pencher sur le plus influent de ses prédécesseurs dans le domaine de la théorisation de la lutte sociale. Comme le titre l’indique sobrement, Le Jeune Karl Marx se concentre sur une époque de la vie du philosophe allemand, antérieure à celle des images traditionnelles où il apparaît derrière son épaisse barbe blanche, tel qu’on le voit dans les livres d’histoire. Il ne s’agit ni de son enfance, ni de ses études de droit, mais de la période comprise entre 1842 et 1848, où il avait entre 25 et 30 ans. L’intérêt de cette partie de sa vie, c’est le moment où il a dépassé le statut de théoricien utopiste pour approcher ceux d’économiste matérialiste et de leader politique. Telle qu’elle est racontée dans le film, cette bascule se fait grâce à la rencontre d’un autre auteur engagé de son âge, l’anglais Friedrich Engels. L’approche choisie par Peck est justement de démontrer que c’est, de la complémentarité entre les deux hommes, mais aussi avec leurs femmes respectives, qu’a pu émerger le modèle de pensée qui est, encore aujourd’hui, la base de toutes les grandes révolutions sociales. L’intérêt d’un tel postulat est de tordre le cou à cette notion de culte de la personnalité qui justement gangrène les combats collectifs au nom du communisme.
R. Peck donne une grande place aux dialogues didactiques entre ces deux idéologues. Les nombreuses conversations, prononcées dans trois langues différentes, autour des grandes théories économiques de la Révolution industrielle, risquent d’en rebuter plus d’un. Pour qui ne s’intéresse pas un minimum à l’Histoire européenne, les noms de Pierre-Joseph Proudhon et de Wilhelm Weitling ne diront rien, et leurs réflexions politiques moins encore. Et pourtant, le spectateur qui fera l’effort de les écouter attentivement, et de les mettre en parallèle avec la condition précaire des ouvriers de l’époque, pourra aisément faire des ponts avec la situation actuelle et conclure à l’extrême modernité des écrits de Marx. On peut notamment citer sa réplique désenchantée « Aujourd’hui, celui qui n’a rien n’est rien », qui semble faire écho à un discours prononcé par Emmanuel Macron 170 ans plus tard.
Fort heureusement, Raoul Peck et son scénariste Pascal Bonitzer (avec qui il a déjà élaboré la biographie de Patrice Lumumba), n’ont pas limité leur film à une série de discussions harassantes. Le cœur reste l’épopée politique de Marx et Engels et la façon dont, en quatre ans à peine, ils sont parvenus à acquérir une influence idéologique dans toute l’Europe. En cela, la construction du Jeune Karl Marx s’approche des codes classiques du genre. De plus, et au-delà de sa mise en scène, relativement classique, il reste toujours cette approche originale qui consiste à ne pas se focaliser sur le rôle-titre. De la sorte, les axes des récits consacrés respectivement à Marx et Engels, profitent d’un montage alterné, tandis que les nombreuses scènes où ils sont ensemble acquièrent une certaine émotion dans la sincérité avec laquelle est filmée leur amitié.
Le résultat s’apparente autant à une romance (le plan final qui les réunit sur une plage pourrait être celui d’une comédie romantique) qu’à un brûlot politique intemporel. Ce mélange est le fruit d’une réflexion sur la façon dont une révolution mondiale naît invariablement d’une remise en question à l’échelle individuelle. Cette observation à hauteur d’homme profite d’un parti pris qui, là encore, va apparaître comme une limite à beaucoup : celui de se concentrer sur une période où les tensions sociales montent jusqu’à l’explosion sociale, mais pour s’achever juste avant celles-ci. Voir le peuple galvanisé par la rhétorique marxiste aurait en effet été la meilleure façon de la voir se concrétiser, et peut-être la comprendre mieux.
Les spectateurs, non adeptes de la cause marxiste avant le film, ont donc peu de chance d’en sortir convaincus. Raoul Peck ne cherche d’ailleurs pas à en faire un objet de propagande. Il est par ailleurs impossible de nier les caractères humaniste et moderne qu’il parvient à insuffler à cette révolte sociale qui couve depuis la Révolution industrielle. L’espoir est là, à chacun de s’y accrocher s’il veut y croire.
Si l’on ressent dès les premières images une véritable soif de raconter, cette qualité de bon aloi ne vient pas de nulle part : l’engagement en tant que citoyen politique de Raoul Peck est connu depuis longtemps dans ses films, ceci en dehors des responsabilités qu’il aura assumées (comme ministre de la Culture d’Haïti, par exemple) et du soutien à la production du cinéaste militant Robert Guédiguian pour ce projet-là. Devant l’ampleur de la tâche, le regard de Raoul Peck, mélange de valeurs propres au documentaire (la reconstitution historique est parfaite), tient bon la rampe dans la rigueur des citations et des faits (on apprend beaucoup et c’est toujours intéressant), face à la belle tension palpable de son scénario (due en partie à Pascal Bonitzer, coscénariste) et aux acteurs principaux, frais, bien en chair, vifs et brillants. La réussite est d’autant plus plaisante qu’en dépoussiérant sérieusement l’icône de Marx, le réalisateur dresse ainsi le portrait d’une jeunesse largement idéaliste, qui fait souvent défaut à notre époque : un âge séduisant, passionné, insolent, rieur qui, même s’il réussit ou se trompe, avance quoiqu’il arrive. En somme, un film inspiré et inspirant.
L’histoire d’une famille au désespoir, peuplée de héros qui préfèrent en finir
HAPPY END
Film franco-germano-autrichien de Michael Haneke-2017
 A Calais, Georges Laurent, patriarche d’une famille bourgeoise, accueille sa petite-fille Ève, dont la mère est dans le coma après l’absorption d’une surdose de médicaments. Chez le vieil homme, l’atmosphère est souvent sinistre, entre Thomas, qui n’assume pas sa double vie, et sa sœur Anne, qui doit s’occuper en même temps d’un accident qui a frappé le chantier sur lequel elle travaille, et de son fils Pierre, qui connaît de nombreux problèmes…
A Calais, Georges Laurent, patriarche d’une famille bourgeoise, accueille sa petite-fille Ève, dont la mère est dans le coma après l’absorption d’une surdose de médicaments. Chez le vieil homme, l’atmosphère est souvent sinistre, entre Thomas, qui n’assume pas sa double vie, et sa sœur Anne, qui doit s’occuper en même temps d’un accident qui a frappé le chantier sur lequel elle travaille, et de son fils Pierre, qui connaît de nombreux problèmes…
Happy End marque la quatrième collaboration entre le réalisateur autrichien Michael Haneke et l’actrice Isabelle Huppert, après Le Pianiste (2000), le Temps du Loup (2002) et Amour (2012). Le film a été sélectionné en compétition lors du dernier Festival de Cannes, cinq ans après qu’Haneke ait remporté la Palme d’Or pour Amour, qui comptait déjà Jean-Louis Trintignant dans son casting. Oscillant entre drame et comédie, Happy End est une chronique qui dépeint les désillusions d’une famille bourgeoise moderne…
Happy End, Joyeuse fin. Joyeuse ?... Certainement pas ! Mais c’est bien un film sur la fin. Dans une mise en scène parfaitement réglée et dépouillée jusqu’à l’os, le cinéaste autrichien filme une famille au désespoir, peuplée de héros qui préfèrent en finir, quand ils ne sont pas déjà morts.
Dès l’ouverture du film, c’est le début de la fin : dans une série glaçante de vidéos (en format ‘’Snapchat’’), Ève adolescente (Fantine Harduin) raconte sa haine envers sa mère et son mal-être. Lorsque sa mère se retrouve dans le coma, la jeune Ève, 13 ans, est hébergée chez son père Thomas (Matthieu Kassovitch) qui vit avec son vieux père, infirme, acariâtre et suicidaire (magistral Jean-Louis Trintignant), avec sa sœur Anne (Isabelle Huppert) impitoyable à la tête de la société de BTP familiale, son neveu Pierre, dépressif, avec sa nouvelle femme, dans une immense demeure bourgeoise de Calais où ils sont servis par deux employés marocains.
Parallèlement à l’arrivée de l’adolescente, s’enclenche une série d’incidents qui menacent d’ébranler l’équilibre familial, et qui commencent par un éboulement sur un de leurs chantiers. L’affaissement est capté à travers un dispositif de distanciation sonore – de trop loin pour qu’on entende le son direct – comme si la scène était filmée par un observateur impassible. Dans ce film, aux allures de jugement dernier, les hommes sont devenus les témoins macabres d’un monde qui part à la dérive, comme lobotomisés, ils observent ce spectacle apocalyptique sans réagir. Haneke filme une société du vide, du creux, du virtuel, un monde vidé de sa substance humaine : dans cette famille, pas de sentiment, pas de communication, pas d’amour. Cet assèchement se traduit magistralement dans une mise en scène dépouillée, avec des ellipses très brutales qui se succèdent sans ménagement, des indices à retardement, des secrets savamment révélés par des détails furtifs. Si c’est le film le plus grinçant d’Haneke, c’est aussi son plus désespéré : on ne peut s’empêcher de voir, dans le personnage joué par Trintignant, dans ce vieillard qui veut en finir, l’image du cinéaste, ou l’art d’orchestrer sa propre marche funèbre.
Bizarrement, il y a vraiment de l’humour dans ce dernier film. Haneke signe une farce à la Becket, comme pour dire que, cette fois-ci, rien n’était sérieux. Il y a aussi des moments de cinéma très impressionnants où il met son art de la mise en scène au service de sa fable destructrice. La vérité, c’est qu’on ne voit rien de tout ça. Parce qu’il n’y a que Trintignant. Dès qu’il apparaît, avec son phrasé inouï, son timbre chaud et distant, sa science instinctive du jeu et du tempo de la scène, avec sa volonté de hurler la méchanceté du monde à la gueule de l’humanité toute entière, il bouffe littéralement le film. Intrigant de bout en bout, passant de la joie au malaise, de la lumière à l’obscurité avec sa légèreté de dandy légendaire, il est l’arme fatale de ce film étrange. C’est dans son rapport avec la gamine que réside l’étrange beauté méphistophélique de ce Happy End. Michael Haneke a dit de lui : ‘’Jean-Louis Trintignant est tellement talentueux. Tourner à nouveau avec lui constitue l’une des raisons d’être du film’’.
Dans un entretien pour le journal L’Humanité, Dominique Widemann lui demande : ‘’Vous écriviez, dans une note d’intention un peu énigmatique : « Tout autour de nous, le monde, et nous au milieu, aveugles. » En quoi ce propos rejoint-il celui du film que nous avons sous les yeux ?
- Michael Haneke : Parce que l’aveuglement est un thème évident. Le film se tenant à Calais, beaucoup s’attendaient à ce qu’il parle des migrants. Ce n’est pas le thème du film, qui est, en effet, notre autisme, notre incapacité d’empathie. Cela concerne aussi nos familles, nos amis, la vie de tous les jours. Néanmoins, Happy End commence avec ce long mur construit à Calais pour se protéger des migrants. En Autriche aussi, nous connaissons ce type de lieux. D’autres évocations surviennent au cours du film, mais il ne me paraissait pas nécessaire de le souligner.
- DW : Vous nous présentez une famille sur laquelle on met du temps avant d’apposer un patronyme commun à ses membres. Chacun est-il à ce point enfermé dans le tunnel de ses préoccupations ?
- M. Haneke : Je crois que c’est simplement le type de relations qu’entretiennent souvent les familles. Ils ont tous des problèmes qui les accaparent entièrement. Ils sont occupés par leur nombril, leur indifférence. Je m’inclus dans ces comportements. Mais je ne porte pas de jugement. Ils sont également tristes ou seuls. Ce ne sont pas des monstres. À part peut-être l’adolescente, mais on n’en est pas vraiment sûrs. Ce sont des bourgeois et ils ont une manière spécifique de se comporter, des codes, l’usage du non-dit. Mais je ne veux pas réduire le film à l’observation de la bourgeoisie. Il me semble qu’il y a de nombreux égoïsmes dans nos sociétés. Cela rend peut-être le film plus difficile car cela demande beaucoup d’attention. C’est un acte volontaire. L’objectif est que le film soit vu au moins deux fois… DW : Demandez-vous beaucoup à vos acteurs?
- M. Haneke Ce sont de grands acteurs, contents de jouer des rôles complexes. Pour moi, la première qualité d’un metteur en scène, c’est la distribution. Là, on a longtemps cherché l’adolescente, presque encore une petite fille, interprétée par Fantine Harduin. Il fallait absolument que son rôle soit plausible. Jean-Louis Trintignant est tellement talentueux. Tourner à nouveau avec lui constitue l’une des raisons d’être du film. La scène qui se déroule entre lui et la petite fille est la seule scène d’amour du film. Et encore, rien n’est dit. Tout doit se lire entre les lignes. La fin d’Amour, justement, était métaphorique. Je voulais en donner une vision, disons, « réaliste ». Happy End a demandé beaucoup de travail, d’adaptation, notamment avec la maison dans laquelle nous avons tourné. Sinon, tout est question de rythme’’…
Frédéric Théobald prolonge ces réflexions dans un autre entretien avec Michael Haneke, pour le journal La Croix, où il dit : ‘’Dans mes films, le mal est là, avec son corollaire, la culpabilité, mais sans qu’il soit possible de l’évacuer par un raisonnement simple et définitif. Dans Funny Girl (1968), le pourquoi que le père adresse aux deux tueurs de sa fille reste sans réponse. Le mal est là, mais comme une force opaque. Des philosophes se sont cassé la tête sur le mal et aucun n’a réussi à donner une réponse. Je peux montrer les effets du mal, mais aucunement le nommer. Dire d’où vient le mal, désigner un bouc émissaire, c’est toujours simpliste et dangereux’’… Ce qu’interroge Haneke, c’est notre place dans ce jeu morbide, notre hypocrisie, notre indifférence, notre lâcheté : ‘’La vraie honte ne provient pas tant des gens qui pratiquent le mal, que de ceux qui ferment les yeux pour ne pas le voir’’. Et surtout, regarder le mal en face n’est pas dénué de vertu, comme l’explique la psychanalyste Sarah Chiche dans Ethique du mikado (PUF) : ‘’L’horreur, quand on s’y confronte par le truchement paradoxal d’une expérience esthétique, peut nous transformer sur le plan moral… Les films de Haneke nous rappellent qu’à chaque fois que nous posons un acte, nous pouvons faire ce choix de pouvoir renverser la marche vers le pire’’… ou vers le mieux. Certes, le mal est bien là, et le cinéma d’Haneke n’entend pas l’annuler, mais juste pour nous dire que nos choix ne sont pas neutres et que notre liberté peut les orienter.
Le rêve d’une vie respectable remplacé par une lutte pour survivre
TAXI SOFIA
Film bulgaro-germano-macédonien de Stephan KOMANDAREV – 2017
 Lors d’un rendez-vous avec son banquier, Misho (Vasil Banov), un petit entrepreneur qui travaille comme chauffeur de taxi pour arrondir ses fins de mois, découvre que le montant du pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier et se suicide. Le drame suscite un débat national à la radio au sujet du désespoir qui a saisi la société civile. Pendant ce temps, cinq chauffeurs de taxi et leurs passagers roulent dans Sofia la nuit, chacun dans l’espoir de trouver un avenir meilleur.
Lors d’un rendez-vous avec son banquier, Misho (Vasil Banov), un petit entrepreneur qui travaille comme chauffeur de taxi pour arrondir ses fins de mois, découvre que le montant du pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier et se suicide. Le drame suscite un débat national à la radio au sujet du désespoir qui a saisi la société civile. Pendant ce temps, cinq chauffeurs de taxi et leurs passagers roulent dans Sofia la nuit, chacun dans l’espoir de trouver un avenir meilleur.
Stephan Komandarev est né en 1966 à Sofia. Après des études de médecine, il se lance dans le cinéma en réalisant, entre 1998 et 2001, une série de 65 épisodes pour une émission de télévision, consacrée à l’histoire du cinéma bulgare. Taxi Sofia est son 6e long métrage, qui a été présenté au Festival de Cannes dans le cadre de la sélection ‘’Un certain Regard’’.
Stephan Komandarev présente son film dans une fiche du Groupement National des Cinémas de Recherche, éditée par le Centre National du Cinéma : ‘’L’idée de ce long métrage est née sur la banquette arrière d’un taxi, un jour glacial de janvier 2015. Le chauffeur me racontait que les taxis de Sofia étaient quelque chose comme les services sociaux de Bulgarie : quand les gens avaient perdu leur emploi, la première chose qu’ils essayaient, c’était de devenir chauffeur. Il venait lui-même de perdre son poste de professeur de sciences nucléaires à l’Académie Bulgare des Sciences. Il m’a raconté l’histoire de collègues – enseignants, scientifiques, prêtres, musiciens, boulangers, … – qui conduisent des taxis la nuit, rien que pour survivre et payer leurs frais. C’est également de lui que je tiens la boutade disant que la Bulgarie est un pays optimiste parce que les pessimistes et les réalistes l’ont quitté depuis longtemps. Les chauffeurs de taxi semblent posséder un sens très précis des réalités sociales. Ils expriment leur point de vue sur un pays totalement dénué d’esprit, où la pauvreté et l’inégalité toujours croissantes ont généré un sentiment d’échec qui traverse toute la société. Pour beaucoup, le rêve d’une vie respectable a été remplacé par une lutte obstinée pour une survie au jour le jour.
L’histoire de Misho, qui ouvre le film, est basée sur un incident véritable qui a mis tout le pays en émoi voici deux ans. Mon but n’était pas tant de faire le récit d’histoires vraies que de représenter, au moyen de la fiction dramatique, la vérité émotionnelle ressentie au cœur de chaque situation. Pour ce faire, j’ai reçu l’assistance de Todor Todorov, psychologue criminaliste respecté, pour m’aider à décrire l’essence de chaque caractère.
Je vis en Bulgarie avec mes deux enfants. Je me demande dans quel genre de monde ils vivront une fois adultes. Qu’est-ce qui les attend ? Comment renverser le déclin actuel des valeurs sociales et éthiques ? La fille de Misho est jouée par ma propre fille de 13 ans. Dans le premier plan, on la voit regarder son père d’un air interrogateur ; dans le dernier plan, on la voit rentrer au collège dans la neige. Nous sera-t-il possible de rompre avec le passé et de connaître une nouvelle vie ? Ce film est ma prière pour mes enfants, ma communauté et mon monde’’.
Dans un chassé-croisé nocturne, Stephan Komandarev suit les courses des chauffeurs de taxi et les confessions de leurs clients, dans une Bulgarie partagée entre agressivité et légèreté, danger et secours. Il existe des instants de transition hasardeuse où le visage de celui qui nous emmène comme celui qui est emmené reste toujours inattendu : un trajet en taxi comporte sa part de respiration imprévisible. Dans un taxi, tout se passe, et rien ne se passe, on ne sait pas pourquoi ; mais parfois on s’y parle, on se confesse sans vraiment se connaître. Parfois on se tait, et alors la radio vient nous sauver d’un silence étouffant. La suite des histoires particulières glisse, ondulante, entre pudeur et don de soi. La cadence effrénée du récit, son habileté à passer le relais de passager en passager, à livrer généreusement des émotions si diverses, permet de tenir debout dans les variations de l’action. L’unique caméra embarquée capte la chorégraphie, tendue mais gracieuse, des gestes et des paroles échangées, nous emportant parfois dans sa course, d’autres fois nous laissant un peu seul dans la nuit. C’est tout le risque de cette tension portée à bout de bras. L’atmosphère oscille sans lourdeur entre l’agressivité et une étonnante légèreté, entre le danger et le secours.
Le récit saccadé porte souvent une touche de mélancolie qui s’estompe parfois quand les personnes attentives plaisantent en s’apportant une chaleur humaine authentique et une écoute véritable. Quelqu’un tend toujours la main, on ne tombe pas d’un pont, juste ce qu’il faut de surprise pour capter la détresse et s’agripper aux reflets de lumière. «Un nouveau cœur, ça pourrait sauver la Bulgarie», ironise Dara, s’adressant au client qu’elle vient de prendre, un chirurgien qui partira bientôt pour l’Allemagne. Celui-ci justifie son départ en disant : ‘’Je peux sauver des gens. Pas des cadavres !’’. Avec Taxi Sofia, qui s’ouvre et se referme durant le jour mais qui se déroule principalement la nuit, on se tient comme en suspension, entre les rêves et les espoirs d’une vie meilleure.
Transformer des taxis en salons où l’on cause, où des personnages se dévoilent, apprendre à appréhender une ville et un pays au travers des vitres d’un de ces salons roulants, cela n’est pas un procédé nouveau au cinéma. Il n’empêche : le procédé fonctionne parfaitement et permet aux spectateurs de s’introduire dans les problèmes de la société bulgare contemporaine sans qu’apparaisse la moindre bribe d’ennui. Ce que raconte Taxi Sofia suffirait déjà à en faire un film ‘’intéressant’’ ; sa très belle construction et la qualité de ses plans-séquences en font un film qui, très vite, se révèle ‘’passionnant’’ et cinématographiquement très abouti.
Le quotidien d’une famille syrienne pendant le drame que vit Damas
UNE FAMILLE SYRIENNE
Film franco-belge de Philippe VAN LEEUW – 2017
 En pleine guerre à Damas, rester cloîtrée dans son appartement, c’est le quotidien d’une famille syrienne ; une famille ordinaire qui fait ce qu’elle peut pour continuer à vivre, au jour le jour. L’appartement, avec sa porte blindée constamment verrouillée, est devenu une sorte de bunker. Tout y est organisé en fonction de la pénurie. Chaque matin, il s’agit de tenir un jour de plus. Oum Yazan et les siens ont accueilli Halima qui vient d’avoir un bébé. Avec son mari, elle annonce à son hôte qu’elle veut tenter sa chance et partir pour Beyrouth. Pendant ce temps, les bombes se rapprochent de plus en plus de l’immeuble où vit la famille… Que se passe t-il dans les maisons qui ferment leurs volets devant la guerre ? Tiraillés entre fuir et rester, ils font face chaque jour en gardant espoir… ‘’Comme pour mon premier film qui abordait le génocide au Rwanda (Le jour où Dieu est parti en voyage – 2009), je suis parti de cette colère, de ce sentiment d’impuissance face à des choses terribles qui se passent sous nos yeux’’, explique Philippe Van Leeuw. En utilisant le huis clos, l’intention du réalisateur est de raconter le quotidien d’une famille qui subit la guerre. La célèbre comédienne Hiam Abbas était investie dès le départ dans le projet, avant même que le film ait déjà trouvé un vrai budget.
En pleine guerre à Damas, rester cloîtrée dans son appartement, c’est le quotidien d’une famille syrienne ; une famille ordinaire qui fait ce qu’elle peut pour continuer à vivre, au jour le jour. L’appartement, avec sa porte blindée constamment verrouillée, est devenu une sorte de bunker. Tout y est organisé en fonction de la pénurie. Chaque matin, il s’agit de tenir un jour de plus. Oum Yazan et les siens ont accueilli Halima qui vient d’avoir un bébé. Avec son mari, elle annonce à son hôte qu’elle veut tenter sa chance et partir pour Beyrouth. Pendant ce temps, les bombes se rapprochent de plus en plus de l’immeuble où vit la famille… Que se passe t-il dans les maisons qui ferment leurs volets devant la guerre ? Tiraillés entre fuir et rester, ils font face chaque jour en gardant espoir… ‘’Comme pour mon premier film qui abordait le génocide au Rwanda (Le jour où Dieu est parti en voyage – 2009), je suis parti de cette colère, de ce sentiment d’impuissance face à des choses terribles qui se passent sous nos yeux’’, explique Philippe Van Leeuw. En utilisant le huis clos, l’intention du réalisateur est de raconter le quotidien d’une famille qui subit la guerre. La célèbre comédienne Hiam Abbas était investie dès le départ dans le projet, avant même que le film ait déjà trouvé un vrai budget.
Récompensé de trois prix au dernier Festival du film francophone d'Angoulême, Une Famille syrienne offre un parfait contre-point aux images d'actualité sur la guerre en Syrie. Sur le quotidien d'une famille de la classe moyenne syrienne, prise entre deux feux ennemis, on ne sait finalement que peu de choses et c'est ce vide que tente de combler le réalisateur. Jamais il ne donne d'indication sur le camp qui tire sur les silhouettes qui passent devant l'immeuble, de jour comme de nuit. Le propos de Philippe Van Leeuw n'est pas politique mais humain : comment survivre à la guerre avec une famille à charge, le bébé de la voisine qui hurle et le beau-père qui reste sans réaction, cigarette au bec et larme à l'œil.
Sobre, sans une scène superflue - le film dure 1h20 -, Une Famille syrienne parvient à nous faire ressentir la pression psychologique de cette situation sous haute tension où le moindre SMS peut annoncer la mort d'un proche ou la promesse d'un nouveau départ. Impressionnante en mère de famille qui tente de préserver les siens de l'horreur de la guerre, comme si de rien n'était, Hiam Abbas mène une distribution parfaite où les femmes tiennent les premiers rôles. Histoire de démontrer qu'elles ont été les premières victimes de la guerre civile syrienne, utilisées comme boucliers humains, humiliées par les hommes et parfois violées.
De ce qui se passe dans les rues de Damas, le film n’offre que de rares images, toutes limitées à une cour aux allures de champ de bataille que l’on aperçoit par la fenêtre. Une ouverture limitée qui suggère une mise en abyme, les personnages observant ce qui se passe à l’extérieur tandis que nous les observons enfermés dans leur appartement ; en fait, un espace clos dans lequel nous nous retrouvons enfermés avec eux, partageant leur drame qui nous semblait pourtant si lointain. Cet enfermement, on le ressent avant tout grâce à la fluidité des plans-séquences qui nous accompagnent de pièce en pièce. Refusant le recours à un montage brutal et artificiel, le réalisateur fait preuve d’un grand sens de l’espace, qui dépasse le seul effet de claustrophobie, pour évoquer le lien qui existe entre les personnages, dont l’intimité se réduit à une peau de chagrin, et pour qui il est devenu vital de se soutenir mutuellement face au danger.
Mais le hors-champ reste omniprésent, grâce à un formidable travail sur le son : le bruit des hélicoptères, des bombardiers et des explosions ponctuent ainsi la vie de la dizaine de personnes qui se terrent dans cet abri de fortune. Chaque bruit de l’extérieur devient une source de terreur, que le rythme de la mise en scène ne fait qu’amplifier, atteignant un niveau que peuvent lui envier de nombreux films d’horreur. Tout ce travail formel permet de ne pas qualifier cette œuvre de simple théâtre filmé, auquel il s’apparente pourtant. Il faut reconnaître que la qualité première du film est le réalisme digne d’un documentaire avec lequel il dépeint le quotidien des survivants, sans fioriture et sans pathos.
La tragédie de ces Syriens, contraints de tout rationner et n’ayant plus comme seule ressource que leur espoir, ne serait pas aussi touchante sans les interprètes qui les représentent : Hiam Abbas reste égale à elle-même, avec une intensité qui ne faiblit à aucun moment ; Juliette Navis, qui a déjà fait ses premiers pas en France, est plus effacée mais elle incarne parfaitement le sentiment d’oppression de ce peuple écrasé ; la véritable révélation est Diamand Bou Abboud, une actrice libanaise qui, par de simples jeux de regard, parvient à donner à certains moments une intensité dramatique bouleversante. C’est elle qui est au cœur de la scène la plus dure du film, et qui rappelle brutalement que le viol reste toujours une arme de guerre.
C’est parce qu’il ne nomme pas les coupables de ces exactions inhumaines que le film dépasse la souffrance des civils syriens pris entre deux feux, pour embrasser, dans un même drame humanitaire, les nombreux peuples dont les pays sont en guerre. Même si on sait que le film ne changera pas directement les choses, il contribue à une prise de conscience salutaire de l’horreur qu’engendrent ces conflits. On ne pourra plus faire semblant d’ignorer ce qui se joue dans ces contrées, à la fois si lointaines et si proches de chez nous. C’est ce qui en fait un cri d’alerte d’une ampleur salutaire comme on n’en voit que trop peu au cinéma. Ce film devrait aider à modifier notre regard sur les personnes réfugiées, en particulier celles qui arrivent de Syrie dans nos pays.
Octobre 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Quand un Etat est gangrené par la corruption.
LE CAIRE CONFIDENTIEL
Film germano-suédois de Tarik SALEH – 2017

Au Caire, en janvier 2011, peu de temps avant la révolution, une femme chanteuse est retrouvée égorgée dans une chambre d’hôtel. L’enquête de l’inspecteur Noureddine le met sur la piste des proches du président Moubarak. Une situation délicate au moment où le pays commence à se soulever contre le régime… Le Caire confidentiel est le 2e long-métrage de fiction de Tarik Saleh. Il s’inspire de l’histoire du vrai meurtre de la célèbre chanteuse libanaise Suzanne Tammim en 2008. Le film a été présenté en première mondiale au festival de Sundance en janvier 2017 et a remporté le Grand prix au Festival du film policier de Beaune.
Le film de Tarek Saleh noue la grande et la petite histoire, tout en revenant aux sources du roman noir. Est-ce une allusion à l’éternel recommencement ? Car le film pourrait se dérouler dans n’importe quel pays ayant eu à faire face à un Etat gangréné par la corruption. Cette fois, il se déroule en Egypte, au moment de l’éclosion de ce qu’on a appelé ‘’les printemps arabes’’. Un contexte que T. Saleh connaît bien puisqu’il est suédois, mais d’origine égyptienne. Il montre un pays où tout est régi par l’argent, la lutte pour le pouvoir, et la corruption des institutions qui n’ont plus aucun souci de l’humain. Même Noureddine, l’inspecteur qui enquête, n’est pas toujours très net dans sa pratique professionnelle. Pourtant, le film est passionnant quand il dévoile des aspects cachés de la société égyptienne : par exemple, le sort des immigrés, à travers la situation de Salwa, l’employée au ménage, qui est le seul témoin du drame. Malgré la précarité de sa situation et la peur qui l’enserre, elle acceptera de collaborer au dévoilement de la vérité ; ou encore dans la description de la ville du Caire…
Pour son nouveau polar, après l’inédit Tommy (2014), le Suédois frappe fort avec cette œuvre qui, une fois de plus, se délocalise pour mettre en scène l’histoire récente de l’Egypte. Délaissant l’approche purement documentaire pour évoquer les événements qui allaient mener le peuple à se révolter contre la présidence autoritaire de Moubarak, Saleh opte pour un mariage percutant entre la fiction (le thriller de chambre d’hôtel avec soupçons politiques) et le réalisme du reportage, puisque c’est bien au contexte historique, qui se déroule en filigrane, que l’auteur s’intéresse.
Avec sa caméra, curieuse et pénétrante, il porte un regard sans concession sur le système gangrené par la corruption, un état policier étroitement lié aux affaires, une nébuleuse opaque, abjecte, de sexe, de drogue et de sang, dans lequel le cinéaste propulse le spectateur occidental. Nous sommes dans un autre monde. La peinture de l’Egypte des années 2010, est celle d’une caricature de justice, où l’on se débarrasse facilement des témoins gênants (les immigrés d’Afrique noire, des parias sans identité qui ne parlent même pas la langue du pays, sont considérés comme de simples dommages collatéraux). Le réalisateur y révèle des petits arrangements entre meurtriers et complices que sont les grands représentants de l’État, les flics et les voyous, ainsi que les politiciens véreux.
Le bouquet final, particulièrement effrayant de noirceur, opère le dévoilement de tout un système où la culture elle-même est pourrie, où la femme, utilisée, abusée, bafouée, est finalement éliminée. L’auteur déboulonne tout un système macho-mafieux avec un savoir-faire chirurgical, dans le genre codé du polar, peu éloigné dans son efficacité des classiques américains. Mais ce qui octroie une identité singulière à ce bain en eaux troubles, c’est bien le rôle important donné à la ville elle-même, véritable métaphore des crispations humaines, sociales et religieuses. Ce monstre urbain, en pleine effervescence, entre quartiers chics et taudis pour réfugiés, se fait l’arène de contrastes insupportables. Son instabilité, sa véhémence entretiennent les remous d’une population surchauffée, d’une jeunesse cultivée en quête d’éveil, et d’une partie des classes populaires qui courbe l’échine face à la toute puissance des nantis.
Comme l’écrit François Forestier dans L’Obs : ‘’Le constat est amer… Tarik Saleh, ex-graffeur né en Suède, ex-éditeur d'une revue, auteur de documentaires sur Che Guevara et sur Guantánamo, réalisateur d'un dessin animé ("Metropia") et d'un polar ("Tommy"), a un regard aigu, une façon rageuse de suggérer l'émiettement social, la détérioration de la simple morale. Comment un tel film a-t-il pu être tourné en Egypte aujourd'hui ? Il n'a pas pu, voilà… En plein tournage, les services de sécurité de l'Etat ont mis bon ordre et fermé le plateau. Tarik Saleh a dû terminer son film à Casablanca, où le directeur de la photo Pierre Aïm a su saisir avec finesse les mêmes contrastes de lumière, les mêmes menaces dans l'ombre. La nuit, au Caire, sent le pourri’’.
Le Caire Confidentiel est un film noir réussi, qui nous immerge dans une Egypte très éloignée de l’idée que l’on peut s’en faire en Europe, et qui nous entraîne dans son suspens dans les bas fonds du Caire pour deux heures de polar, un polar qui sent à la fois le souffre et les épices !
Octobre 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Si peu de choses enchantent le quotidien :
un peu d’humanité, un regard de sympathie, un filet de solidarité…
VISAGES VILLAGES
Film français de Agnès VARDA et JR – 2017
 La cinéaste Agnès Varda et le photographe JR décident de partir sillonner les routes de France à bord de la camionnette-studio de JR. Ils désirent aller à la rencontre des gens, pour leur parler, les photographier, développer les photos et les afficher en grand format dans leurs lieux de vie. JR et Varda croisent des ouvriers, des agriculteurs, une vendeuse… Agnès Varda voudrait également que JR montre enfin ses yeux, toujours dissimulés derrière des lunettes noires, comme ceux de J.Luc Godard dans le court-métrage burlesque Cléo de 5 à 7… Cette collaboration entre la cinéaste et le photographe est une heureuse rencontre qui donne lieu à un ‘’road movie’’ tendre et délicieusement malicieux. Ce documentaire a été présenté Hors Compétition au Festival de Cannes 2017.
La cinéaste Agnès Varda et le photographe JR décident de partir sillonner les routes de France à bord de la camionnette-studio de JR. Ils désirent aller à la rencontre des gens, pour leur parler, les photographier, développer les photos et les afficher en grand format dans leurs lieux de vie. JR et Varda croisent des ouvriers, des agriculteurs, une vendeuse… Agnès Varda voudrait également que JR montre enfin ses yeux, toujours dissimulés derrière des lunettes noires, comme ceux de J.Luc Godard dans le court-métrage burlesque Cléo de 5 à 7… Cette collaboration entre la cinéaste et le photographe est une heureuse rencontre qui donne lieu à un ‘’road movie’’ tendre et délicieusement malicieux. Ce documentaire a été présenté Hors Compétition au Festival de Cannes 2017.
En 2008, Agnès Varda, figure majeure de la Nouvelle Vague, fêtait ses 80 ans. A cette occasion, elle avait réalisé un documentaire en forme d’autoportrait, intitulé Les plages d’Agnès, qui semblait annoncer la dernière page de sa carrière de cinéaste. Sept ans plus tard, c’est à l’occasion d’une rencontre organisée par sa fille Rosalie qu’Agnès Varda va envisager un nouveau long-métrage avec le photographe contemporain JR, qui a acquis une réputation internationale de créateur innovant, en réalisant d’ambitieux collages d’images photographiques à vocation éphémère et affichés dans des lieux insolites. En 2010, il avait réalisé un film, Women Are Heroes, consacré à un vaste projet de portraits de femmes du monde entier confrontées à la violence.
Ils envisagent leur collaboration comme une sorte de ballade itinérante et documentaire pour rencontrer les habitants de la France rurale, dans le camion-studio de JR qui permet facilement d’agrandir les images.
Un des thèmes de leur ballade est la mémoire : leurs premières rencontres avec Jeanine, dernière habitante d’un coron dans le Pas-de-Calais, et avec Vincent, carillonneur dans le Vaucluse, rappellent un passé que le pays a oublié. Qu’ils soient artisans ou ouvriers, Agnès et JR rendent hommage avec poésie à leur savoir-faire si peu connu et recueillent leurs réactions devant leurs portraits exposés.
Au fil des rencontres, l’amitié croit entre ces deux artistes. Elle se confie à lui et lui, lui présente les trois dockers avec lesquels il a travaillé sur le port du Havre. Plus ils échangent et plus leur créativité se déploie. Un blockhaus, sur la plage de St Marie-sur-Mer, est transformé en hommage à un ami d’Agnès.
Visages Villages montre que chacun a une histoire particulière et qu’aucune n’est moins importante que les autres. Celles que recueillent Agnès Varda et JR nourrissent leur propre histoire et l’élargissent pour composer un film qui ouvre au collectif. En point d’orgue, Visages Villages nous emporte dans un bouquet final où Agnès, bouleversée et bouleversante, parle de l’absence de son ami Jacques Rivette, autre grand nom de la Nouvelle Vague, disparu en 2016. Et pourtant, jusqu’au bout, c’est la joie qui éclaire de documentaire intime.
Il suffit de peu de choses pour enchanter le quotidien ! Un peu d’humanité, un regard de sympathie, un filet de solidarité, une pincée d’émotion, une tranche de fantaisie, une belle rasade d’imagination… Entre deux films pessimistes qui donnent envie de fuir le monde, Agnès Varda, du haut de ses trois pommes et de ses 88 printemps, ne cesse de cultiver la racine du bonheur.
Octobre 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
En disparaissant, un enfant commence à exister aux yeux de ses parents
FAUTE D’AMOUR
Film franco-russe de Andreï ZVYAGINTSEV – 2017
 Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : déjà Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse… Andreï Zvyagintsev avait depuis longtemps l’idée de mettre en scène l’histoire d’une famille qui explose après des années de vie commune. C’est en découvrant le mouvement bénévole Liza Alerte, qui s’occupe de chercher des personnes disparues, que le réalisateur a finalisé le scénario de Faute d’amour. Le film a été présenté en compétition officielle lors du dernier festival de Cannes et a reçu le prix du jury.
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : déjà Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse… Andreï Zvyagintsev avait depuis longtemps l’idée de mettre en scène l’histoire d’une famille qui explose après des années de vie commune. C’est en découvrant le mouvement bénévole Liza Alerte, qui s’occupe de chercher des personnes disparues, que le réalisateur a finalisé le scénario de Faute d’amour. Le film a été présenté en compétition officielle lors du dernier festival de Cannes et a reçu le prix du jury.
‘’C’est l’histoire d’un enfant qui commence à exister aux yeux de ses parents en disparaissant’’, disait le réalisateur au cours d’un entretien à Cannes. C’est l’un des paradoxes qui contribue à rendre ce film si intensément déchirant. À l’écran, il suffira de quelques plans pour qu’Aliocha laisse un souvenir indélébile qui viendra hanter la suite du film. On repense longtemps à cette éprouvante séance de dispute entre les parents où chacun, désireux de repartir à zéro après le divorce, refuse de prendre l’enfant à sa charge, quitte à l’envoyer à l’orphelinat : pas de problème tant qu’il n’y a pas de représailles des services sociaux. Un plan absolument bouleversant viendra clore cet affrontement : on découvre Aliocha, caché derrière la porte de la salle de bain, témoin invisible de la scène, hurlant en silence, le visage ravagé par les larmes. Quelques secondes terribles pour dire toute la détresse et la solitude d’un enfant qui ne réclamait rien d’autre que de l’amour et de l’attention. Sa disparition, ses parents ne la constatent que vingt-quatre heures plus tard, trop obnubilés par leurs problèmes personnels. Pour Boris (Alexei Rozin), commercial dans une boîte gérée par un patron ultra-orthodoxe qui n’accepte les séparations de ses salariés qu’en cas de décès du conjoint, il s’agit de sauver son emploi en réussissant à se remarier aussi vite qu’il aura divorcé. On note le contraste édifiant entre une doctrine à la pointe du libéralisme moderne au service d’un traditionalisme des plus archaïques. Pour Genia (Mariana Spivak), gérante d’un salon de beauté, qui a les yeux rivés sur son téléphone portable pour immortaliser chaque instant en ‘’selfie’’ à destination des réseaux sociaux, il s’agit d’optimiser sa relation avec Anton, son nouveau compagnon. Elle est impressionnante dans son personnage d’une froideur et d’une justesse glaçantes. Égoïstes et superficiels, Boris et Genia incarnent la nouvelle classe moyenne russe, celle qui a réussi mais qui n’est pas encore à l’abri sur le plan financier. Le drame qui les touche les rappelle brutalement à leurs responsabilités et à leurs manquements. Ces personnages presque haïssables, Andreï Zvyagintsev les décrit en s’abstenant de tout jugement à leur encontre, mais en témoignant au contraire d’une empathie délicate. La noirceur du récit contraste avec ce regard qui scrute jusqu’aux tréfonds de l’âme ses protagonistes, pour chercher ce qui leur reste d’humanité. L’expression de leurs douleurs résonne autant comme une prise de conscience tardive qu’une quête de rédemption.
La partie du film consacrée à la recherche d’Aliocha va prendre l’allure d’un thriller haletant au cœur de Moscou, révélant l’état de délabrement moral du pays : Moscou, une ville froide et indifférente, qui paraît scindée en deux époques incapables de communiquer entre elles. Au milieu des architectures modernes, demeurent dans l’indifférence des vestiges de l’ère soviétique, à l’image de ce squat à l’abandon devenu un terrain de jeu pour des enfants dont l’unique avenir sera d’aller grossir les rangs de l’armée, une fois arrivés à l’âge adulte. Le décalage est encore plus frappant lors d’une visite nocturne, à quelques kilomètres seulement de la capitale, chez la mère de Genia qui vit recluse dans une isba délabrée, à l’opposé du luxueux appartement d’Anton où Genia ira finir sa nuit. Cette situation se fait l’écho d’un autre échec, celui d’une nation nourrie de rancœur, où la haine semble être la seule valeur qui se transmet de génération en génération (l’effroyable face à face entre Genia et sa mère), comme si l’Histoire devait se répéter indéfiniment.
Le seul motif d’espoir vient de cette association de bénévoles (indépendante de l’état), à qui la police démissionnaire (symbole d’un pouvoir public corrompu et devenu incapable de répondre à ses devoirs les plus élémentaires) a délégué sa responsabilité pour la recherche des personnes disparues. Cette initiative collective, dans une société gangrénée par l’individualisme, montre le sursaut de solidarité des citoyens qui acceptent la lourde charge de pallier aux carences de l’Etat. Lueur d’espoir au sein de ce sombre tableau, ou bien conviction intime d’un cinéaste prêt à manifester qu’un monde meilleur est encore possible ?
Faute d’amour fait penser au film d’Ingmar Bergman Sonate d’automne. On y trouve la même férocité et le même constat : les êtres qu’il observe semblent tous avoir perdu leur âme ; ils errent, en rage, à jamais solitaires, comme des ombres affolées. Le film parle de la Russie, ce pays magnifique et improbable où le peuple est conduit par Vladimir Poutine, où l’Etat règne avec une Eglise aux ordres. Mais le propos d’Andreï Zvyagintsev se veut plus universel. C’est l’effacement général de l’amour qu’il débusque en montrant ces gens, juste vivants, à qui l’égoïsme et la corruption servent de philosophie et de justification. Mais, s’ils n’aiment personne, c’est parce que personne ne les a aimés ; et s’ils ne donnent rien, c’est qu’ils n’ont rien reçu. Pauvre excuse. On a rarement vu à l’écran une vérité crue aussi embarrassante, un désespoir aussi profond.
La force du film est de montrer les comportements des adultes, devant la détresse de l'enfant. En dépit de l'évanouissement de la figure enfantine, ou peut-être grâce à lui, l'histoire somme toute commune de Faute d'amour devient universelle : choc frontal de la libido et de la culpabilité, figure stoïque du patron de l'association, voyage aux enfers chez la grand-mère, tableau symbolique de la Russie contemporaine dans le bâtiment abandonné. C'est à la fois beau et désagréable à regarder, car on se sent complices des turpitudes que Zvyagintsev nous met sous les yeux, turpitudes qu'on préférerait croire totalement étrangères à soi-même. Pour résumer : un plaisir qui fait mal, mais un choc esthétique puissant.
Octobre 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Ce film est une métaphore
d’un pays ‘’empreint de toutes formes de violences.
UNE FEMME DOUCE
Film franco-russe de Serge LOZNITSA – 2017
 En Russie, une femme reçoit un jour, par retour de courrier, un colis qu’elle avait envoyé à son mari, qui purge une peine de prison. Après avoir tenté, sans grand succès, d’obtenir une explication auprès des services de la poste, elle n’a pas d’autre choix que de se rendre à la prison, pour tenter de livrer le colis elle-même. Pour elle, c’est le début d’un long et éreintant voyage à travers le pays, avant d’affronter l’administration pénitentiaire… Une femme douce est une adaptation très libre d’une nouvelle de Dostoïevski. Serge Loznitsa a mis des années à concrétiser ce projet, qui est pour lui une métaphore d’un pays ‘’empreint de toutes formes de violences. D’un côté, vous avez une totale hypocrisie… et de l’autre, des choses absolument horribles qui continuent à se passer chaque jour’’. Le film a été présenté en compétition officielle lors du 70e festival de Cannes. Serge Loznitsa met en scène un peuple abandonné par les institutions du pays, en évoquant ‘’l’âme russe’’, pataugeant dans la société postsoviétique, en proie au désespoir. Une femme de la campagne (admirable Vasilina Makovsteva) reçoit donc, en retour, ce colis qu’elle avait adressé à son mari, emprisonné pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Elle décide d’aller le lui porter elle-même et part en car dans une région reculée de la Russie. Elle va devoir mener une bataille absurde contre l’administration, la corruption et la désespérance des habitants.
En Russie, une femme reçoit un jour, par retour de courrier, un colis qu’elle avait envoyé à son mari, qui purge une peine de prison. Après avoir tenté, sans grand succès, d’obtenir une explication auprès des services de la poste, elle n’a pas d’autre choix que de se rendre à la prison, pour tenter de livrer le colis elle-même. Pour elle, c’est le début d’un long et éreintant voyage à travers le pays, avant d’affronter l’administration pénitentiaire… Une femme douce est une adaptation très libre d’une nouvelle de Dostoïevski. Serge Loznitsa a mis des années à concrétiser ce projet, qui est pour lui une métaphore d’un pays ‘’empreint de toutes formes de violences. D’un côté, vous avez une totale hypocrisie… et de l’autre, des choses absolument horribles qui continuent à se passer chaque jour’’. Le film a été présenté en compétition officielle lors du 70e festival de Cannes. Serge Loznitsa met en scène un peuple abandonné par les institutions du pays, en évoquant ‘’l’âme russe’’, pataugeant dans la société postsoviétique, en proie au désespoir. Une femme de la campagne (admirable Vasilina Makovsteva) reçoit donc, en retour, ce colis qu’elle avait adressé à son mari, emprisonné pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Elle décide d’aller le lui porter elle-même et part en car dans une région reculée de la Russie. Elle va devoir mener une bataille absurde contre l’administration, la corruption et la désespérance des habitants.
Le film s’apparente à une aventure sur la route, à mi-chemin entre une description de la mentalité russe et l’étalage de la déliquescence de la bureaucratie et des institutions. Cette ‘’âme russe’’, si bien décrite par Tolstoï ou Dostoïevski, est engluée ici dans des sentiments beaucoup moins nobles : la délicatesse, la profondeur, la force et la compassion ont disparus. Restent les excès dans les relations humaines, dans l’amour comme dans la haine ; la démesure, la souffrance, comme le sens du symbole, surgissent dans cette fresque folklorique et désespérée. Le cinéaste célèbre néanmoins la Russie éternelle, à la fois dure et extravagante. De nombreux plans-séquences animent ce film en symbolisant chacun une situation, illustrés par un refrain militaire ou folklorique, que tout Russe connaît. Il y a notamment cette séquence dans le train où un baryton alcoolisé entonne des chants de guerre staliniens, déclenchant les larmes de ses compagnons, en présentant des images presque arrêtées, des instantanés figés, comme de véritables cartes postales sonores. La femme douce se fraye un chemin au milieu de ces tableaux de société. Elle va avoir aussi à se confronter avec de sales personnages : maquereaux, policiers corrompus, prostituées alcooliques et fonctionnaires dévoyés. Un brûlot à charge, durant les 2h 40 du film, pour dénoncer cette Russie dévoyée et arriérée.
On sort de la salle obscure lessivé par cette ‘’opposition entre un individu et la machine de l’Etat arbitraire’’, comme le dit le cinéaste. On vit un véritable cauchemar éveillé : en effet, chaque initiative de l’héroïne, chacune de ses démarches l’enfonce un peu plus dans les sables mouvants de l’administration pénitentiaire. On y découvre une relecture russe de Kafka ou du mythe de Sisyphe ; on balance entre Dostoïevski et Fellini, avec une cascade de scènes imprévisibles, avec des rebondissements qui mettent en relief les richesses du 7e Art : avec des images d’une grande beauté, du rêve, de l’humour et une forme d’onirisme. Retenons une mention particulière pour Oleg Mertu, excellent directeur de la photographie. Vasilina Makovtseva, en femme de la campagne, s’en sort très bien, pratiquement sans parler ; ce mutisme, renforcé par une absence de nom et de prénom pour elle, propulse Une femme douce dans un univers de radicalisme et de nihilisme absolu. L’homme est toujours bien un loup pour l’homme ! C'est ainsi que Sergei Loznitsa, documentariste et cinéaste, regarde la Russie, où chacun se débrouille comme il peut, entre corruption, envie de vivre, crimes et besoin d'affection. La lumière, rare, n'y est pas éteinte. C’est un des grands films de cette rentrée, injustement revenu bredouille du Festival de Cannes. Il n'y a rien à délaisser dans cet impressionnant portrait d'une femme à la recherche de son homme dans ce pays dévasté, qui part en vrille et en vodka. Mais il y a surtout des "moments" de cinéma comme on n'en voit peu, qui ne cherchent pas la virtuosité technique mais tirent leur force d'une apparente simplicité. Par exemple, quand la "femme douce" entre dans le ‘’cabinet’’ d'une avocate, défenseuse des droits de l'homme, et qu'elle tente de la convaincre de l'intérêt de défendre son mari. Serguei Loznitsa filme cette scène en plan-séquence, dans une pièce exiguë, une conversation décousue, des mouvements épars, une tension palpable. Il ne s'y passe rien et il s'y passe absolument tout : l'humanité vacillante mais qui relève la tête, la réalité chaotique et incohérente, la solitude des êtres, la compassion nécessaire quand l'aide est impossible. Le film recèle plusieurs de ces moments ; par exemple encore, dans une scène de beuverie enchantée, qui se clôt sur un procès onirique qui ferai penser à une scène imaginée par Kafka et Fellini ensemble !
Documentariste puissant (on l’a vu dans Maidan, 2014), parfois un peu brumeux (My Joy, 2010), Serguei Loznitsa atteint là un sommet d'un cinéma politique et réaliste. Personne n'en sort indemne.
Septembre 2017 Jn.- C. Faivre d’Arcier
400.000 hommes ont eu le choix entre se soumettre ou être anéantis.
DUNKERQUE
Film franco-anglo-américain de Christopher Nolan -2017
 Il y a 77 ans, une bataille historique de la Seconde Guerre Mondiale se déroulait à Dunkerque. Un fait assez méconnu que Christopher Nolan a choisi de raconter… 1940, Nord de la France. Tommy est un jeune soldat de l’armée britannique posté sur la plage de Dunkerque avec 400 000 compagnons d’armes, dans l’attente d’une évacuation par la mer pour rentrer au pays. Encerclés par les Allemands, ils n’ont aucune échappatoire sinon l’arrivée des destroyers que Churchill leur a promis. Ils ignorent que leurs compatriotes ont décidé de leur prêter main forte. Ainsi, ils sont des centaines de civils à braver les éléments pour effectuer la traversée de la Manche à bord de bateaux de plaisance afin de les secourir. Parmi eux, Mr Dawson vogue avec son fils au péril de leur vie. Tandis que des avions Spitfire de la Royal Air Force quadrillent inlassablement la zone pour mettre hors d’état de nuire les bombardiers de la Luftwaffe. Farrier, pilote chevronné, n’abandonnera jamais les siens…
Il y a 77 ans, une bataille historique de la Seconde Guerre Mondiale se déroulait à Dunkerque. Un fait assez méconnu que Christopher Nolan a choisi de raconter… 1940, Nord de la France. Tommy est un jeune soldat de l’armée britannique posté sur la plage de Dunkerque avec 400 000 compagnons d’armes, dans l’attente d’une évacuation par la mer pour rentrer au pays. Encerclés par les Allemands, ils n’ont aucune échappatoire sinon l’arrivée des destroyers que Churchill leur a promis. Ils ignorent que leurs compatriotes ont décidé de leur prêter main forte. Ainsi, ils sont des centaines de civils à braver les éléments pour effectuer la traversée de la Manche à bord de bateaux de plaisance afin de les secourir. Parmi eux, Mr Dawson vogue avec son fils au péril de leur vie. Tandis que des avions Spitfire de la Royal Air Force quadrillent inlassablement la zone pour mettre hors d’état de nuire les bombardiers de la Luftwaffe. Farrier, pilote chevronné, n’abandonnera jamais les siens…
C’est le récit d’une évacuation enfouie dans la mémoire collective, un sauvetage des troupes alliées à Dunkerque, qui a été mis au grenier de l’Histoire. Peut-être victime de la formidable médiatisation du débarquement en Normandie quatre ans plus tard ? Curieusement, la plage de Dunkerque restait donc méconnue… Aussi Christopher Nolan a-t-il voulu mettre en images cette fresque épique et historique, bien éloignée de ses films précédents Interstellar et la trilogie The Dark Knight. Résultat : une ‘’débarquement à l’envers’’, un fait de guerre peu glorieux, le rembarquement en 9 jours de 400.000 soldats anglais et français vers la Grande-Bretagne. Ce que l’on a appelé ‘’l’Opération Dynamo’’.
De la déconfiture à l’héroïsme
Évidemment, Nolan ne pouvait proposer une narration linéaire de cette histoire. Il a donc misé sur la grande Histoire qui sert de cadre à l’aventure de simples individus, de très jeunes soldats britanniques, joués par des acteurs inattendus dans ces rôles. Un attachant Fionn Whitehead, la fleur au fusil et du sable plein les cheveux, ou Harry Styles, un membre du Boys Band ‘’One Direction’’, coincés sur la plage. Ils sont encadrés par des acteurs plus matures, comme Tom Hardy, en aviateur au ras de l’eau et Mark Rylance, en civil impliqué dans le sauvetage.
Des récits différents, illustrant des points de vue du sauvetage, des passerelles, la vie entre la trouille et le rêve, la débandade et l’héroïsme. Pour mettre en scène cette déconfiture transformée en héroïsme, sur la plage, dans les airs, il fallait des moyens colossaux ; d’autant que Nolan souhaitait éviter le tout numérique et privilégier les images réelles, avec des effets spéciaux de terrain. Un savant dosage entre soldats de carton, bateaux de guerre et avions réels. La production a même acheté un bombardier d’époque pour 5 millions d’euros, afin de rendre plus crédibles les crashs.
Le film est esthétiquement réussi avec des plans aériens spectaculaires. L’armée de figurants, les plages réquisitionnées comme Malo-les-Bains pendant 24 jours, les images dans l’eau, n’ont rien à envier aux grandes manœuvres du Jour le plus long ou de Stalingrad. On est frappé au cœur par ces jeunes hommes au courage incroyable face à l’adversité, par ces idéaux souvent ringardisés et que Nolan a eut le talent de remettre au goût du jour. Bien plus que le goût âcre du sang, de la boue et du sable, c’est la détermination pour atteindre la victoire, par tous les moyens, que nous gardons de ce spectacle ébouriffant et spectaculaire.
Dunkerque, le dixième long métrage de Christopher Nolan, est exceptionnel. On savait le goût du réalisateur anglais pour les concepts bousculant les conventions. Il persiste et signe aujourd’hui son projet le plus ambitieux. Immersion totale dans le chaos d’un des épisodes méconnus de la Seconde Guerre mondiale avec un parti pris passionnant : filmer le destin de trois personnages sur terre, en mer et dans les airs, en observant des temporalités différentes, respectivement une semaine, un jour et une heure. Évidemment, les trajectoires vont se croiser. Le spectateur est embarqué le cœur battant dans cette course contre la montre, rythmée par le tic-tac incessant de la propre montre à gousset du cinéaste qui installe une atmosphère terriblement anxiogène. Tout se joue avec une musique omniprésente qui couvre d’un voile inquiétant le destin de ces hommes. Il n’y a pas une goutte de sang, mais on assiste à un carnage.
Commentant son film, Christopher Nolan a dit : ‘’La Seconde Guerre mondiale me tient à cœur; mon grand-père est mort pendant le conflit. Il n'était pas à Dunkerque, mais cette bataille est profondément ancrée dans la culture britannique. Pourtant, le cinéma l'a peu traitée… C'est une défaite victorieuse au suspense insoutenable. 400.000 hommes ont le choix entre se soumettre ou être anéantis. C'est l'une des histoires les plus intéressantes qu'ait connues l'humanité. Si l'évacuation n'avait pas été un succès, le monde serait probablement complètement différent d'aujourd'hui’’.
Septembre 2017 Jn.- C. Faivre d’Arcier
Ce film allie émotion et surprise, romance et intelligence galactique.
VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES
Film français de Luc BESSON – 2017
 Alpha au 28e siècle, la Cité des mille planètes, accueille 17 millions d’habitants, d’âges et d’horizons différents, qui ont vécu en harmonie pendant des siècles. Une force inconnue veut détruire cet équilibre lentement construit. Le commandant Arün Filitt charge Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels chargés de trouver l’origine de cette menace et d’éradiquer celle-ci. A bord de leur vaisseau, l’Intruder, le duo se lance dans cette mission périlleuse… Valérian et la Cité des mille planètes marque le retour de Luc Besson, trois ans après Lucy. Adapté de la BD de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, le film a été tourné avec un budget colossal de 170 millions d’euros, devenant ainsi la plus grosse production du réalisateur français. Le résultat est, comme on pouvait l’espérer, spectaculaire.
Alpha au 28e siècle, la Cité des mille planètes, accueille 17 millions d’habitants, d’âges et d’horizons différents, qui ont vécu en harmonie pendant des siècles. Une force inconnue veut détruire cet équilibre lentement construit. Le commandant Arün Filitt charge Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels chargés de trouver l’origine de cette menace et d’éradiquer celle-ci. A bord de leur vaisseau, l’Intruder, le duo se lance dans cette mission périlleuse… Valérian et la Cité des mille planètes marque le retour de Luc Besson, trois ans après Lucy. Adapté de la BD de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin, le film a été tourné avec un budget colossal de 170 millions d’euros, devenant ainsi la plus grosse production du réalisateur français. Le résultat est, comme on pouvait l’espérer, spectaculaire.
Luc Besson est un amoureux de la BD Valérian qu’il dévorait dans le magazine Pilote, au début des années 1970. Lorsqu’il travaille plus tard avec ses auteurs sur Le Cinquième Élément, on lui avait demandé s’il n’avait pas envie de transposer Valérian au cinéma. Besson rejeta à l’époque cette idée car il estimait que la technologie en matière d’effets spéciaux et la réalisation n’étaient pas au point. Comment représenter en effet cet univers rempli de dizaines d’humains et de centaines d’aliens ? Mais plus tard, tout bascule quand Luc Besson visionne Avatar. Il va tout reconsidérer, faire table rase des scripts antérieurs et s’engouffrer dans un chemin ouvert par James Cameron : recréer la BD et 3D, marier le 7e et le 9e art !
Son nouveau bond technologique lui coûte très cher : 197 millions d’euros, le plus gros budget de l’histoire du cinéma français ! Mais besson balaie les risques d’un revers de la main, en disant : ‘’Il y a plein de peintres fauchés dont les toiles sont au Louvre’’… Après avoir sélectionné par concours, des graphistes et des costumiers, Besson ébauche un univers graphique du monde de Valérian. Au cours du tournage, Pierre Christin et Jean-Claude Mézières sont invités à s’installer dans le vaisseau l’Intruder. Les deux héros du film, Cara Delevigne et Dan Dehaan viennent les saluer. La vie cinématographique de Valérian débutait. Luc Besson avoue avoir déjà écrit les Opus 2 et 3, rêvant probablement d’une épopée à la Stars War. Il a tout mis dans son film : 7 ans de travail d’adaptation, 2734 effets spéciaux, 7 mois de tournage à 90% virtuel dans sa Cité du Cinéma de Saint-Denis. On en a plein les yeux, les effets spéciaux sont époustouflants ; certaines séquences ont demandé des mois de travail. On remarque aussi l’esthétique très artificielle des paysages qui font penser aux jeux vidéo ou les plans incroyables du vaisseau Intruder. On passe d’une course-poursuite à des lieux paradisiaques en une fraction de seconde, on croise des extra-terrestres au réalisme saisissant. Mais on découvre aussi un univers plus fort et des personnages plus soignés que dans les films précédents de Luc Besson. On a surtout l’impression que chaque séquence contient une créature ou un concept jamais vus auparavant ! Le film allie émotion et surprise, romance et intelligence galactique. Au départ, on est scotché sur son siège avec cette nouvelle expérience en 3D qu’il faut voir sur le plus grand écran possible. Un public avide de science-fiction devrait se bousculer dans les salles.
Valérian et la Cité des mille planètes sonne les retrouvailles du réalisateur avec le genre qu'il affectionne sans doute le plus : le space-opera. Il y a vingt ans, Le Cinquième élément faisait de lui un cinéaste majeur sur le plan international car le film avait su marquer de son empreinte toute une époque. Aujourd'hui, aucun réalisateur français n'est de taille à rivaliser avec lui du point de vue des moyens mis à sa disposition. Et il est vrai que le film de Besson regorge d'idées et d'effets spéciaux impressionnants et imaginatifs. A ce titre, la séquence d'ouverture sur un marché à ‘’univers parallèles’’ est assez imposante. Pourtant, si l'on exclut quelques bonnes séquences, le long métrage ne peut se départir d'un scénario et d'une narration qui ne brillent pas par leur originalité. On regrette par exemple qu'il manque à ce space-opera une scène de combats dans les étoiles digne de ce nom et qu'au contraire, certaines séquences inutiles, seulement à la gloire de leurs stars (Rihanna chante bien, mais n’apporte rien au film) n'aient pas été coupées au montage. Simple, presque enfantin sur le fond, le film est visuellement ébouriffant : plans d’une richesse et d’une inventivité folle, bestiaire foisonnant, effets spéciaux ahurissants. Et pourtant, à mille lieux des blockbusters hollywoodiens formatés, Luc Besson va au bout de son rêve de gosse avec cette odyssée de l’espace délirante et joyeuse.
Mais, tout bien considéré, l'ennui finit par gagner, tandis que nos yeux cherchent à saisir la beauté des images qui nous sont proposées. Décors, costumes, ambiances tour à tour, mystérieuses et sombres, ou idylliques et paradisiaques tentent de nous amadouer, mais à la longue ça ne suffit plus ! Il manque le ressort indispensable du comique pour changer de rythme en nous amusant de temps à autre, ce qui aurait pu apporter une distanciation et un peu de légèreté à l'ensemble. Un peu d'espièglerie, d'autodérision ne font jamais de mal au cinéma, bien au contraire, un peu comme le sel et le poivre à la cuisine !...Sinon, autant revoir le bon vieux Cinquième Élément qui offrait plus de souffle, et surtout davantage d'humour ! Luc Besson semble constamment hésiter entre le divertissement pur et la fable philosophique à tendance humaniste, par essence moins spectaculaire. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à lier ces deux ambitions, laissant ainsi le spectateur faire le grand écart entre des moments d'intense jubilation visuelle (la première demi-heure, notamment, avec les décors à la Yves Tanguy de la planète Mül et le Big Market) et des trous noirs d'ennui (la plupart des scènes dialoguées), le tout sur une partition de Desplat qui devrait concourir pour l'Oscar de la Musique La Plus Envahissante !
Septembre 2017 Jn.- C. Faivre d’Arcier
Song to Song, dresse un portrait doux-amer de l’amour
SONG TO SONG
Film américain de Terrence MALICK – 2017
 A Austin, au Texas, le Festival South by Southwest, où se retrouvent régulièrement les grands noms du rock, bat son plein. C’est dans cet environnement fiévreux que se croisent les destinées de deux couples : Faye et le chanteur BV, et Cook, magnat de l’industrie musicale, qui séduit Rhonda, une serveuse… L’idée de Song to Song a germé dans l’esprit de Terrence Malick alors qu’il travaillait encore sur The Tree of Life. Le réalisateur a une nouvelle fois réussi un casting des plus prestigieux pour cette histoire d’amour. Il n’y a pas que des stars de cinéma, mais aussi de grands noms de la chanson comme Patti Smith, Lykke Ly ou Florence Welch, qui font une apparition à l’écran.
A Austin, au Texas, le Festival South by Southwest, où se retrouvent régulièrement les grands noms du rock, bat son plein. C’est dans cet environnement fiévreux que se croisent les destinées de deux couples : Faye et le chanteur BV, et Cook, magnat de l’industrie musicale, qui séduit Rhonda, une serveuse… L’idée de Song to Song a germé dans l’esprit de Terrence Malick alors qu’il travaillait encore sur The Tree of Life. Le réalisateur a une nouvelle fois réussi un casting des plus prestigieux pour cette histoire d’amour. Il n’y a pas que des stars de cinéma, mais aussi de grands noms de la chanson comme Patti Smith, Lykke Ly ou Florence Welch, qui font une apparition à l’écran.
Étonnant cinéaste que ce Terrence Malick, légende aussi vivante que silencieuse, qui, à 73 ans, livre son 9e long métrage. Après une période d’extrême rareté – quatre films en 32 ans, dont Les Moissons du ciel et La Ligne rouge –, le réalisateur a entrepris de se réinventer. Depuis le début des années 2010, il livre – cette fois à un rythme beaucoup plus élevé – de longs poèmes filmiques qui lui ont valu à la fois admiration et sarcasmes.
En 2017, Terrence Malick nous aura offert deux beaux bijoux. Le premier, Voyage of Time : au fil de la vie, présentait l’épopée magique d’une existence, une ode à la vie et à la science. Le second, Song to Song, dresse un portrait doux-amer de l’amour, incarné sous toutes ses formes qu’il soit multiple ou égocentrique. L’amour est abordé dans l’art depuis des millénaires. Comme un manifeste, le titre (‘’Chanson après chanson’’) évoque, dans un style lyrique, la discontinuité des expériences humaines. Tantôt platonique ou fraternel, tantôt charnel et sensuel, il a été l’ancrage de nombre d’auteurs fertiles. Parmi tous les cinéastes du XXIème siècle, Terrence Malick est peut être celui qui comprend le mieux l’amour en l’appréhendant dans toute son âpreté, dans toute sa violence, comme Truffaut l’avait fait avant lui. En présentant les guerres internes de deux amants chez qui la haine et l’amour se mêlent, le cinéaste américain tisse une véritable tragédie antique autour de personnages aux destins trop vrais pour être beaux.
Comme à son habitude, Malick prend le temps de capter ses propres personnages. Plutôt que d’opter pour des scènes d’exposition classiques, il s’émancipe de toute règle et découvre, avec le spectateur, les héros de son histoire. Dans la peau de ces êtres tourmentés, on sent des acteurs qui ne le semblent pas moins. Ryan Gosling balade avec une nonchalance teintée de mélancolie ses yeux bleus et sa figure d’ange. Face à lui, un Michael Fassbender à la virilité fragile, propose un jeu d’équilibre intéressant, sous forme de Yin et de Yang inconscient. Les personnages féminins mêlent intensité et tendresse. Natalie Portman retrouve la dureté de son Black Swan sombrant dans la folie, tandis que la talentueuse et discrète Rooney Mara dresse un portrait éthéré de l’amour, sous sa forme la plus délicate.
Avec sa réalisation, quasi documentaire, Terrence Malick nous transporte une nouvelle fois dans un monde à la fois proche et distant, où les sentiments humains prennent une intensité rare et se transforment en torrents d’émotions. Song to Song est une nouvelle variante de ce travail d’exploration aussi bien formel que spirituel. L’irrésolution amoureuse de l’homme et de la femme est à nouveau présente, tout comme l’aveuglement intérieur des êtres, aimantés par le pouvoir, la richesse, la beauté, la célébrité, mais incapables de regarder en face les tréfonds de leur âme.
Song to Song apporte cette nouveauté que les femmes trouvent enfin une vraie place dans le chœur des amours déçues. Faye (Rooney Mara) est d'ailleurs le plus beau personnage du film, le plus complet, aussi, quand les autres restent davantage des esquisses. Dans la droite lignée de ses œuvres produite après Tree of life, Terrence Malick réalise ici un long-métrage où les sensations, les souvenirs, l'intériorité des personnages priment sur la linéarité du scénario. Si la partie centrale de Song to Song, abordant les thématiques de l'amour, de la mainmise de l'argent dans l'art et des rapports dominés-dominants dans la société, est captivante, force est de constater que son film est trop long, et mériterait d'être amputé d'une trentaine de minutes. Se déroulant autour de la scène musicale d'Austin au Texas, le film bénéficie d'un casting de haut vol (Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbinder, Natalie Portman, Cate Blanchett,...) et se paye le luxe de faire participer quelques stars du rock, tels Iggy Pop ou Patti Smith, pour notre plus grand plaisir.
Septembre 2017 Jn.- C. Faivre d’Arcier
Portrait d’une jeunesse qui refuse de se laisser enfermer
Pendant près d’une heure quarante, on reprend confiance dans l’humanité.
A voix haute : la force de la parole
Documentaire français de Stéphane de Freitas et Ladj Ly
 Prendre la parole et donner de la voix pour changer de vie, c’est le sens des concours ‘’Eloquentia’’ auxquels participent chaque année des étudiants des Universités de Saint-Denis et de Nanterre, venant de tous les cursus. L’objectif est d’élire le meilleur orateur du 93. Aidés par des avocats, des metteurs en scène ou encore des clameurs, les participants se préparent durant des semaines, en apprenant autant sur eux-mêmes que sur les lois de la rhétorique. Portrait d’une jeunesse bien dans ses baskets, qui refuse de se laisser enfermer et qui lutte contre la fatalité par les mots, à l’image de Leïla, Elhadj ou Eddy. Le documentaire A voix haute, vient de sortir en salles après une première diffusion remarquée en novembre 2016 sur France 2. Il met en scène le pouvoir des mots et les capacités créatrices de la parole qui permet de se trouver soi-même. Un pur moment de bonheur et d’espoir offert par des jeunes qui ont décidé d’exister par le pouvoir des mots.
Prendre la parole et donner de la voix pour changer de vie, c’est le sens des concours ‘’Eloquentia’’ auxquels participent chaque année des étudiants des Universités de Saint-Denis et de Nanterre, venant de tous les cursus. L’objectif est d’élire le meilleur orateur du 93. Aidés par des avocats, des metteurs en scène ou encore des clameurs, les participants se préparent durant des semaines, en apprenant autant sur eux-mêmes que sur les lois de la rhétorique. Portrait d’une jeunesse bien dans ses baskets, qui refuse de se laisser enfermer et qui lutte contre la fatalité par les mots, à l’image de Leïla, Elhadj ou Eddy. Le documentaire A voix haute, vient de sortir en salles après une première diffusion remarquée en novembre 2016 sur France 2. Il met en scène le pouvoir des mots et les capacités créatrices de la parole qui permet de se trouver soi-même. Un pur moment de bonheur et d’espoir offert par des jeunes qui ont décidé d’exister par le pouvoir des mots.
Les visages qui peuplent ce film ne s’oublient pas car ils se transforment au fil des images. On les voit se chercher autant qu’ils cherchent leurs mots et, en se trouvant eux-mêmes, ils trouvent le chemin vers nous. A voix haute est signé par Stéphane de Freitas, qui est aussi le fondateur de la coopérative Indigo, l’association qui organise les concours ‘’Eloquentia’’ et la formation, dispensée par des avocats, des comédiens et des poètes. S’il a décidé de créer ces concours d’éloquence en Seine-Saint-Denis, c’est parce qu’il y a lui-même grandi, avant d’être sélectionné dans la section sport-études d’un lycée parisien et d’y ressentir un vrai décalage culturel, ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir un master de droit et un diplôme de l’ESSEC. A travers ce film, il délivre un message optimiste, une bouffée d’air frais, un hommage au beau discours et au dialogue. Ce film est à conseiller aux adolescents qui doutent d’eux-mêmes.
Stéphane de Freitas a accordé un entretien à Orianne Charpentier pour le journal ‘’Paris Mômes’’. Elle lui demandait pourquoi il avait créé ces concours d’éloquence ? ‘’Les mots, c’est un outil. Cela permet de ne pas s’emmmurer. J’ai créé ‘’Eloquentia’’ avec des gens que j’ai moi-même rencontrés au cours de mon parcours : je voulais qu’il y ait une formation à la prise de parole en Seine-Saint-Denis pour contribuer à faire entendre cette jeunesse, dite ‘’de banlieue’’, une jeunesse brillante mais sous-estimée qui a, à mon avis, un rôle fondamental à tenir dans la construction du monde de demain.
Cette formation propose 60 heures de formation, pendant 6 semaines. Elle rassemble 30 étudiants de l’Université de Saint-Denis et 30 autres de l’Université de Nanterre. Au total, 450 jeunes en bénéficient chaque année. On est en train d’adapter la méthode et les exercises à un public plus jeune de collégiens. Cette formation vise 5 objectifs : d’abord l’introspection – on demande à chacun de réfléchir à ce qu’il a envie de défendre, ce qui le révolte, ce qui le touche ; ensuite la structuration de la pensée – avant de parler, il faut écrire, développer un argumentaire. Puis on travaille le rapport aux autres, le regard, la posture du corps, la respiration, la gestion des émotions. Puis, la créativité – on invite les jeunes à écrire en alexandrins, de discuter de n’importe quel sujet, de défendre un point de vue. Enfin, il y a l’accompagnement personnel pour aider les jeunes à aller au bout de leurs ambitions personnelles.
- Votre film est un vrai pladoyer pour les mots, la parole. Pourquoi est-ce si important pour vous ?
- Les mots, c’est le dialogue, la langue, le socle de toute société. La parole est la première étape du vivre ensemble. Je n’en pouvais plus d’entendre le dialogue social réduit aux petites formules pour frapper les esprits, quitte à tout rétrécir. Bref, j’avais envie de créer un espace de discussion ouvert. C’est cela qui a amené à la création d’Eloquentia. Les trois impératifs de la formation sont le respect des autres, l’écoute active et la bienveillance. Pour résumer : ce n’est pas parce qu’on n’est pas d’accord sur certains sujets qu’on ne peut pas vivre ensemble. J’ai remarqué, pour ma part, qu’en apprenant à maîtriser les mots, j’ai eu plus d’assurance et de confiance en moi. C’est la clef : avoir confiance en soi pour aller au bout de ses rêves’’.
Enfin un film positif dont les héros sont des jeunes de banlieue ! Avec À voix haute, la force de la parole, Stéphane de Freitas et Ladj Ly dévoilent un pan méconnu de la Seine-Saint-Denis. Grâce à l’association Eloquentia que le premier a créée il y a cinq ans, ‘’ce film donne une image qui va à contre-courant de celles qui sont véhiculées habituellement sur les banlieues’’, précise Stéphane de Freitas. ‘’Il y a 50 000 étudiants sur un très petit périmètre, pour moitié à l’université de Saint-Denis et pour moitié à celle de Villetaneuse’’. Mû par un esprit militant et par sa passion du cinéma, pour son premier long-métrage, Stéphane de Freitas s’est intéressé à une réalité qu’il connaît bien. Les jeunes ont applaudi le film car ils s’y sont sentis respectés’’.
Ce film est magnifique : les jeunes inventent un langage neuf, font fuser une poésie inattendue, créent des mots et des rythmes, loin des clichés. L’émotion qui se dégage de ce documentaire sans fioritures est incroyable. Pendant près d’une heure quarante, on reprend confiance dans l’humanité.
Juin 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Quand les femmes ne peuvent pas vivre sans les hommes
UNE FAMILLE HEUREUSE
Film géorgien de Nana EKVTIMISHVILI – 2017
 Manana, professeure dans un lycée de Tbilissi, semble mener une vie heureuse avec Soso, son mari depuis 25 ans. Ses parents, leurs deux enfants et leur gendre habitent dans leur appartement. Un bonheur sans nuage en apparence. Mais en fait, Manana étouffe et veut trouver sa liberté. Le soir de son 52e anniversaire, elle annonce qu’elle va partir, pour vivre seule dans un autre appartement. Sa famille accueille la nouvelle avec consternation … Le duo de cinéastes Nana Ekvtimishvili et Simon Gross, son compagnon, réalisent avec Une famille heureuse, leur second long-métrage. Le film a été sélectionné dans des festivals prestigieux comme Sundance, la Berlinade et le Festival International du film à Sofia.
Manana, professeure dans un lycée de Tbilissi, semble mener une vie heureuse avec Soso, son mari depuis 25 ans. Ses parents, leurs deux enfants et leur gendre habitent dans leur appartement. Un bonheur sans nuage en apparence. Mais en fait, Manana étouffe et veut trouver sa liberté. Le soir de son 52e anniversaire, elle annonce qu’elle va partir, pour vivre seule dans un autre appartement. Sa famille accueille la nouvelle avec consternation … Le duo de cinéastes Nana Ekvtimishvili et Simon Gross, son compagnon, réalisent avec Une famille heureuse, leur second long-métrage. Le film a été sélectionné dans des festivals prestigieux comme Sundance, la Berlinade et le Festival International du film à Sofia.
Dans une société patriarcale comme la Géorgie, il est couramment admis que les femmes ne peuvent pas vivre sans les hommes, que sans eux elles seraient moins respectées, moins protégées et dans une plus grande précarité. C’est en partie vrai, non parce que les femmes vaudraient moins que les hommes, mais parce que certaines d’entre elles considèrent qu’elles valent moins. Ainsi, cette manière de penser s’impose comme la norme auprès de beaucoup. Suite à la disparition de l’Union Soviétique, il y a eu un véritable retour en force de la religion, les gens pouvant enfin assumer librement leur foi. Aujourd’hui encore, l’Eglise orthodoxe accepte que les femmes aient moins de droits que les hommes, qu’elles soient moins respectées au sein de la société ou de la famille. Les homélies, que beaucoup suivent aveuglément, placent clairement l’homme à la tête de la famille et font de la femme sa subordonnée.
La condition de la femme en Géorgie relèverait aussi de la culture du pays, de ses traditions héritées du temps passé. Ceci est d’ailleurs un argument très souvent utilisé dans les débats publics. Alors qu’elle a vécu toute sa vie entourée des siens, Manana décide à 52 ans de vivre pour et par elle-même. Elle agit selon sa propre conscience, sans en rendre compte à personne ; elle ne donne pas d’explication à son geste. Le film aborde aussi la question de la condition féminine sous l’angle générationnel. La mère de Manana n’a jamais pu faire ce qu’elle voulait dans la vie ; du coup, elle n’a jamais incité sa fille à vivre autrement. De son côté, Manana dialogue plus librement avec sa fille et la pousse à agir différemment, à ne pas faire les mêmes erreurs qu’elle a pu connaître dans sa jeunesse. Ces trois personnages féminins représentent en fait trois générations de femmes dans la Géorgie d’aujourd’hui.
La famille, en tant que dynamique de groupe, est également présente au cœur du film. Les Géorgiens ont l’habitude de vivre au cœur de leurs familles, d’être extrêmement liés les uns aux autres. Cette vie communautaire est très naturelle pour eux, même si cela n’est pas sans conséquences sur le plan économique et social et sur le plan de l’épanouissement personnel. Personne n’a vraiment d’intimité en Géorgie, la famille entière pèse de son influence sur les choix de chacun de ses membres. A la différence des schémas sociétaux européens qui privilégient l’individu, la vie en communauté est partie intégrante de la culture géorgienne. De fait, il faut énormément de force et de courage pour prendre ses distances avec sa famille et vivre selon ses propres valeurs. C’est ce que montre très clairement le film.
‘’Notre objectif en tant que cinéastes n'est pas de porter un jugement, mais simplement de donner vie à nos personnages et ainsi de permettre au public de passer un peu de temps au sein d'une famille géorgienne’’, préviennent la Géorgienne Nana Ekvtimishvili et son couable de finesse et d'humour.
Une famille heurese, bel euphémisme, est le portrait sensible d’une mère courage, d’une femme au bord de la crise de nerfs, qui lutte pour apprendre le bonheur de respirer, de lire, d’écouter de la musique et de contempler, depuis son balcon, le frémissement des arbres au printemps. C’est un éloge de la fuite et un hymne à une seconde vie, possible loin des siens. Avec, dans lmpagnon allemand, Simon Gross. Évidemment, le titre de leur long-métrage, Une famille heureuse, dément le propos remarqe rôle de Manana, une remarquable comédienne (Ia Shugliashvili) au physique de tragédienne, dont le mutisme et la détresse, la patience et la douceur sont bouleversants. ‘’Nous avons commencé le casting plus d’un an avant le tournage. Ia a été l’une des premières comédiennes que nous avons rencontrée et elle nous a immédiatement frappés par sa force et son naturel. Elle s’est imposée à nous comme une évidence. Au fil des rencontres, nous avions le sentiment qu’elle était chaque fois un peu plus liée à Manana’’.
Manana veut pour vivre. Elle part pour se forger une existence qui lui convienne, sans du tout envisager de briuser les liens profonds qui l’attachent aux siens. Pour elle, le postulat se tient tout entier dans ces termes qui réfutent explications et bilans. Les secousses provoquées par son attitude vont se trouver enflées ou atténuées selon le degré de compréhension de chacun, selon son positionnement dans le réseau des codes et despartir affects. On convoquera le ban et l’arrière-ban des aïeux et alliés pour tenter de la dissuader du péril qu’encoure forcément une femme qui prétend se couper de la communauté. Toutes sortes d’épisodes de la vie familiale ramèneront Manana dans le cercle familial qu’elle n’a jamais souhaité déserter. Une grande part de l’originalité du film réside dans ses angles d’approche. Ce n’est pas le récit d’une conquête contre les siens. L’observation fine de Manana nous conduit à découvrir les signes d’une paix qui se construit en conformité avec ce qu’elle est, en restant ouverte à l’inattendu : le plaisir d’un sourire au marché de son nouveau quartier, la joie qu’ensoleillent les retrouvailles avec une amie devenue fromagère, les oiseaux par la fenêtre de l’appartement qu’elle a dû nettoyer de fond en comble, une petite omelette accompagnée d’un verre de vin sur la table où cette enseignante corrige ses copies, un livre ouvert sur son fauteuil, le bruit du vent dans les arbres. Tous ces petits riens dessinent le personnage, mais ne le résument pas. Manana est une femme qui travaille à la conquête de sa nouvelle liberté. Les larmes de sa fille, qu’elle pousse à l’émancipation, la bouleversent. Le choc d’un gros chagrin conjugal rétrospectif la fait vaciller. Les deux réalisateurs parviennent à convertir les épisodes épars de ce cheminement en moments émouvants et éclairants. Cet édifice en construction donne à voir des pans de la société dans laquelle les personnages sont ancrés. Ce qui a été mis en route ne reviendra pas à son point de départ. Contrairement à ce que dit l’adage, une porte n’est pas ouverte ou fermée.
‘’Tu étais ma rose tu es devenu mon chagrin/ Tu m’évites et tu gardes tes distances/ S’il te plaît dis-moi si tu as trouvé meilleure que moi’’, chante Manana en écho à son amour déçu. En retrouvant la famille avec ses passions, ses tensions, ses traditions et ses transgressions, l’appartement charmant tout de guingois, la musique et les chants, la beauté des rapports humains, la grande humanité des auteurs, incarnée de manière particulièrement touchante et délicate par la bande d’acteurs géniaux qui participent à ce nouveau film, on retrouve nous aussi le bonheur, la délicatesse, la justesse, l’émotion... Les chansons qui ponctuent l’histoire sont plus belles les unes que les autres. On pourrait n’aller voir Une famille heureuse que pour sa musique. Il me semble impossible de ne pas être ému par cette histoire si bien racontée, celle d’une femme qui traverse une épreuve morale terrible pour s’émanciper, mais de manière intérieure et subtile, tout en ménageant les autres, en leur conservant son amour et sa patience. A travers l’histoire de cette femme et de sa famille, la Géorgie nous apparaît proche et familière malgré son éloignement. Du beau cinéma !
Juin 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
« Sans le pardon, la famille devient malade…’’ Le pape François
APRES LA TEMPETE
Film japonais de Kore-Eda HIROKAZU - 2016
 Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble…
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble…
Au Japon, le titre du film est ‘’Umi yorimo Mada Fukaku’’, c’est-à-dire ‘’Au plus profond de la mer’’. Ces quelques mots proviennent d’une chanson populaire asiatique, intitulée Wakare no Yokan que Hirokazu Kore-Eda écoutait beaucoup. Le réalisateur a eu l’idée de faire ce film après la mort de son père, lorsque sa mère a dû aller vivre seule dans une cité HLM. Il est donc revenu tourner à Tokyo, où il a passé 20 ans de sa vie.
Le cinéaste japonais Hirokazu Kore-Eda est l'un des grands portraitistes du cinéma contemporain. Sans jamais forcer le trait, il détaille par petites touches la psychologie de ses personnages, leurs fêlures et leurs difficultés à exprimer leurs sentiments. Son art sensible a été récompensé au Festival de Cannes par le prix du jury pour Tel père, tel fils, son film le plus connu. Après la tempête nous emmène à la suite de cet anti-héros attachant, Ryota, écrivain raté en perpétuelle quête d'inspiration, qui cherche à reprendre la place de père qu'il a perdue au sein de sa famille. On est saisi par la profonde humanité des personnages, la modestie et la fluidité d'une mise en scène qui enregistre la vie quotidienne dans toute sa complexité émotionnelle.
Après la tempête a été présenté comme un film mineur dans la filmographie du cinéaste, peut-être parce que les émotions y sont moins affirmées qu'à l'accoutumé et que la narration semble moins élaborée que dans ses films précédents. Hirokazu Kore-Eda y dit pourtant des choses essentielles sur la transmission et les responsabilités qui reposent sur les pères de famille. Mais il ne faut surtout pas imaginer un film machiste ou misogyne, bien au contraire. Alors qu’il avait mis en scène la démission d'une mère dans Nobody Knows, il signe ici deux très beaux portraits de femme, avec une irrésistible Kirin Kiki dans le rôle de la grand-mère prête à tout pour le bonheur de sa famille.
De Nobody Knows à Notre petite sœur, en passant par le poignant Tel père, tel fils, Hirokazu Kore-Eda a décrit de délicats drames familiaux, montrant les tourments de la cellule traditionnelle japonaise, écartelée entre tradition et modernité, respect des liens sacrés et velléités d’indépendance et de liberté. Ce film n’échappe pas à la règle. Sans recourir au sentimentalisme, le cinéaste procède par petites touches pour cerner ce père de famille ‘’looser’’, dépassé par les événements. Écrivain raté, végétant dans une agence de détectives privés avec un détachement désabusé, Ryota est prêt à tout pour reconquérir l’estime voire l’affection de son ex-épouse et garder la complicité avec un fils partagé entre ses deux parents dont les liens semblent s’être définitivement dénoués.
Nul pathos, ni aucune psychologie facile dans ce récit en demi-teinte qui retrouve dans ses meilleurs moments la grâce des grands maîtres du cinéma japonais que furent Ozu et Naruse. Le dépouillement de la mise en scène est à peine tempéré par une musique discrète mais mélodieuse, qui ne surligne jamais la charge émotionnelle; les plans-séquences autour de la table familiale ne cèdent pas à la tentation de la pause esthétique. Quant aux rares scènes d’humour décalé, elles ne brisent pas la solennité de la trame, montrant un sens aigu de la nuance. Kore-Eda revient donc, dans Après la Tempête, sur les relations douces-amères et les conflits qui traversent la famille, sans que la fissure traumatique n’apparaisse comme une catastrophe irrémédiable. Dans le hors-champ du passé, ses films suggèrent une vie familiale heureuse en forme de leurre au regard d’une normalité nouvelle, qui est nécessairement craquelée, et qui se présente comme une évidence déjà inscrite dans le passé. Les relations se maintiennent bien qu’elles soient bancales ou blessées : l’absence ou la perte de l’autre agit comme le moteur de relations teintées d’attachement et de rancœur. Kore-Eda en rend compte avec délicatesse, cette fois-ci à travers le portrait de cette famille : Royta (Abe Hiroshi) est accroc aux jeux d’argent. Kyoko, son ex-femme (Maki Yoko), ne lui fait plus confiance, d’autant qu’il ne lui paye pas la pension de leur fils. Quant à son aînée de soeur (Kobayashi Satomi), elle tente de déjouer les procédés retors de son frère, qui consistent à soutirer de l’argent à leur mère Yoshiko (Kiki Kilin), veuve lucide et modeste, qui vit seule dans une H.L. M. délabrée. Mais la soeur elle-même est beaucoup moins désintéressée qu’il n’y paraît, trouvant dans le foyer maternel de quoi financer les activités artistiques de ses filles. Chacun des personnages semble accablé par la vie qu’il mène, rien n’étant à la hauteur de ses espoirs. Royta se rêve en romancier à succès, mais son métier de détective le cantonne à des enquêtes sordides, plutôt croustillantes d’ailleurs, qui l’autorisent à faire fi de la morale pour augmenter ses gains. Yoshiko, la mère, dans sa placide sagesse, porte un regard distancié sur ces déceptions de la vie qu’elle connaît trop bien. Elle attend la mort en sachant qu’elle n’aura jamais pu bouger de son logement miteux, à cause de ses pauvres moyens financiers et du peu d’aide que ses enfants lui auront apportée.
En découvrant ce film, je pensais à une allocution récente de notre Pape François qui invitait à ne pas rêver d’une famille idéale : "Il n'y a pas de famille parfaite. Nous n'avons pas de parents parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, Nous ne nous marions pas avec une personne parfaite. Et nous n'avons pas des enfants parfaits. Ainsi, il n'y a pas de mariage en bonne santé, ni de famille en bonne santé, sans la pratique du pardon. Sans le pardon, la famille devient le théâtre des conflits et un bastion de lamentations. Sans le pardon, la famille devient malade…’’
Juin 2017 J.-C. Faivre d’Arcier
Le prix à payer pour être une femme non conforme aux attentes des mâles.
 MON ÂGE, JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER
Film franco-Algérien de Rayhana Obermeyer – 2016
 Fatiguée de son mari paresseux et violent, Fatima vole quelques instants de quiétude avant de rouvrir son hammam. Alors qu’elle y fume en cachette, une jeune fille surgit en pleurs : c’est Myriam. Elle lui explique qu’elle est enceinte et que son frère ‘’déshonoré’’ menace de la tuer. Elle la supplie de l’aider. Fatima décide de la cacher dans ce lieu interdit aux hommes. D’autres femmes viennent les rejoindre, comme Samia, une masseuse, qui rêve de trouver l’homme de sa vie. Nadia, qui vient d’obtenir un acte de séparation après son divorce, explose de joie d’avoir retrouvé sa liberté. Louisa fait le récit de sa nuit de noces, avec un ami de son père, alors qu’elle n’avait que 11 ans...
Fatiguée de son mari paresseux et violent, Fatima vole quelques instants de quiétude avant de rouvrir son hammam. Alors qu’elle y fume en cachette, une jeune fille surgit en pleurs : c’est Myriam. Elle lui explique qu’elle est enceinte et que son frère ‘’déshonoré’’ menace de la tuer. Elle la supplie de l’aider. Fatima décide de la cacher dans ce lieu interdit aux hommes. D’autres femmes viennent les rejoindre, comme Samia, une masseuse, qui rêve de trouver l’homme de sa vie. Nadia, qui vient d’obtenir un acte de séparation après son divorce, explose de joie d’avoir retrouvé sa liberté. Louisa fait le récit de sa nuit de noces, avec un ami de son père, alors qu’elle n’avait que 11 ans...
 mon âge, je me cache encore pour fumer est le premier long-métrage de Rayhana Obermeyer, actrice et metteur en scène, exilée en France après la guerre civile qui a meurtri l’Algérie. C’est l’adaptation de sa propre pièce de théâtre, qu’elle avait joué en France, à la Maison des Métallos en 2009. La réalisatrice a choisi de situer l’histoire dans un hammam car ‘’d’un point de vue philosophique et ancestral, c’est un lieu cathartique de mise à nu’’. Pour imaginer ses personnages, elle s’est inspirée de femmes de son entourage, ce qui lui permet de livrer un message fort et engagé.
Des images d'Alger (par Mohamed Tayeb), des vues du port et de la Méditerranée, ouvrent et ferment À mon âge je me cache encore pour fumer, tourné en langue arabe, dans un hammam ottoman de Salonique. Les femmes vont et viennent, telles que la réalité les dessine. La caméra les cadre avec empathie, en groupe ou seules. Ce que réussit Rayhana avec ce film maîtrisé, c'est à suggérer la menace qui plane.
En ces temps de doute, de colère, de désir et de révolution, parfois, les films orientaux, féministes ou pacifistes, sont la preuve irréfutable que quelque chose d’important se passe dans ces mondes en pleine mutation. Dans ce premier long-métrage de l’actrice, dramaturge et réalisatrice Rayhana, des femmes de tous âges et de toutes conditions viennent se détendre dans le hammam de Fatima, parlent de tout et de rien, mais surtout transgressent les règles misogynes imposées par la dictature des hommes. Le titre du film est équivoque car un geste aussi anodin, en France, que celui de fumer une cigarette, est rigoureusement interdit, sous couvert de religion, dans une Afrique qui ne parvient pas encore à se libérer de ses traditions conservatrices.
Pourtant, peu à peu, les langues se délient, entre femmes on se libère, on fume, on chante, on danse, on ose montrer son corps, ses bras, ses seins, ses jambes. Mais, très vite les conflits éthiques reprennent le dessus. Les jeunes qui ‘’blasphèment’’ sont montrées du doigt par les femmes plus âgées. Ça hurle – un peu trop parfois – de colère mais aussi d’espoir. Et lorsqu’une fille enceinte, menacée par son mari, vient trouver refuge dans le cocon protecteur du hammam, la solidarité féminine se renoue. On remarquera le formidable monologue d’Aïcha, campée par l’actrice algérienne Biyouna, qui vient jusqu’à la porte de l’établissement pour cracher tout son dégoût à la figure des hommes, qui attendent à l’extérieur comme des chiens enragés.
A l’abri du hammam, les femmes se mettent à nu et les voix se délient. Dans la pénombre et les chuchotements, le film opte pour une couleur chair quand les corps viennent s’abandonner aux gestes lents, aux vapeurs et aux eaux bienfaitrices. Pourtant ces femmes entre elles ne se font pas de cadeaux, elles se jugent et se réprouvent ; mais le hammam se dresse comme un rempart contre la barbarie, contre la confiscation de leur désir. ‘’Fumer c’est pour les putains’’, dit Fatima qui se cache encore à son âge pour goûter ce seul plaisir qui lui reste.
Tout le mérite du film tient dans cette réappropriation du corps, par le toucher et par la parole. Elles n’ont pas droit au plaisir mais l’ont toujours à la bouche. L’amour, l’orgasme, exprimé en français. ‘’Comment dit-on orgasme en arabe ?’’, demande Samia. Et Nadia de répondre : ‘’En arabe, je crois qu’on dit pas’’. Les intentions de la réalisatrice sont louables, bien entendu, mais à trop vouloir représenter tous les affronts faits aux femmes, à trop vouloir faire défiler tous les types de femmes, son propos finit par devenir un cahier des charges. Le film se veut universel, on l’aurait souhaité moins démonstratif. Elle sait cependant filmer les joies et les peines de la chair, l’eau qui vient laver ses douleurs, les sécrétions et les luttes de ces femmes qui aspirent à la liberté et à la reconnaissance. L’incompréhension farouche entre hommes et femmes est clairement dénoncée : aux femmes, le sang, celui des draps, des viols, des menstrues, de l’accouchement,… le prix à payer pour être une femme conforme aux attentes des mâles.
Elles s’appellent Fatima, Sonia, Nadia, Louisa, Zahia, Myriam… elles ne possèdent rien d’autre que leur corps, qu’elles voudraient pouvoir offrir dans un élan d’amour réciproque, mais qui est si souvent réduit à l’état d’objet méprisé, que les hommes s’échangent et monnaient à leur seul profit.
Juin 2017 J.-C. Faivre d’Arcier
Une vie d’adolescent intime, forte et délicat et, qui sonne très juste
DE TOUTES MES FORCES
Film français de Chad CHENOUGA – 2017
 Nassim vient de perdre sa mère qui s’est suicidée. Sa vie de lycéen insouciant bascule. Sa proche famille ne peut pas le prendre chez elle. Il est donc pris en charge par Madame Cousin, qui l’accueille dans son foyer de jeunes. Nassim, bouleversé par la mort de sa mère, ne veut pas s’intégrer au groupe. Il s’enferme dans son chagrin, ses notes dégringolent et il tente de faire le mur pour retrouver sa petite amie à qui il a caché la vérité. Quand celle-ci l’apprend, elle ne comprend pas l’attitude de Nassim. Soutenu par Mme Cousin, le jeune homme va tenter de remonter la pente… Chad Chenouga à puisé dans son expérience personnelle pour écrire le scénario de Toutes mes forces, donnant au personnage de Nassim une trajectoire comparable à la sienne. La plupart des comédiens choisis font leurs premiers pas devant la caméra.
Nassim vient de perdre sa mère qui s’est suicidée. Sa vie de lycéen insouciant bascule. Sa proche famille ne peut pas le prendre chez elle. Il est donc pris en charge par Madame Cousin, qui l’accueille dans son foyer de jeunes. Nassim, bouleversé par la mort de sa mère, ne veut pas s’intégrer au groupe. Il s’enferme dans son chagrin, ses notes dégringolent et il tente de faire le mur pour retrouver sa petite amie à qui il a caché la vérité. Quand celle-ci l’apprend, elle ne comprend pas l’attitude de Nassim. Soutenu par Mme Cousin, le jeune homme va tenter de remonter la pente… Chad Chenouga à puisé dans son expérience personnelle pour écrire le scénario de Toutes mes forces, donnant au personnage de Nassim une trajectoire comparable à la sienne. La plupart des comédiens choisis font leurs premiers pas devant la caméra.
Les films consacrés à l’adolescence sont nombreux. Pourtant, cette fois, il n’est nullement question de se pencher sur les tourments liés à cette tranche d’âge.
Apparemment, Nassim est un garçon comme les autres. Pourtant, il vit seul avec sa mère, une femme dépressive, avec qui il a noué une relation difficile et fusionnelle. Alors qu’il rentre d’un week-end qu’il a péniblement réussi à s’octroyer avec ses copains, il la découvre morte. Assailli à la fois d’une grande culpabilité et d’un sentiment de libération, il va devoir continuer à vivre et choisit de ne rien dévoiler aux autres.
Placé dans un foyer de banlieue par les services de protection de l’enfance, il obtient de rester dans son lycée parisien. Il apprend à ses amis que sa mère est décédée, mais il leur cache où il vit. Son attitude détachée les dissuade d’en savoir davantage. Chad Chenouga livre une traversée intime, forte et délicate, qui sonne très juste. Et pour cause : Nassim, c’est lui. Comme son double sur l’écran, il a été obsédé, au foyer, par son dossier qui le désignait comme un ‘’cas social’’. Soucieux de maintenir l’image de sa normalité, Nassim tient à distance les adolescents du foyer, avant d’être rattrapé par leurs histoires semblables à la sienne, mais aussi par leur incroyable énergie de jeunes cabossés et avides de vivre. Son attitude détachée les dissuade d’en savoir davantage.
En 2001, avec le film 17 rue Bleue, Chad Chenouga évoquait déjà les souvenirs douloureux de son enfance et les rapports complexes d’un jeune garçon avec une mère névrosée. Repartant de ce point de départ auquel il adjoint des éléments d’improvisation réalisés avec des jeunes vivant en foyer, il trace le parcours d’un jeune homme qui rassemble ‘’toutes ses forces’’ pour surpasser les obstacles que la vie a placés au travers de sa route. Il lui faudra beaucoup d’énergie pour passer de l’univers d’un lycée des beaux quartiers à la médiocrité et à l’agressivité qui règnent dans ce centre d’accueil. Nassim se veut différent des autres ‘’cas sociaux’’. Il souhaite plus que tout détruire ce fameux dossier qui signe sa non-appartenance à la catégorie des « gens biens ». Car il est bien décidé à s’en sortir !
Sans fard ni concession, en évitant tout les clichés, Chad Chenouga suit pas à pas le cheminement du jeune homme. En ne nous épargnant rien de ses peurs, de ses doutes, de sa colère et de sa détermination, il crée une empathie immédiate, d’autant que le jeune acteur Khaled Alouach, au visage d’ange et aux cheveux bouclés, est d’une authenticité parfaite. Entouré d’une bande de personnages secondaires attachants et drôles malgré la misère dans laquelle ils sont plongés, il séduit par son charisme et sa capacité à s’approprier ce personnage entre violence et tendresse.
Son duo avec la persévérante Zawady (la remarquable actrice Jisca Kalvanda, déjà découverte dans Divines) le transforme en héros attachant. Enfin, le jeu de Yolande Moreau, toute en rondeur et en tendresse, déchirée entre ses désirs de mère-poule et les obligations d’éducatrice que lui impose sa fonction de directrice du foyer, nous transporte sans restrictions au cœur de ce drame intime. La réalisation, somme toute assez conventionnelle, est soutenue par une bande-son, mi-électro mi-classique, qui sert avec élégance ce récit plein de pudeur. Un film vivifiant et porteur d’espoir qui redonne des forces.
Comme le dit Corinne Renou-Nativel, journaliste du journal ‘’La Croix’’ : ‘’Chad Chenouga a préparé ses acteurs à leur première expérience de jeu par des ateliers qui ont nourri le film. Khaled Alouach, son interprète, bouleverse en dandy cadenassé, rongé par la culpabilité, aux côtés de Yolande Moreau, émouvante directrice de centre d’accueil, aussi directe et rude que pleine de tendresse pour ces jeunes en perdition. Avec son film, Chad Chenouga rend « hommage à tous les enfants et adolescents de foyer », à qui l’institution n’offre plus la possibilité financière de faire les études supérieures dont lui a pu bénéficier’’.
La bande annonce est accrocheuse, mais elle ne trompe pas sur la marchandise. L'expérience de la résilience est ici illustrée. Non la vie n'est pas toujours juste. Pour vivre, il faut combattre de toutes ses forces et plus on est meurtri, plus la lutte sera rude. Contenance et prévention sont des données précieuses dans la lutte contre la délinquance. L'appareil répressif n'est pas un outil de lutte, il est nécessaire pour protéger la société, mais bien souvent un aveu d'échec du point de vue de l'individu visé. La générosité et la patience des travailleurs sociaux sont des éléments du dispositif de possibles reconstructions. Nassim, comme les autres du foyer ont traversé l'horreur selon des déclinaisons variées. Il y a à les élever, c'est-à-dire les grandir, au lieu de les condamner, de les enfermer, de les humilier. Un film qui sort à point nommé en cette période électorale. De toutes nos forces, luttons pour que les forces vivantes l'emportent. Le haro sur l'étranger n'est pas de mise. L'"étrangeté" de ces jeunes du foyer n'est qu'un épiphénomène qui se fonde dans les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Yolande Moreau est encore une fois magnifique, elle crève l'écran.
Juin 2017 J.-C. Faivre d’Arcier
Quand l’amour est le creuset d’une révélation
LE FILS DE JOSEPH
Film d’Eugène Green – 2016
 Vincent, un adolescent, a été élevé avec amour par sa mère, Marie, mais elle a toujours refusé de lui révéler le nom de son père. Vincent découvre qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme met au point un projet de vengeance, mais sa rencontre avec Joseph va changer sa vie …
Vincent, un adolescent, a été élevé avec amour par sa mère, Marie, mais elle a toujours refusé de lui révéler le nom de son père. Vincent découvre qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme met au point un projet de vengeance, mais sa rencontre avec Joseph va changer sa vie …
Ce dernier film d’Eugène Green est très particulier. Les personnages s’expriment avec une diction parfaite, baroque, qui sonorise les "e" muets et fait prononcer toutes les liaisons, avec un respect méticuleux de la syntaxe ; ils semblent réciter leurs répliques, sans leur donner d’expression personnelle, ce qui ne manque pas d’étonner le spectateur. Green a choisi de filmer ses personnages de front et de détacher chaque plan fixe. Il convoque les arts -musique baroque, architecture et peinture- comme des révélateurs qui vont illuminer le récit, et tout cela avec aussi un certain humour.
Dès le générique, on est captivé par des mouvements de caméra, qui font du trafic urbain et de la déambulation des piétons sans visage, une sorte de marée avec ses flux et ses reflux; cette chorégraphie est accompagnée par une musique baroque italienne et le chant de Cavalieri. Avant même que débute l'histoire de Vincent (interprété par Victor Ezenfis), cet adolescent en quête de son père, on sent que le quotidien porte l'empreinte du sacré.
Le récit, en forme de parcours initiatique, est segmenté en cinq chapitres dont les titres renvoient à des épisodes bibliques (le sacrifice d'Abraham; le veau d'or, le sacrifice d'Isaac, le charpentier, la fuite en Egypte). Le film établit une corrélation entre ces scènes et la vie actuelle des personnages, animée par les jeux de l'ombre et de la lumière. Dans un premier temps, Vincent, qui est habité par le tableau du Caravage représentant le sacrifice d'Isaac et dont il a une reproduction dans sa chambre, se décide à aller rencontrer son père géniteur qu'il vient de "retrouver" : un certain Oscar Pormenor, éditeur régnant sur son milieu professionnel, ridiculisé dans une scène savoureuse du "veau d'or". Vincent découvre ce père abject en se cachant sous le divan de son bureau. Son geste parricide sera interrompu par l’arrivée imprévue de Joseph, le frère d’Oscar, venu solliciter son aide financière.
Le film va alors célébrer les noces de l'art et de la paternité retrouvée. Par la peinture d’abord : Vincent et Joseph contemplent, au Louvre, le tableau de Georges de La Tour Saint Joseph charpentier. ‘’C’est par son fils que Joseph devient père’’, affirme Joseph, (Fabrizio Rongione) et ce commentaire annonce sa révélation finale : "Je suis le père de Vincent", devant les gendarmes et le père géniteur, incapable d’assumer ses responsabilités et qui n’a plus qu’à battre en retraite. Par la musique aussi, qui déploie ses fastes ; Vincent est subjugué par la voix de la cantatrice Claire Lafilliâtre, accompagnée au théorbe par Vincent Dumestre, à l’occasion de la visite d’une église où ‘’Le Poème Harmonique’’ interprète une pièce de Domenico Mazzochi.
Vincent est le fils de Marie (Natacha Régnier), que le spectateur découvre d'abord dans l'embrasure d’une porte, environnée d’un halo de lumière. Mère aimante et souffrante, accompagnant son fils dans toute son aventure, jusqu’à cette scène ‘’évangélique’’ où, juchée sur le dos d’un âne emprunté et longeant la mer avec Joseph et Vincent, elle fuit la gendarmerie, lancée à leurs trousses par Oscar Porménor. Dans une liberté de récit totale, le film ne recule pas devant l'invraisemblance pour raconter la découverte, belle et naturelle, d'une paternité de substitution. Et, comme dans "La Sapienza", le précédent film d'Eugène Green, c'est grâce à la médiation de l'art, mariant le beau et l’émotion, qu’un lien familial peut se tisser. Le salut viendra de Joseph, homme providentiel un peu marginal. Mais Vincent ignorera jusqu'au bout, tout comme sa mère, que Joseph est le frère de Porménor. Que Le Fils de Joseph soit coproduit par les frères Dardenne ne manque pas de sel, puisque le film est l'antithèse parfaite de leur Gamin au vélo, qui était un récit désespérant sur la quête d'un père démissionnaire. Cette manière qu'a Green de maintenir la parabole biblique à la lisière du récit, par l'entremise de tableaux, confère au film une grandeur discrète et mystique.
En conclusion, je propose cette interprétation du film, par la critique Marie Gueden, que je partage : ‘’Eugène Green démontre une fois de plus avec Le Fils de Joseph que le cinéma est pour lui l’instrument audio-visuel, qui lui permet d’aborder le mystère de l’Incarnation, mystère qu’il sonde dans la nature de ses personnages, scrutés en gros plan. Que ce soit dans les plans comme dans les paroles qui sont des équivalents pour Eugène Green, il s’agit de révéler la Parole qui habite l’homme. Le montage dote le film d’une matière énergique, spirituelle, contribuant à incarner la parole. Celle-ci se livre majestueusement dans le poème mélodique baroque que Vincent entend dans l’église. C’est ici que la performance artistique est le lieu d’une révélation et d’une naissance à soi-même, alors que ce chant évoque la figure d’Euryale, figure mythologique d’un fils mort pleuré par sa mère, et sorte d’avatar profane du Christ. Que ce soit dans Euryale ou Le fils de Joseph, s’il n’est jamais prononcé le prénom de Jésus, ce n’est pourtant que de lui dont il est question, instituant le film comme un drame profondément chrétien : l’amour y est le creuset d’une révélation, la grâce est agissante, le Verbe s’incarne dans l’image, laquelle doit s’appréhender d’après son sens élevé – comme icône et comme présence (réelle), toutes choses que s’attache à agencer et à capter Eugène Green.
On peut penser à un modèle littéraire du côté de Paul Claudel, dans l’ampleur du projet qui est le sien de réaliser un cinéma du Verbe, un drame chrétien tenant à la fois du comique et du tragique : entre le littéral et l’allégorique, entre le quotidien, le profane, qui relève d’un régime satirique mais aussi tragique (le désir de vengeance du père par Vincent) et l’histoire biblique, le sacré qui mêle tragédie et happy end (propre à la comédie). Si la littéralité, assumée, peut être poussée à son comble (comme lors de la scène de reconnaissance entre Marie et Joseph ne manquant pas de faire sourire), c’est bien sur elle que repose le projet de donner à sentir toute l’épaisseur et la force de l’allégorie, comme du drame sous-jacent et à venir – celui de l’Incarnation.
Ainsi, Le Fils de Joseph s’appréhende encore plus qu’un autre film d’Eugène Green comme un appel lancé au Verbe : « Où te chercher ? » S’y formule une résistance face au monde moderne illustrée par la ‘’Fuite en Égypte’’ finale, sur un âne (c’est la représentation traditionnelle de la Fuite en Égypte mais cette figure peut aussi rappeler l’humble figure de l’âne Balthazar dans le film de R. Bresson), rejouée par Marie, Joseph et Vincent, et qui annonce un drame mais aussi un salut. S’y formule encore, dès le prologue, un appel à une conversion qui se lit en miroir de la résistance finale : alors que retentit le chant de Cavalieri « Jérusalem, convertere ad Dominum tuum » (« Jérusalem, reviens vers ton Dieu ! »), de gros plans de flux contraires simultanés vers la gauche et la droite du cadre qui montrent la suractivité de la ville sont soldés par un panoramique ascendant vers Notre-Dame. Preuve – s’il était besoin de le faire – que le drame se joue là-bas comme ici, et qu’Eugène Green est, lui aussi, là-bas comme ici. Tout cela ne pourrait être que sublime, virtuose, édifiant, ou – diraient les détracteurs – assommant, ridicule, catéchétique, mais c’est un supplément d’âme qu’il trouve ici, magnifié par le raffinement des plans, ses chromatismes somptueux, puis, peu à peu celui du cœur qui a été touché et a connu une révélation, et qu’il nous fait en retour approcher par son cinéma, comparable à une onction’’.
Mai 2017 J.-C. Faivre d’Arcier
Ode à la première femme peintre, libre, espiègle, fragile et forte.
PAULA Ma vie devrait être une fête
Film franco-allemand de Christian Schowchow – 2016
 A Brême, en 1900, Paula Becker a 24 ans et veut devenir peintre, au grand désespoir de son père qui veut la voir mariée avec des enfants. Pourtant, elle part perfectionner son art au sein de la communauté artistique de Worpswede, dans le nord de l’Allemagne. Faisant fi des recommandations de son professeur, elle veut imposer son style très personnel. Otto Modersohn, peintre lui aussi, veuf et père d’une petite fille, est fasciné par sa peinture et veut l’épouser. Mais, une fois marié, il refuse de lui faire l’amour de peur de la perdre, comme il a perdu sa première femme, morte en couches. Paula patiente cinq ans, puis le quitte pour se rendre à Paris… Paula Modersohn-Becker devient la première femme peintre à imposer son propre langage pictural.
A Brême, en 1900, Paula Becker a 24 ans et veut devenir peintre, au grand désespoir de son père qui veut la voir mariée avec des enfants. Pourtant, elle part perfectionner son art au sein de la communauté artistique de Worpswede, dans le nord de l’Allemagne. Faisant fi des recommandations de son professeur, elle veut imposer son style très personnel. Otto Modersohn, peintre lui aussi, veuf et père d’une petite fille, est fasciné par sa peinture et veut l’épouser. Mais, une fois marié, il refuse de lui faire l’amour de peur de la perdre, comme il a perdu sa première femme, morte en couches. Paula patiente cinq ans, puis le quitte pour se rendre à Paris… Paula Modersohn-Becker devient la première femme peintre à imposer son propre langage pictural.
Ce n’est pas la première fois que l’histoire de Paula Becker est portée à l’écran. Christian Schowchow a fait le choix de ne pas s’inspirer des autres réalisations, mais d’utiliser plutôt les lettres de l’artiste et d’étudier minutieusement sa peinture. L’actrice Carla Juri, qui s’est fait connaître en Allemagne dans Wetlands (2013), était le premier choix du cinéaste. Un choix particulièrement judicieux puisque la jeune femme livre ici une interprétation impressionnante.
Voici donc la vie de l’artiste Paula Modersohn Becker (1876-1907), allemande et mariée au peintre Otto Modersohn. En juin 2015, le musée d'Art moderne de la Ville de Paris lui a consacré une rétrospective — à laquelle le journal ‘’Le Parisien’’ avait décerné l'Etoile 2016 de la meilleure exposition. Marie Darrieussecq a publié à son propos la même année, ‘’Être ici est une splendeur’’ (P.O.L). La vie de cette jeune femme aura été très courte ; elle est morte à 31 ans. Paula Becker aura habité cette parenthèse de ses rêves et de son désir de peindre envers et contre tout. Elle fera le choix de tout quitter pour gagner Paris où elle deviendra une artiste, précurseur oubliée de l’art moderne, peut être déjà expressionniste et cubiste sans le savoir. Le film, magnifique, est une ode à la femme libre, espiègle, fragile et forte, qu’elle fut tout à la fois ; elle est déterminée et convaincue que sa main, son geste, doivent se fier à son regard qui la guide vers la toile, sans avoir ni peur ni honte malgré les critiques acerbes qui lui sont faites. Il faut aller voir ce très beau film d'un réalisateur qui se passionne pour les destins singuliers et féminins. Lumière magnifique, classicisme envoûtant, sublime et bouleversante Carla Juri dans le rôle de cette pétroleuse hors-normes... On en sort aussi envoûté qu'ébloui.
C’est une entreprise difficile de faire se confronter deux formes d’art que tout oppose et rapproche en même temps : le cinéma et la peinture ! Car comment restituer la pensée du peintre, même si on parvient à retrouver ses gestes ? Et que dire du cadre du tableau que le film s’ingénie à montrer ? En effet, dans Paula, nombreux sont les plans où le rectangle noir du cadre de la toile cache le geste créateur, suscitant parfois chez le spectateur une frustration qui participe à la tension dramatique. Ainsi, au début du film d’une part et à la toute fin d’autre part, deux séquences se répondent : la première, plan frontal sur le dos noir d’un immense tableau tenu par deux petites mains féminines, pendant que la voix autoritaire du père énonce l’impossibilité pour sa fille, et pour toute femme, de devenir artiste peintre et d’en vivre ; cette sentence est interrompue par la chute brutale du tableau que Paula laisse échapper. La seconde, précédée d’un plan en plongée de Paula, gisant morte, nous met à nouveau face à un tableau : son tableau en pied, peinture de la maternité en devenir, qui occupe tout l’espace, et qui opère un saut dans le temps par un clin d’œil subtil et imprévisible. A l’image de Paula se substitue celle de Carla Juri, actrice aussi lumineuse que son modèle. Elle nous installe devant nombre de ses œuvres, réunies dans le musée actuel qui est dédié exclusivement à cette femme peintre, rendant ainsi vains les regrets de Rainer Maria Rilke qui avait écrit à son sujet : ‘’Hélas, toi qui fus loin de toute gloire…’’
Le récit s’appuie sur les très nombreuses lettres et sur le journal intime de Paula. Il développe davantage la richesse de certains instants magiques, plutôt que sur la multiplicité des épisodes de sa vie. L’intensité et l’unité dramatique sont la règle de cette entreprise, brillamment réussie par le réalisateur et ses deux scénaristes, Stefan Kolditz et Stephan Suschke. Par exemple, Christian Schowchow a choisi de condenser en un seul voyage les différentes escapades de Paula à Paris, véritable cœur du film : la rencontre avec les artistes, avec Camille Claudel, l’atelier de Rodin… ainsi que ses rencontres masculines. Ces dernières sont aussi sont condensées en seul personnage, bel homme ‘’artiste joli-cœur’’ qui lui fait découvrir la vie parisienne, les toiles de Cézanne, et les plaisirs de l’amour charnel, longtemps refusés par son mari. Cette séquence, joyeuse, débridée et sensuelle, permet au réalisateur quelques facilités : la marque évidente sur le drap de la virginité perdue est glissée entre deux ou trois pommes sur le lit ; allusion à une autre pomme, accrochée élégamment sur le chapeau de Paula que son futur mari, Otto Modersohn, avait croqué par jeu cinq ans plus tôt. C’est la même exaltation, pudique et joyeuse, mais masquée par un drap, qui scellera physiquement les retrouvailles de Paula et de son mari. Celui-ci, amoureux passionné mais déçu, est venu pour clore sa relation douloureuse avec elle, et il devient le spectateur ébloui de ses peintures improbables qu’il comprend enfin et qu’il admire : ‘’Peindre le ressenti’’, disait-elle, ‘’et non reproduire le réel, c’est tendre vers une simplicité nouvelle’’.
Avec Paula, le réalisateur allemand Christian Schowchow réussit un petit exploit : signer un film de style académique sur un personnage qui a fait souffler un vent de modernité effrontée sur son époque. Le film tire son intérêt du charmant portrait qu'il dessine de la fabuleuse artiste peintre Paula Modersohn-Becker. La pétillante actrice Carla Juri prête ses traits avantageux à la jeune Paula. Le film a une autre qualité : il montre, fait assez rare, la véritable peinture de Paula se faire à l'écran, et d'une façon assez réaliste et convaincante. Le talent, la vocation, cet irrésistible élan qui pousse à peindre et à peindre encore est assez subtilement montré. Entre ses qualités attachantes et quelques défauts (les décors sonnent parfois un peu faux, certains personnages secondaires sont mal traités), Paula vous fera passer un bon moment. Pour ma part, c'est l'intérêt pour les personnages qui a attisé mon plaisir : le film propose notamment un portrait édifiant de Rilke. A vous de voir.
Mai 2017 J.-C. Faivre d’Arcier
Quand la faiblesse physique, une force mentale et ’humour
deviennent une arme de combat face à l‘adversité
PATIENTS
Film français de Medhi IDIR et ‘Grand Corps Malade’ – 2016
 Après un accident grave, Ben, qui rêvait d’être un basketteur professionnel, se retrouve ‘’tétraplégique incomplet’’ à la suite d’un stupide accident de plongeon dans une piscine. Depuis, pour aller aux toilettes, utiliser une télécommande, ou téléphoner, il a besoin d’une aide soignante. Au centre de rééducation, il devient l’ami d’autres handicapés, Farid, Toussaint, Steve, Lamine et Eddy. Grâce à eux et à leur humour, il parvient à positiver tout en continuant à se battre, avec l’aide de François, son médecin, pour réapprendre à marcher. Dans les couloirs, il rencontre Samia, dont il tombe amoureux…
Après un accident grave, Ben, qui rêvait d’être un basketteur professionnel, se retrouve ‘’tétraplégique incomplet’’ à la suite d’un stupide accident de plongeon dans une piscine. Depuis, pour aller aux toilettes, utiliser une télécommande, ou téléphoner, il a besoin d’une aide soignante. Au centre de rééducation, il devient l’ami d’autres handicapés, Farid, Toussaint, Steve, Lamine et Eddy. Grâce à eux et à leur humour, il parvient à positiver tout en continuant à se battre, avec l’aide de François, son médecin, pour réapprendre à marcher. Dans les couloirs, il rencontre Samia, dont il tombe amoureux…
Fabien Marsaud, plus connu sous son nom d’artiste ‘’Grand Corps Malade’’, signe son premier film, adapté de son autobiographie, intitulée Patients, paru en 2012 aux Editions Don Quichotte. Aide par la scénariste Fadette Drouard et le réalisateur Mehdi Idir, il a choisi de filmer dans le même centre de rééducation qui l’a accueilli après son accident. Bien que le sujet soit grave, il tenait à ne pas tomber dans le pathos et il a privilégié une mise en scène sobre et efficace, qui donne à son long-métrage une force indéniable.
Avec ses nouveaux amis, tétras, paras, traumas (crâniens) et entouré d’une équipe médicale compétente, Ben fait l’apprentissage de l’enfermement et de la patience, de la douloureuse reconquête de son corps, quand la faiblesse physique appelle une force mentale et que l’humour devient une arme de combat face à l‘adversité. On n’est pas prêt d’oublier le réveil de Ben, l’ivresse de sa première virée en fauteuil roulant, ni les maladresses récurrentes de l’infirmière. Les acteurs ont tourné dans le centre, avec les vrais patients, là où Fabien Marsaud a réappris à marcher et à ‘’changer d’espoir pour trouver un espoir adapté », titre de l’émouvante chanson de Grand Corps Malade qui accompagne le générique de fin. Pourtant, cette plongée dans le monde du handicap très lourd évite l’écueil du misérabilisme. Porté par une rage de vivre et un humour féroces, Patients refuse tout pathos pour livrer une leçon de vie dont on ressort gonflé à bloc. Dans le rôle de Ben, l’acteur Pablo Pauly, déjà vu dans Les Lascars (2009) et Discount (2014), utilise les vannes et l’humour pour désamorcer l’émotion et emballer ce film de copains plein d’humanité. Patients est un formidable récit de reconstruction, une bouleversante ode à la vie et à la fraternité.
Dans le film de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, on entend des devinettes comme : "Tu sais c’est quoi qu’est relou avec les meufs en fauteuil roulant ? C’est que tu sais jamais si elles ont un gros cul !" Sauf qu’ici, on n’est pas chez Cyril Hanouna. La blague est prononcée par un jeune type en fauteuil pour faire rigoler un autre jeune type en fauteuil qui déprime, et ça change pas mal de choses. De manière générale, Patients est un film qui aide à percevoir autrement les personnes handicapées et tous les accidentés de la vie qui se retrouvent dans un centre pour réapprendre à vivre de façon autonome. Ce n’est pas la moindre de ses qualités.
Cette histoire, son histoire, Grand Corps Malade (aujourd’hui slameur talentueux et reconnu) l’a d’abord racontée dans son livre où il évoquait, avec une plume alerte, un humour mordant et de soudains accès de gravité, les galères des amis qu’il a rencontrés là-bas – « paraplégiques, tétraplégiques, traumatisés crâniens, amputés, grands brûlés », avec qui il tuait des heures trop creuses. De cette matière humaine, l’artiste tire aujourd’hui une puissante fiction cinématographique en forme d’hommage. « Je m’intéresse à plein d’écritures, et le scénario me tentait, indique-t-il. Mais une fois écrit, je ne pouvais pas le laisser à quelqu’un d’autre. » Il appelle à la rescousse Mehdi Idir, ami proche et réalisateur de ses clips. Les deux compères n’ont aucune expérience en matière de long métrage, mais ils savent ce qu’ils veulent (« un film sur les relations humaines ») et ne veulent pas (‘’Verser dans le pathos’’). ‘’Dans Patients, on voit les moments de désarroi. Mais si le sujet est souvent lourd, j’espère que vous rirez’’, déclare Grand Corps Malade. De fait, on rit, on grince des dents et on s’émeut aussi – tout cela à la fois, ou dans une succession si rapide, si maîtrisée, que le spectateur en sort tout retourné. On reconnaît le style caractéristique du slameur, ce sens du rythme et des mots, qui lui permet ici de raconter « le quotidien de gens qui s’ennuient sans ennuyer ». Dès le départ, les coréalisateurs ont souhaité « que la réalisation suive les progrès de Ben ». Un parti pris de mise en scène efficace. Le film commence par la vision subjective du jeune homme pendant son premier mois à d’hôpital. Elle se résume alors à un plafond et des visages penchés. Lorsque, au centre de rééducation, Ben peut commencer à légèrement se redresser, à arracher de ses muscles quelques impulsions minuscules, les plans restent très serrés. La première fois qu’il retrouve la liberté de se déplacer dans un fauteuil électrique, l’image retrouve sa profondeur, la seule perspective d’un couloir sans âme est une joie immense.
Dramatique au départ, le destin de Ben évolue dans une bonne humeur inattendue, tant ses réactions face à l’adversité prêtent à rire. Tout comme son contact avec le personnel hospitalier et les autres "tétras", "paras", "traumas crâniens" qui l’entourent. Tous ont des personnalités bien trempées, et se prêtent à des échanges savoureux, plein de drôleries et de réparties. Si Patients n’est pas une comédie, on y rit beaucoup, sans que les émotions plus intimes soient négligées. Le réalisme du film nous touche et la mise en scène n’a rien d’hésitante : elle joue d’inventions renouvelées, notamment dans les cadrages sur leurs déplacements et leurs échanges.
Pourtant, Patients aurait pu échouer à cause de la banalité du sujet : l’histoire de Benjamin, qui ne pensait qu’au basket, et qui se réveille paralysé après son accident ; le voilà pour un an, avec d’autres jeunes gens de son âge, dans un centre de rééducation où il va progressivement réussir à bouger un orteil, puis une main, puis à se tenir assis et tenter de passer le sel à son voisin. Quiconque a passé un long séjour à l’hôpital se retrouvera dans Patients, dans la véracité de ses anecdotes, la qualité d’écoute, la vraie compassion, l’humanité qui s’y développent. Dans les amitiés qui s’y nouent et le dévouement du personnel hospitalier, aussi. Avec, comme Ben dans le film, et beaucoup d’autres, le sentiment de quitter l’établissement à regret. Comme c’est le cas lors de la vision de ces Patients, avec lesquels on passerait volontiers encore un peu de temps.
Si on pense à Intouchables d’Eric Toledano et Olivier Nakache (2012), le duo des réalisateurs de Patients réfutent cette référence : ‘’Les personnages principaux de notre film sont tous en fauteuil roulant et nous avons choisi de ne pas faire appel à des stars pour les incarner’’, répète Fabien Marsaud. Ce parti pris, qui a rendu Patients difficile à financer, se révèle finalement payant car le public croit immédiatement en ces jeunes frappés par la malchance et à leurs efforts. On ne rit pas d’eux, mais avec eux. Cette comédie humaniste a trouvé le juste équilibre entre tendresse et férocité, gage de sa réussite.
Mai 2017 J.-C. Faivre d’Arcier
Scorsese, le Croyant, délivre une profonde réflexion sur la foi
SILENCE
Film historique américano-mexicano-taïwanais, réalisé par Martin Scorsese, 2016.
 XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Scorsese met en sourdine ses ambitions commerciales avec son dernier long de 2h40m en proposant une oeuvre contemplative, sur fond de sujet religieux austère et peu fédérateur. L’auteur revient au spirituel de La Dernière tentation du Christ ou de Kundun, délaissant l’action, ici inexistante, malgré la présence -toutefois rare à l’écran- de Liam Neeson au casting. Ici, pas de bons sentiments chrétiens chers aux productions destinées aux apôtres du Tea Party américain ; Scorsese, le Croyant, délivre une profonde réflexion sur la foi qu’il met en scène au 17e siècle, dans un contexte historique insolite, le Japon médiéval, insoumis aux efforts de christianisation du Vatican.
Le thème est passionnant, nous ramenant aux heures noires de la conquête du globe par les Européens, comme prémices à une forme de mondialisation du culte. Cette réflexion sur la foi est une magistrale leçon de cinéma, qui apaise dans sa ferveur et étonne par son intelligence, au-delà de tout prosélytisme déplacé.
Silence puise sa force dans l’accomplissement d’une tension entre ténèbres et lumières, un Big-bang né du choc entre des cultures qui se résistent, et des croyances qui se contredisent. Cette épopée se passe sur la terre nippone où des nouveaux chrétiens, fraîchement convertis par les missionnaires venus du bout du monde, sont humiliés, torturés, jusqu’à la renonciation à leur foi qu’ils devront piétiner. Le supplice est peut être plus élevé encore pour les prêtres catholiques, forcés de se détourner de leur croyance. En cela réside l’incroyable ressource narrative du film : la rétractation possible du croyant dans ses convictions les plus intimes comme suspense ultime. Un sujet de thriller original, où les mots, les pensées et les décisions sont extrêmement pesés sur fond de souffrances sacrificielles.
 Scorsese est visiblement hanté par les atrocités commises au nom de la foi : massacres de chrétiens, guerres aux impies, terrorisme…A priori, la religion catholique y est dépeinte dans sa bonté et sa générosité. Le grand inquisiteur est du côté du peuple japonais qui cherche à défendre sa croyance, un peuple éclaté en îles et en villages où les ténèbres de l’isolement, de l’ignorance, et de la répression font régner la peur. Las de tout manichéisme, Scorsese étire la pensée religieuse à son paroxysme, confrontant les dogmes, exposant les contradictions, et surtout montrant la relativité des cultures et des cultes qu’il renvoie à l’intimité, à l’individualité, dans le respect des différences et du pluralisme, vers notre époque où l’obscurantisme grandit pour imposer à nouveau une hiérarchie des religions.
Scorsese est visiblement hanté par les atrocités commises au nom de la foi : massacres de chrétiens, guerres aux impies, terrorisme…A priori, la religion catholique y est dépeinte dans sa bonté et sa générosité. Le grand inquisiteur est du côté du peuple japonais qui cherche à défendre sa croyance, un peuple éclaté en îles et en villages où les ténèbres de l’isolement, de l’ignorance, et de la répression font régner la peur. Las de tout manichéisme, Scorsese étire la pensée religieuse à son paroxysme, confrontant les dogmes, exposant les contradictions, et surtout montrant la relativité des cultures et des cultes qu’il renvoie à l’intimité, à l’individualité, dans le respect des différences et du pluralisme, vers notre époque où l’obscurantisme grandit pour imposer à nouveau une hiérarchie des religions.
Il ressort de ce voyage, plus métaphysique qu’ésotérique, un grand sentiment d’apaisement, où les convictions de chaque spectateur sont préservées, sur fond de cinéma total, celui d’un maître du visuel et de l’art narratif, qui arrive encore à nous surprendre par la puissance de ses images. Les nouvelles recrues que sont Andrew Garfield et Adam Driver épousent la rigueur de son cinéma, avec la même ferveur que DiCaprio et De Niro en leurs temps.
Scorsese continue donc de régner comme un dieu sur le cinéma d’auteur américain. Malgré le désaveu commercial du film aux USA, Silence est un vrai miracle qu’il faut aller contempler. C’est la grande œuvre de Scorsese : il en a rêvé pendant vingt-cinq ans, il y a concentré tous ses thèmes – la faute, la rédemption, le sang, la mort – et il s’interroge, à 74 ans, sur les fins dernières. Méditation lente, voyage aux confins du monde, Silence est, avant tout, l’enfant de son inquiétude. Et si Dieu était un taiseux ? Et s’il nous regardait, depuis le nuage du trône, en Pantocrator indifférent ?... Le cinéaste interroge sa foi et la nôtre.
Le journaliste du journal La Croix, Arnaud Schwartz, rapporte cette déclaration de Martin Scorsese : ‘’J’aime le rituel. J’y trouve de la beauté et du réconfort. Mais même si l’on ne prend pas part aux cérémonies, on doit être capable d’appliquer dans sa vie de tous les jours des concepts moraux fondamentaux. Que l’on commette ou pas des erreurs, des péchés, il faut faire face, assumer. Certains renoncent et tombent dans le désespoir. La religion a toujours été présente dans ma vie. J’y ai baigné enfant, je l’ai repoussée, j’ai tenté de trouver d’autres voies et aujourd’hui, c’est difficile à décrire, mais je m’aperçois avec l’âge que certaines choses s’éloignent, que le temps a de la valeur. Méditer, échanger avec des enfants, aider des proches ou d’autres artistes, pour moi, c’est une forme d’acte spirituel. Cela demande beaucoup d’énergie, on peut parfois s’y perdre au détriment de son propre travail, mais c’est aussi ce que veut dire croire pour moi. J’aime ce que dit et fait le pape François. L’Église avance lentement, mais on peut encore trouver auprès d’elle une manière de vivre, de quoi s’inspirer’’.
Avril 2017 Jean-Claude d’Arcier
Le réalisateur s’aventure vers la spiritualité
LA CONFESSION
Film français de Nicolas BOUKHRIEF – 2016
 Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Barny succomberait-elle au charme du jeune prêtre ?
Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Barny succomberait-elle au charme du jeune prêtre ?
La Confession est une adaptation libre du roman Léon Morin, prêtre de Béatris Beck, déjà adapté à l’écran en 1961 par Jean-Pierre Melville et Pierre Boutron. Le réalisateur Nicolas Boukhrief est surtout connu pour ses films d’action. On se souvient peut-être de Gardiens de l’ordre en 2009, de Convoyeur en 2013 et surtout de Made in France, en 2015, dont la sortie en salles avait été stoppée pour cause d’attentats terroristes. Nicolas Boukhrief a été bouleversé par la lecture du roman lorsqu’il était jeune. Sa rencontre avec Nicolas Jourdier lui a permis de développer le film qu’il souhaitait réaliser depuis près de vingt ans. Romain Duris (Léon Morin) et Marine Vacht (Barny), qui l’ont rejoint dans cette aventure, incarnent un ‘’vrai couple de cinéma, évident et moderne’’. Il change de registre et choisit de s’aventurer vers des domaines plus intériorisés comme la spiritualité. Coïncidence ou habile manière de suggérer que dans nos sociétés de consommation, la spiritualité peut être le meilleur rempart contre certaines dérives meurtrières ? A chacun d’en juger. Toujours est-il qu’il choisit d’adapter librement le roman en évitant de faire un remake du film homonyme de JP. Melville, dont la production n’a pas acquis les droits. De nos jours, un jeune prêtre se rend au chevet d’une femme âgée qui, sur son lit de mort, lui confie un secret dont elle n’a jamais parlé à personne : celui de sa rencontre, avec un homme d’église qui a bouleversé sa vie, alors qu’elle n’était qu’une toute jeune femme.
A quelques mois de la fin de la guerre, l’arrivée d’un prêtre, intelligent, aimable et ouvert, révolutionne la vie du village où les hommes sont rares (le mari de Barny est prisonnier en Allemagne). Au bureau de poste où Barny travaille, toutes les femmes sont émoustillées par cet évènement et chacune y va de ses commentaires. Contrairement à ses collègues de travail, Barny décide d’abord de garder ses distances ; mais ensuite d’aller provoquer cet homme qui représente une idéologie dont elle se méfie. Pourtant, l’accueil et l’intelligence du prêtre la pousseront à accepter de transformer ces confrontations en échanges amicaux et peut-être même amoureux. Lui a foi en Dieu, elle croit dans le communisme. Sont-il pour autant si éloignés l’un de l’autre ? Ce ne sont finalement que deux humanistes différents, habitués à défendre leurs idéaux. Le réalisateur se garde bien d’engager une discussion politique ou religieuse. Le vrai moteur du récit est ce duel psychologique qui va s’entamer à coup de dialogues brillants, laissant chacun des personnages nous convaincre de son point de vue, loin de tout manichéisme. Les nuances apportées au traitement de chacune des situations rendent le récit accessible à tous, croyants ou non-croyants. Mais cette belle histoire, portée d’une part par Marine Vacht, qui est émouvante dans son personnage de jeune femme déchirée entre ses convictions et les arguments attirants du prêtre et, d’autre part, par Romain Duris qui incarne cet ecclésiastique ouvert et souriant, risquerait de devenir lassante sans l’étude psychologique de la population locale. Les opinions des uns et des autres sur le lieu de travail (en particulier dans le bureau de poste), les soupçons portés sur ceux qui collaborent ou sur ceux qui résistent, le comportement des soldats Allemands, sont autant de détails qui animent le récit, qui est aussi plein d’humour et de légèreté. Malgré le conflit qui reste en toile de fond, il y a des instants de grâce que l’on doit à la sérénité et à la tolérance des deux protagonistes.
Romain Duris sait trouver le ton juste et grave pour rendre son personnage plein de vivacité et de mystère. Le temps passe vite à regarder ces acteurs, éclairés et filmés avec talent et, lorsque le mot fin s’inscrit sur l’écran, on se sent enveloppé d’un sentiment de paix réconfortante. En réactualisant de manière très personnelle ce livre datant de 1952, Nicolas Boukhrief nous prouve que les idéaux ne sont pas morts. Les modes et les usages changent mais la puissance des sentiments reste.
Le « dialogue entre ce prêtre et cette jeune femme communiste, tous deux d’une sincérité absolue dans leur foi’’, comme le dit le réalisateur, ‘’restent purement intellectuels et platoniques. L’attirance réciproque pourtant grandit, entre la jeune femme dont le mari est prisonnier en Allemagne, et le jeune prêtre retenu par ses vœux. Il ne s’agit pas d’une passion à la façon du film Les oiseaux se cachent pour mourir, best-seller de Colleen McCullough des années 1980. Nicolas Boukhrief laisse la sensualité monter doucement mais sûrement entre ses deux protagonistes, qui auraient pu s’aimer dans d’autres circonstances. C’est une tragédie amoureuse, toute en discrétion et en délicatesse, qu’il offre au spectateur. Ce qui rend son film vrai et touchant.
Comme le remarque Jérôme Garcin, dans L’Obs du 8.2.2017, ‘’Devant cette Confession, on pouvait avoir quelques appréhensions. On avait tort. Le film de Boukhrief, baigné dans une lumière de vitrail et plongé dans une pénombre de sacristie, est inspiré. Cela tient à la justesse des dialogues, à la profondeur des regards, à la pudeur de la caméra et à l’interprétation des deux acteurs, qui apparaissent grandis par leurs personnages respectifs. Léon Morin, juste après l’exécution d’otages par les nazis, ose dire en chaire : "S’il me manque l’amour, je ne suis rien…" Barny, de son côté s’engage dans la résistance. Il a la foi en Dieu, elle a la foi en l’homme. Chacun à sa manière, éclaire et soulage cette période difficile de l’occupation. Dans cette rencontre, profondément humaine et spirituelle, Nicolas Boukhrief a réussi à filmer ce que les mots ont du mal à traduire : l’amour vrai, débarrassé de tout ce qui l’encombre, le détourne ou le condamne’’.
En 1952, Béatrice Beck obtenait le Goncourt avec Léon Morin, prêtre. 50 ans après JP. Melville, Nicolas Boukhrief adapte à son tour ce roman magnifique, véritable mélodrame autour d'un amour impossible avec la foi pour thème central. La Confession n'est pas un remake du film de 1961 mais une superbe création, très personnelle, magnifiquement éclairée et d'une intensité profonde dans ses longs passages dialogués. Et c'est l'harmonie entre Romain Duris et Marine Vacht, tous les deux bouleversants, qui transcende la beauté frémissante de cette histoire éternelle. Le romanesque pur n'est pas mort, il suffit de mots et de regards pour qu'il se renouvelle toujours. Permanence miraculeuse du cinéma.
Avril 2017 Jean-Claude d’Arcier
La fragilité magique de la relation parents-enfants
FAIS DE BEAUX RÊVES
Film franco-italien de Marco BELLOCCHIO – 2015
 Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de 9 ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition brutale. Année 1990, Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…
Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de 9 ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition brutale. Année 1990, Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…
Présenté en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs en 2016, Fais de beaux rêves est une adaptation du roman Fais de beaux rêves, mon enfant (Fai bei sogni), de Massimo Gramellini. Ce livre revient sur le drame personnel de l’auteur, qui a conditionné toute sa vie ; son édition fut un phénomène éditorial en Italie avec un million d’exemplaires vendus. Il a commencé à écrire des chroniques sportives dans divers journaux. En 1991, il devient journaliste politique et couvre en tant qu’envoyé spécial le siège de Sarajevo. En 1995, il est nommé vice-président de La Stampa à Turin. Son livre est aujourd’hui réédité chez Robert Laffont, à l’occasion de la sortie au cinéma de son adaptation par Marco Bellocchio.
Marco Bellocchio a réalisé une présentation de son film avec le journaliste Jean A. Gili, pour la fiche édité par l’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai) : ‘’L’histoire racontée par M. Gramellini m’a intéressé car elle est un contrepoint flagrant de ma propre biographie. Ce type de lien avec ma mère n’a jamais existé dans ma vie et j’avais beaucoup de curiosité pour cette relation d’amour absolu. Le film est resté fidèle au livre autobiographique que nous avons transformé en scénario avec mes deux coscénaristes Edoardo Albinati et Valia Santella (qui a travaillé aussi avec le réalisateur Nanni Moretti). Nous avons été plus fidèles dans les parties concernant l’enfance, mais moins dans la période adulte ; il y avait l’influence de la télévision avec Belphégor, une série qui, à l’époque, a eu un énorme succès en France et en Italie…
Comment avez-vous affronté la difficulté de mettre en scène trois époques avec trois acteurs différents ? L’important était de trouver des acteurs justes. Nous avons condensé l’histoire en trois temps : nous le retrouvons adulte, journaliste confirmé, en 1992, l’époque de l’affaire des pots de vin et de l’opération ‘’Mains propres’’. Nous avons aussi choisi les époques en fonction de l’âge des acteurs, comme Valério Mastandrea qui a 40 ans et qui était crédible pour cette période. Ce qui m’inquiétait, c’est qu’il est romain alors que le personnage est de Turin. Mais ce qui m’a conquis aux essais, c’est la tristesse de son regard, un fond de mélancolie et de fragilité, même s’il est une personnalité très positive.
Le personnage de Massimo devient ensuite journaliste politique … Oui, après sa mission a Sarajevo, il est chargé d’une rubrique ‘’Courrier du cœur’’. Une lettre lui parvient, écrite par un homme qui a perdu sa mère et à laquelle il répond en condensant l’histoire de sa vie. Sa réponse déclenche un abondant courrier, ce qui l’a décidé, ensuite, à écrire son livre…
On se demande comment ce secret a pu être gardé si longtemps ? C’est le charme et la réussite du livre, qui développe ces moments où il s’approche de la vérité, mais il ne veut pas la découvrir. Et, avec le temps qui passe, ceux qui l’entourent font semblant de croire qu’il sait, ou se disent : autant qu’il ne sache jamais…
Quelle est la clef du film, la mémoire ? Les films ont leur propre destin, mais le point de départ, c’est le rapport entre l’enfant et sa mère. C’était la pierre angulaire, le mur porteur, la colonne principale sur laquelle j’ai pu construire tout le reste’’.
La mort d’une mère, forcément incompréhensible pour un enfant, est au cœur de Fais de beaux rêves, comme un long poème nostalgique. Toutes les scènes qui ont précédé la révélation finale du secret (clé de la vie entière de son personnage principal, Massimo) s’assemblent, prennent sens et s’ordonnent une fois le secret révélé, et affleurent enfin à la conscience du film, colorées par une majestueuse et tragique nostalgie - la nostalgie du début du film, qui vaut pour celle du début de la vie. Le fait que Massimo, apprenant des années plus tard les circonstances de la mort de sa mère, se révolte contre ses radieux souvenirs d’enfance en décidant que sa propre vie n’a jamais eu aucun sens, ne change rien à l’affaire. Le cinéma peut proposer un assemblage recomposé des différents moments qui entrent dans la vie d’un individu : le passé qui ne passe pas, le présent insaisissable, les assauts du monde extérieur, les sursauts résignés de l’espérance…
Massimo grandit. Sa profession de journaliste lui permet d’avancer positivement dans la vie, même si, à travers elle, il bute indéfiniment sur le souvenir de sa mère et l’événement traumatisant qu’a constitué sa disparition. Sa vie affective est plus chaotique. Il n’est pas capable de donner de l’amour à autrui. Une jeune fille qu’il fréquente lui reproche de s’enfermer en lui-même. Significative est l’une des scènes où elle apparaît : dansant dans une boite techno où sont projetées des images de Nosferatu le Vampire… Le protagoniste arrive, puis s’enfuit finalement par un couloir oppressant qui tient du tunnel et de l’antre intérieur.
À l’occasion de la manifestation psychosomatique de troubles évidemment liés à ce qu’il a vécu, refoulé, mal géré, Massimo fait la rencontre d’Élisa, une doctoresse avec qui il va se lier et qui va l’aider à se soigner. Une sage-femme qui va lui permettre de chasser ses démons, de se reconstruire – cf. la scène du miroir -, d’oublier cette présence obsédante de la mère faussement immortelle, de se réconcilier avec ce qu’il ressent comme hostile. Et enfin de mieux vivre au présent… et avec elle.
Marco Bellocchio est sans nul doute l'un des grands réalisateurs européens. Il offre une mise en scène magistrale, où chaque détail a son importance dans la narration. Malgré le démarrage compliqué du film, il parvient à reconstituer un puzzle savamment construit. On pense par exemple à cette retransmission des jeux olympiques où le petit garçon regarde des nageurs plonger, scène qui se reproduit à d'autres endroits du film. Il reconstitue dans un même appartement italien autant d'époques, jouant avec l'environnement proche comme un stade, les séries ou les émissions télévisées, faisant presque penser à un film testament où le réalisateur raconte 30 ans de sa vie et de son regard sur le monde. Depuis son premier film, Bellocchio excelle dans les récits familiaux à trous qui mêlent la grande et la petite histoire. Ici, il revient avec une œuvre tragiquement belle, où la politique, les non-dits, la violence des sentiments et surtout la fragilité magique de la relation parents-enfants traversent les années et les générations.
Beaucoup d'émotion dans ce film et surtout une justesse dans les sentiments qui s’expriment à travers des détails, comme un vieux journal qui détient la vérité, un secret de famille bien caché, une intensité dans les relations familiales, un univers d'enfant peuplé de croyances et de chagrins incompris ;et puis, un jour, une lettre du courrier des lecteurs qui va tout bouleverser. A voir sans modération…
Mars 2017 Jn-C Faivre d’Arcier
Ce film chilien est inspiré de l’œuvre poétique de Pablo Neruda
NERUDA
Film chilien de Pablo LARRAIN – 2016
 1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Oscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, accompagnés du peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Neruda joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, il y voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire…
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Oscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, accompagnés du peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Neruda joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, il y voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une légende littéraire…
Le tournage de Neruda a duré 55 jours au Chili, en Argentine et en Europe. Durant l’hiver, une violente tempête de neige a fait de nombreux dégâts à la fin du tournage dans les Andes : le plateau a dû fermer pendant plusieurs jours et des membres de l’équipe ont souffert d’hypothermie. Le film a été choisi pour représenter le Chili pour l’Oscar du Meilleur film étranger en 2017 ; il a été aussi présenté au 69e Festival de Cannes à la Quinzaine des Réalisateurs.
Interrogé par le journaliste Dominique Widemann dans le journal L’Humanité, Gaèl Garcia Bernal (qui interprète l’inspecteur Oscar Peluchonneau) disait : ‘’ Lorsque vous êtes latino-américain, vous étudiez Neruda comme s’il s’agissait d’un totem. Je l’avais lu avant la préparation du film mais jamais avec cette intensité. J’ai été en effet très impressionné par l’ampleur de sa force poétique, pas seulement par celle de sa vie ou de son impact politique. Le film de Pablo Larrain est inspiré de l’œuvre de Neruda. Dans la vie d’un poète d’une telle dimension, l’œuvre est la création de sa vie. Les deux sont imbriquées. Dans un texte de l’importance du Chant général, Neruda dresse un panorama de l’Amérique latine. Il joue avec le présent et le passé. À sa manière il construit un pays. Il construit aussi plusieurs vies en une seule. Certains extraits résonnent très fortement avec mes expériences personnelles. D’une certaine façon, Neruda m’est devenu très proche. Pour Pablo Larrain, il était inenvisageable de réduire le poète à un exercice de biographie. Le film est lui-même une construction poétique « nérudienne ». Quelque chose de cubiste auquel la composition de Picasso et le jeu des indices à la Borges ajoutent une dimension quasiment métaphysique. Le film est devenu un poème avec des orientations épiques…’’
Qui est cet Oscar Peluchonneau ?, lui demande alors le journaliste : ‘’ C’est un paria, le fils d’une prostituée. Il a opté pour le fascisme. Cela avait commencé par un archétype : un policier fasciste intellectuel. Cet archétype du conservateur de l’époque de l’après-guerre, qui n’a pas accepté la défaite et qui patauge dans le doute et le ressentiment, a joué un rôle majeur pour m’inspirer l’imaginaire de Peluchonneau. C’est aussi un homme de spectacle. Il se permet de critiquer en termes violents le système auquel il obéit comme il le fait du communisme. Il crache sur le président des États-Unis. Le moment politique le plus important du film se joue selon moi lorsqu’au cours de cette grande fête très luxueuse organisée pour Neruda et ses amis, une femme du peuple, militante communiste, s’adresse à lui en ces termes : « Si nous gagnons, est-ce que nous pourrons vivre comme toi ? » C’est l’une des questions auxquelles le communisme doit répondre. Donner de la consistance à ces questions politiques, comme celle de l’égalité dans la société, celle d’une victoire visant à créer un monde dans lequel l’imagination serait au pouvoir, c’est l’une des grandes ambitions du film et l’une des raisons qui me rendent très heureux d’en faire partie.’’
Pablo Larrain se sert du fragile fil de vérité, caché dans le roman qu’on a fait de Neruda, pour hisser son scénario au-dessus de la réalité, au pays des fantasmes et des rêves. Aussi, ce portrait de Pablo Neruda ne suit-il pas la route des livres d'histoire, mais un chemin plus escarpé qui vous entraîne depuis les orgies d'une gauche chilienne aisée, vers les étendues neigeuses de la Cordillière des Andes. ‘’J'ai voulu capturer un aigle sans savoir voler’’, avoue piteusement le flic chargé de mettre le poète en cage. Pablo Larrain, lui, a les ailes et l'envergure cinématographique qu'il faut pour pouvoir planer à la hauteur de cette figure incontournable de l'histoire contemporaine chilienne.
Mais sa vie de pacha et de patachon, n'aura pas empêché ce bon vivant, amateur de femmes et de fêtes, de traduire avec ses mots fulgurants, les maux de la classe ouvrière. Porte-parole de la souffrance de tout un peuple, ce bourgeois, ce sénateur à la sensibilité prolétarienne est devenu un héros épique. C'est cette dimension romanesque qu'explore le film, en n'hésitant pas à rouler dans les ornières du polar, ni de chevaucher au coeur des vastes étendues du western. Autre personnage principal de ce film, les poésies de Neruda qui ponctuent le récit, et le suivent comme une traînée de poudre. Pablo ne savait pas tirer au pistolet, mais ces mots eux, font mouche... Qu’on relise, par exemple, les poèmes que Neruda a consacrés à cette période de sa vie : la section X du Chant Général, intitulée ‘’Le fugitif’’, mais surtout le discours prononcé à Stockholm à l’occasion du Prix Nobel de littérature, recueilli dans son livre Né pour naître sous le titre : ‘’La poésie n’aura pas chanté en vain’’. Le poète y fait le récit de sa traversée des Andes, créant un mythe de la solidarité humaine qui permet, mieux que tout ce qu’on saurait en dire, de restituer le film de Pablo Neruda dans sa ligne poétique.
Dans la nuit haute en empruntant la terre entière,
Allant des larmes au papier, de vêtement en vêtement,
J’avançai en ces jours soucieux.
J’étais le fugitif traqué par la police :
Et lorsque l’heure est de cristal, dans l’épaisseur
et la solitude stellaires,
je traversais des villes, des forêts,
des métairies, des ports au milieu des montagnes,
du seuil d’un être humain à celui d’un autre homme,
d’une main à une autre main, puis à une autre.
La nuit est grave, pourtant l’homme
l’a jalonnée de signaux fraternels
et tâtonnant par les chemins, palpant les ombres,
j’arrivai à la porte illuminée, au petit point
étoilé qui était le mien,
à ce quignon de pain que les loups dans le bois
n’avaient pas dévoré…
… Je serrai une main,
Des mains, j’aperçus leurs visages,
ils ne me disaient rien : c’étaient des portes
jamais vues encore dans la rue,
des yeux qui ne connaissaient pas mes traits,
et dans la haute nuit, à peine
en mon nouveau logis, j’étendis ma fatigue,
je laissai s’endormir l’angoisse du Chili …
(Le fugitif, 1948)
Mars 2017 Jn-C Faivre d’Arcier
Ce film a pour ambition de redonner à notre monde un peu de sa clarté disparue
PERSONAL SHOPPER
Film français d’Olivier ASSAYAS – 2016

Maureen, est l’assistante personnelle d’une célébrité, chargée de sa garde-robe. C’est un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas trouvé mieux pour payer son séjour et attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment décédé à Paris. Lorsque son portable reçoit d’étranges SMS, elle se convainc que c’est l’esprit du défunt qui essaie d’entrer en contact avec elle… Personal Shopper, c’est une histoire de fantômes dans le milieu de la mode. Un film minimaliste aux références parfois énigmatiques. Un jeu de piste, construit autour de Kristen Stewart, qui joue le personnage de Maureen. Le film est fait en plusieurs tableaux, mêlant le réalisme de la vie et de la ville – Paris est merveilleusement filmé – et le fantastique qui naît du drame intime entre le frère et la sœur.
Maureen vit en faisant la Personal Shopper, assistante d’une célébrité (actrice ou chanteuse ? On ne sait jamais…) chargée de courir les salons de présentation des marques de luxe pour emprunter tel pantalon en cuir ou tel bracelet doré. Elle déteste autant sa patronne que son travail, pour lequel elle est payée en billets de 500 euros. Sur son téléphone portable, elle reçoit des texto d’un numéro inconnu. S’ensuit une correspondance, assez improbable, l’interlocuteur anonyme la poussant à devenir une autre, à se comporter autrement, à enfiler les robes de sa boss, à se réinventer dans la peau d’un être imaginaire.
Les robes de tulle ou de soie, que Maureen emprunte à sa patronne, sont légères et lui donnent l’air d’un elfe. Mais, roulées comme des chiffons dans des sacs pleins de logos, elles sont lourdes et la jeune femme peine à les porter. Paradoxalement, les moments les plus marquants de Personal Shopper sont ceux où Kristen Stewart est dépouillée de ses habits luxueux, mise à nu, non pas physiquement mais émotionnellement, seule, traînant ses désillusions et ses angoisses dans les rues de Paris. L’actrice y est filmée telle qu’elle apparaît : un corps d’aujourd’hui, passé par tous les engrenages du divertissement et de la culture contemporaine, une beauté dévorée par le luxe et par le cinéma. Au fond, l’esprit dont elle attend la manifestation, c’est elle.
Visuellement, Personal Shopper ouvre un champ très large à l’imagerie fantomatique. Maureen est affligée de la même malformation cardiaque que son frère jumeau, mort il y a peu, à 27 ans, et Maureen est médium. Elle attend que l’esprit du défunt se manifeste à elle, comme ils se l’étaient promis. Et, en effet, des esprits surviennent, masses gazeuses apparaissant dans une atmosphère propice créée par de magnifiques mouvements de caméra superbement enchaînés. Pour représenter le spectre, Assayas filme des ectoplasmes en effets spéciaux, leur matière blanche tournoyant autour de Maureen, et il recrée les séances de spiritisme de Victor Hugo à Jersey dans une séquence très démonstrative en noir et blanc.
Personal Shopper dénonce le matérialisme, les objets de luxe sont omniprésents, produits par Chanel ou Cartier. En centrant l’attention sur celle qui porte les paquets et non pas les robes, le cinéaste expose le mécanisme de cette industrie du luxe qui est devenue l’un des piliers du ‘’glamour’’. On connaît le rapport de fascination/répulsion que Olivier Assayas entretient avec ce monde-là, et il déploie ici une critique sévère de ce matérialisme hystérique et sans retenue. Mais on ne peut s’empêcher de trouver qu’il y a quelque chose d’étrange dans la démarche du film : Maureen se plaint du monde de la presse où les annonceurs imposent leurs choix éditoriaux, alors même que le contrat Chanel de son interprète, Kristen Stewart, offre au film la possibilité d’étendre son exposition jusque dans la sphère des non-cinéphiles. A chaque instant, apparaît son projet de rassembler, dans un même film, une description de ce réel et sa critique violente, une fiction cinématographique et un jugement porté sur la réalité mise en scène.
Pour conclure, j’aimerai citer Aurélien Montagu dans la présentation qu’il fait du film pour la revue VO, Version Originale de décembre 2016 : ‘’Le limbes du film sont dans cet entre deux, (le matérialisme contemporain) où cette femme se débat contre la solitude qui la gagne (et qui l’ouvre à une recherche spirituelle dans le spiritisme). Mais aussi cet espace entre la tradition et la modernité. Sans le savoir, Maureen n’y est jamais seule : Assayas est toujours à ses côtés, tiraillé par ses propres démons, notamment celui de vouloir connecter les racines du cinéma, et plus généralement de l’art – en plus de Victor Hugo, il est aussi question d’Hilma Klint, une des pionnières de la peinture abstraite – avec l’époque contemporaine et l’air du temps. Et si le véritable fantôme de Personal Shopper était au contraire une profonde envie de redonner à notre monde un peu de sa clarté disparue ?’’
Mars 2017 Jn-C Faivre d’Arcier
ans l’espace, la vie d'un couple, isolé de toute autre présence humaine
PASSENGERS
Film américain de Morten TYLDUM – 2016
 A bord du vaisseau spatial ‘’Avalon’’, Aurora et Jim voyagent en hibernation, depuis 15 ans, en compagnie de 5000 autre passagers pour une traversée qui doit durer 120 ans. Sans explication, ils se réveilleront 90 ans trop tôt. Il leur est impossible de se replonger dans un sommeil artificiel. Alors que des sentiments commencent à naître entre eux, Aurora et Jim se rendent compte que le vaisseau est menacé de destruction. Ils vont tout tenter pour sauver leur vie et celle des autres passagers. A ses risques et périls, Jim entreprend de réparer les dommages… Écrit par Jon Spaights (Prometheus, Docteur Strange) et réalisé par le Norvégien Morten Tyldum (Imitation Game), Passengers est un huis-clos moderne dans l’espace. Le film mêle science-fiction et romance, intimité et spectacle à bord d’un vaisseau spatial, en route vers la colonie Homestead II. Les décors, le casting et la bande-son, signés Thomas Newman, participent également au rythme de cette belle histoire d’amour, loin de la Terre…
A bord du vaisseau spatial ‘’Avalon’’, Aurora et Jim voyagent en hibernation, depuis 15 ans, en compagnie de 5000 autre passagers pour une traversée qui doit durer 120 ans. Sans explication, ils se réveilleront 90 ans trop tôt. Il leur est impossible de se replonger dans un sommeil artificiel. Alors que des sentiments commencent à naître entre eux, Aurora et Jim se rendent compte que le vaisseau est menacé de destruction. Ils vont tout tenter pour sauver leur vie et celle des autres passagers. A ses risques et périls, Jim entreprend de réparer les dommages… Écrit par Jon Spaights (Prometheus, Docteur Strange) et réalisé par le Norvégien Morten Tyldum (Imitation Game), Passengers est un huis-clos moderne dans l’espace. Le film mêle science-fiction et romance, intimité et spectacle à bord d’un vaisseau spatial, en route vers la colonie Homestead II. Les décors, le casting et la bande-son, signés Thomas Newman, participent également au rythme de cette belle histoire d’amour, loin de la Terre…
Depuis le succès de Gravity (2013), le ‘’space opera’’ a la cote : Jupiter : le destin de l’univers (2014), Les Gardiens de la galaxie (2014), Interstellar"(2014), Seul sur Mars (2015), Star Trek et Star Wars étant de retour en 2016. Passengers renoue avec la veine catastrophe du genre, saupoudrée de glamour avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt piégés dans un Titanic intergalactique. Derrière la caméra, le Norvégien Morten Tydurn s’est fait remarquer avec Headhunters (2011), arrivé premier au box-office norvégien, lauréat de prix à Beaune, puis à L’Étrange festival, et surtout avec Imitation Games, nommé aux Oscars, et évoquant l’aventure d’Alan Turing, décrypteur du code nazi Enigma durant la Seconde Guerre mondiale. Une belle carte de visite pour se voir confier un bon contrat hollywoodien. Passengers passe toutefois un peu en retrait par rapport aux grosses machines de l’année, en matière de science-fiction, Star Trek Outer Limits, Rogue One : A Star Wars Story, et même Premier Contact.
Cet étonnant film de science-fiction avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence nous plonge dans la poésie d'une love story... dans l'espace. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils vont devoir passer toute leur vie ensemble, en huis clos, sans autre présence que la leur. C'est l'histoire incroyable que conte Passengers. Cryogénisés, c'est-à-dire congelés, ainsi que 5000 autres passagers dans un vaisseau spatial géant, où ils sont supposés dormir 120 ans et se réveiller sur une autre planète au terme d'un voyage interstellaire, Jim et Aurora sortent de leur cocon 90 ans trop tôt à la suite d'un incident technique. Pas tout à fait au même moment d'ailleurs, mais on n'en dira pas plus pour ne pas gâcher la surprise des spectateurs. Toujours est-il que les voilà face à face, lui le mécanicien, elle la jeune idéaliste, découvrant qu'ils ont le reste de leur existence à vivre ensemble dans cette gigantesque machine de l'espace, avec pour seuls compagnons 5 000 endormis et quelques robots.
L'intrigue se corse lorsqu'un autre problème technique met le vaisseau en grave danger : à eux de sauver les autres passagers. Autant le dire tout de suite, ce rebondissement très hollywoodien ne constitue pas le meilleur du film. Non, l'intérêt est ailleurs : dans Passengers, on assiste à la vie d'un couple, isolé de toute autre présence humaine. Et c'est absolument étonnant. Rencontre, tentatives de drague, rapprochements, déceptions, puis naissance de la passion, euphorie amoureuse, déchirements, séparation, retrouvailles inespérées : tout ce la joie ou le malheur de la vie d'un couple y passe. Une vie entière à deux qui se déroule sous nos yeux, et à laquelle on ne peut, forcément, que s'identifier à un moment ou à un autre.
Pour en arriver à cette intimité, les deux comédiens du film, Chris Pratt et Jennifer Lawrence, ont vécu une expérience peu commune. Interrogé, il y a un mois à Paris, Pratt explique que ce fut ‘’un tournage unique en son genre. Nous étions seulement deux comédiens, avec de longues scènes où nous sommes seuls chacun de notre côté, filmés dans d'immenses hangars. Nous n'avons pas vu le jour durant des mois’’. Le film étant bourré d'effets spéciaux, le réalisateur, Morten Tyldum, pour éviter à ses comédiens de passer de trop longs moments, seuls devant des écrans verts, a tenu à construire ‘’en dur’’ le plus d'éléments possible du vaisseau. ‘’A tel point que nous avions l'impression de réellement évoluer dans ce gigantesque cargo de l'espace. D'autant que toutes les lumières que l'on voit à l'écran n'ont pas été rajoutées en postproduction : les ingénieurs ont inventé des systèmes avec des lampes-leds pour que le vaisseau soit réellement éclairé. Pour nous, c'était plus confortable’’… C'est sans doute ce confort qui a permis aux acteurs de jouer en toute sérénité cette étonnante love story de l'espace, offerte au spectateur.
On n’est donc pas dépaysé, hormis l’environnement de science-fiction qui offre de belles images spatiales, dans le magnifique design du vaisseau Avalon, ses intérieurs technologiques aseptisés et ses séquences de "marches" dans l’espace, ou la traversée du champ d’astéroïdes en ouverture du film. Les scènes de catastrophe pure ne sont pas délaissées, comme celle d’une rupture de la gravité, où Jennifer Lawrence se retrouve prisonnière d’une gigantesque bulle d’eau en apesanteur, non dénuée de poésie. L’humour n’est pas absent non plus, notamment dans des clins d’œil à Alien, Shining et 2001 Odyssée de l’espace, références obligées des jeunes réalisateurs. Le jeu sur le temps, avec ses conséquences sur la relation entre les deux amants n’est pas sans intérêt, tout comme le stratagème ambigu du mécano pour se sortir de sa solitude. Jennifer Lawrence et Chris Pratt parviennent à mettre un peu de passion dans ces espaces glacés où il n’est pas désagréable d’embarquer.
Un beau film romance, dans un monde de sciences fiction. Avec des trucages numériques très bien réalisés. Il manque pourtant d’action dans ce scénario un peu trop prévisible. Bref un film à voir, mais sans attendre de grandes surprises.
Mars 2017 Jn-C Faivre d’Arcier
Ce film audacieux, qui relate la vie de François et de son ami Elie,
met en scène la brusque rencontre avec le présent, lorsqu'on s'y attend le moins.
L’AMI,
FRANCOIS D’ASSISE ET SES FRERES
Film franco-italo-belge de Renaud FELY et Arnaud LOUVET – 2016
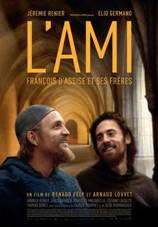 En 1209, en Italie, entouré d’amis et de disciples, François d’Assise (1181-1226) recherche la vie simple et fraternelle auprès des plus démunis. Il fascine et dérange l’Eglise du Pape Innocent III, qui lui demande d’assouplir son projet de règle fondatrice de leur fraternité, qui deviendra l’Ordre des Frères mineurs. Entouré de ses frères et porté par une foi intense, François lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et d’égalité… Quand Renaud Fely et Arnaud Louvet commencent à faire des recherches sur François d’Assise, ils découvrent un personnage fascinant. Pour ne pas mettre en scène un film classique, ils écrivent une histoire d’amitié ‘’romanesque et intimiste’’ ; ils se sont inspirés des westerns de John Ford pour la photographie. Jérémie Renier et Olivier Gourmet se retrouvent pour jouer les personnages principaux, après avoir collaboré dans plusieurs films des Frères Dardenne.
En 1209, en Italie, entouré d’amis et de disciples, François d’Assise (1181-1226) recherche la vie simple et fraternelle auprès des plus démunis. Il fascine et dérange l’Eglise du Pape Innocent III, qui lui demande d’assouplir son projet de règle fondatrice de leur fraternité, qui deviendra l’Ordre des Frères mineurs. Entouré de ses frères et porté par une foi intense, François lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et d’égalité… Quand Renaud Fely et Arnaud Louvet commencent à faire des recherches sur François d’Assise, ils découvrent un personnage fascinant. Pour ne pas mettre en scène un film classique, ils écrivent une histoire d’amitié ‘’romanesque et intimiste’’ ; ils se sont inspirés des westerns de John Ford pour la photographie. Jérémie Renier et Olivier Gourmet se retrouvent pour jouer les personnages principaux, après avoir collaboré dans plusieurs films des Frères Dardenne.
Dans la fiche de présentation du film, Francesca Feder interroge les deux cinéastes : D’où est venue l’idée de faire un film sur François d’Assise ?
‘’Le film est né sur plusieurs années. Nous avions vu les fresques de Giotto et les Onze Fioretti de Roberto Rossellini, que nous aimions beaucoup. C’était peu, mais suffisant pour nous donner envie d’en savoir plus. Nous avons lu son histoire et nous nous sommes retrouvés devant un personnage hors du commun, complètement fascinant. Un fils de la bourgeoisie qui décide de tout plaquer pour aller aider les plus pauvres et prêcher le rêve d’une société fraternelle. A contre-pied des pouvoirs dominants, il réinvente une vie libre, dénuée de toute attache matérielle, en remettant le besoin de l’Autre au centre de tout. Son charisme, son talent oratoire et sa sincérité entraînent derrière lui des hommes de partout, des lettrés, des érudits, des Croisés repentis, des clercs comme des laïcs, mais aussi des paysans et des miséreux. Et tout le monde vit là ensemble… Le mouvement s’étend, commençant à poser des problèmes au pouvoir en place. Ce mélange de révolte douce, d’humanisme profond et d’utopie collective nous semblait magnifique à raconter.
En quoi le film est-il en rapport avec notre monde ?
Plus nous avancions dans nos recherches, plus le monde de François nous semblait étrangement familier. Le 13e siècle italien nous ressemble beaucoup avec l’explosion des inégalités, les guerres quasi-permanentes, la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns dans une période d’intense essor des échanges commerciaux, les exclus obligés de migrer ou d’errer sans fin … Tout nous renvoyait à des indignations que nous connaissons bien. Encore fallait-il trouver la bonne distance par rapport à la dimension religieuse de François. Nous nous sentions transportés par l’homme, mais un peu écrasés par le saint. Et Rossellini s’était déjà occupé de son message spirituel. Finalement, c’est en nous souvenant d’un autre film, Amadeus de Milos Forman où Mozart est regardé par Saliéri, que le déclic a eu lieu. L’idée d’un intercesseur entre le saint et l’homme, entre François et nous, s’est alors formée. Nous avons alors découvert l’existence d’Elie de Cortone parmi les premiers frères de François et le conflit central autour de la Règle qui les opposa. L’Ami devenait alors possible.
Quel est le sens du titre L’ami ? Elie n’est-il pas plutôt le traître, voire l’ennemi ?
Le titre ne parle pas que d’Elie. Nous pensons qu’il est plus générique que cela. L’ami raconte plutôt une tension entre les personnages. C’est une circulation, une position que chacun prend par rapport à l’autre au cours du film. L’ami est parfois avec, parfois contre, parfois en soutien, parfois en opposition, mais cette tension est toujours motivée par la nécessité d’une construction commune. C’est comme une traduction contemporaine du mot ‘’frère’’, une notion aussi intime que politique. En ce sens, réduire Elie à un traître ne lui rend pas justice. Au contraire, nous aimerions que le spectateur partage ses contradictions, qu’il le comprenne et puisse se projeter dans ses questions. Gilles Deleuze disait cette phrase magnifique sur l’amitié : ‘’Si tu ne saisis pas le petit grain de folie de quelqu’un, c’est que tu ne peux pas l’aimer’’. Nous pensons qu’Elie aimait profondément François. Il veut sans doute le servir plus que tout autre, et c’est ce qui l’entraîne trop loin sur un plan personnel.’’
Chiara Frugoni, historienne spécialiste de François, donne son avis sur le film : ‘’Pour la première fois dans ce film sur St François d’Assise, est évoquée l’amitié, ou mieux les divergences quant au projet de vie chrétienne entre François et un frère auquel il était très lié et qui lui fut à son tour dévoué : Elie de Cortone. Selon le premier biographe franciscain Thomas de Celano, ‘’François avait choisi Elie comme mère pour lui, et comme père pour les autres frères’’. Le film se concentre sur le rapport conflictuel entre deux hommes qui cherchent à exister et à être reconnus, l’un par l’autre. François voulait mettre en pratique, et de manière radicale, l’Evangile ; tant qu’il se trouva dans un petit groupe de camarades de grande vertu, il y arriva très bien, sans songer à l’après. Elie, quant à lui, était préoccupé par la façon d’institutionnaliser ce style de vie. Il voulait le bien de François, même contre son propre gré. Il voulut assurer le succès de l’ordre et du coup, ne pas refuser a priori, le rapport avec la hiérarchie ecclésiastique, les compromis, les arrangements. Pour lui, les Franciscains devaient réussir à durer dans le temps. De ces visions opposées, naît un affrontement qui impliquera aussi leurs camarades. Le film laisse au spectateur le choix de sa propre position, en suggérant l’intemporalité d’un tel dilemme, par ailleurs plus que jamais d’actualité’’.
C’est cette période de la vie de François, qui voit la fondation de l’Ordre, que raconte "L’Ami". Renaud Fely et Arnaud Louvet synthétisent sur un temps relativement court la quintessence du projet franciscain. Convaincu de la nécessité de créer son institution religieuse, François doit en soumettre la "règle" au pape pour la fonder. Une condition sine qua non. Dans cette optique, il doit la proposer, la débattre avec ses disciples, puis avec le cardinal de son diocèse ; il doit les convaincre de son bien-fondé, pour l’inscrire dans l’Eglise.
C’est cette pugnacité à convaincre qui constitue la part la plus intéressante du film. Car François, généralement identifié à une personnalité éthérée, se dévoile ici sous un jour combatif, pour imposer sa vision d’un retour au message du Christ. En butte non seulement à la hiérarchie cléricale, mais aussi à ses propres disciples, tous le trouvent trop exigent dans son ascèse. Il est notamment confronté à Elie de Cortone (Jérémie Renier), son bras droit, qui lui réclame plus de souplesse. Mais il trouve par contre une oreille attentive chez le Cardinal Hugolin (Olivier Gourmet) qui, à regret, lui demande de revoir sa copie, suite aux refus réitérés du Pape d’accepter sa "règle’’.
La disparition soudaine de François, qui laisse le groupe démuni face à son décès, est également un moment fort. Tout comme la rencontre avec Claire Offreduccio qui fondera sous son impulsion l’Ordre des sœurs Clarisse. La prise de pouvoir d’Elie sur le groupe, qui parviendra finalement à imposer une règle plus consensuelle, est ressentie pourtant comme une trahison envers la pure intransigeance de François.
Dès lors, l’articulation du film va tourner autour de cet enjeu – rester fidèle à l’idéal ou transiger pour être accepté –, toujours plus crucial à mesure que le nombre de frères s’accroît. Le François du film incarne l’idéal, fondé sur la confiance placée en Dieu, l’amour du dépouillement le plus total, la conviction que « l’Église ne doit pas nous changer », quitte à se placer en marge, au bord de l’hérésie.
Construit avec beaucoup d’intelligence, assumant ses pas de côté, célébrant la nature dans des images très belles mais jamais insistantes – citons, entre autres très jolies choses, ce furtif plan d’oiseaux se dispersant en gerbe au son d’une cloche –, le long métrage de Renaud Fely et Arnaud Louvet trouve très naturellement son équilibre et sa grâce.
Le décentrage consistant à s’intéresser en particulier à la figure d’Élie s’avère d’une belle pertinence, ouvrant avec délicatesse sur des questionnements aussi universels que contemporains. Près de mille ans nous séparent de François d'Assise, mais, ce qui touche le plus dans ce film audacieux, qui relate la vie du saint et de son ami radical Elie, est la brusque rencontre avec le présent, lorsqu'on s'y attend le moins.
Près de mille ans nous séparent de François d'Assise, mais, ce qui touche peut-être le plus dans ce film audacieux, qui relate la vie de François et de son ami Elie, c’est la brusque rencontre avec le présent, lorsqu'on s'y attend le moins.
Février 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Hélène est une autiste.
Mais elle est aussi une artiste.
Il n’y a qu’une lettre de différence.
DERNIERES NOUVELLES DU COSMOS
Film français de Julie BERTUCELLI – 2016
 A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit elle-même, ‘’d’un lot mal calibré, ne rentrant nulle part’’. Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle de son monde et du nôtre. Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue avec un mathématicien… Pourtant, Hélène ne peut pas parler, ni tenir un stylo. Elle n’a jamais appris à lire, ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux mystères de celle qui se surnomme ‘’Babouillec’’…Hélène Nicolas, qui a choisi comme nom d’artiste ‘’Babouillec Sp’’ (Sp pour sans parole), est née en 1985. Diagnostiquée autiste très déficitaire, elle intègre vers l’âge de 8 ans l’institution médico-sociale, qu’elle quitte à 14 ans. A partir de cette date, elle suit au domicile familial un programme de stimulations sensorielles accompagné d’activités artistiques et corporelles, un travail quotidien partagé avec sa sœur Véronique Truffert. Hélène n’a pas d’accès à la parole et son habileté motrice est insuffisante pour écrire. En 2006, après 6 années de recherches sur la place de la pensée dans l’existence de l’être, Babouillec Sp nous ouvre son univers. A l’aide d’un alphabet en lettres cartonnées et plastifiées, elle écrit des mots, des phrases, elle communique enfin. En 2009, elle écrit Raison et acte dans la douleur du silence. Ce texte reçoit les encouragements du Centre National du Théâtre. Il est créé au Festival ‘’Mettre en scène’’ par Arnaud Stephan. Depuis, Hélène poursuit son chemin dans l’écriture en composant des pièces atypiques pour le théâtre et des œuvres plus inclassables…
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit elle-même, ‘’d’un lot mal calibré, ne rentrant nulle part’’. Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle de son monde et du nôtre. Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue avec un mathématicien… Pourtant, Hélène ne peut pas parler, ni tenir un stylo. Elle n’a jamais appris à lire, ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux mystères de celle qui se surnomme ‘’Babouillec’’…Hélène Nicolas, qui a choisi comme nom d’artiste ‘’Babouillec Sp’’ (Sp pour sans parole), est née en 1985. Diagnostiquée autiste très déficitaire, elle intègre vers l’âge de 8 ans l’institution médico-sociale, qu’elle quitte à 14 ans. A partir de cette date, elle suit au domicile familial un programme de stimulations sensorielles accompagné d’activités artistiques et corporelles, un travail quotidien partagé avec sa sœur Véronique Truffert. Hélène n’a pas d’accès à la parole et son habileté motrice est insuffisante pour écrire. En 2006, après 6 années de recherches sur la place de la pensée dans l’existence de l’être, Babouillec Sp nous ouvre son univers. A l’aide d’un alphabet en lettres cartonnées et plastifiées, elle écrit des mots, des phrases, elle communique enfin. En 2009, elle écrit Raison et acte dans la douleur du silence. Ce texte reçoit les encouragements du Centre National du Théâtre. Il est créé au Festival ‘’Mettre en scène’’ par Arnaud Stephan. Depuis, Hélène poursuit son chemin dans l’écriture en composant des pièces atypiques pour le théâtre et des œuvres plus inclassables…
Julie Bertuccelli. Née en 1968, elle suit des études de philosophie, puis travaille pendant une dizaine d’années, comme assistante à la réalisation sur le nombreux longs-métrages. Elle réalise ensuite une dizaine de documentaires. Son premier long-métrage de fiction, Depuis qu’Otar est parti … a été couronnée par une vingtaine de prix en France et à l’étranger, dont le Grand Prix de la Semaine de la Critique de Cannes 2003 et le césar de la meilleure première œuvre 2004. L’arbre, son deuxième long-métrage de fiction, tourné en Australie, est présenté en sélection officielle au festival de Cannes en 2010. Son documentaire La cour de Babel sort en salles en 2014, est nommé aux César et sacré Meilleur Documentaire des Trophées francophones du cinéma. Julie Bertuccelli est actuellement en préparation de son troisième long-métrage de fiction, Le dernier vide-grenier de Claire Darling. Elle répond aux questions de la journaliste de l’AFCAE (Assoc. Française des Cinémas d’Art et d’Essai) :
Comment avez-vous rencontré Babouillec ?
‘’J’ai fait la connaissance d’Hélène grâce au metteur en scène Pierre Meunier, qui préparait une pièce sur la fabrication de la parole. Il avait été ébloui par les textes d’Hélène. J’ai rencontré Hélène et sa mère Véronique lors d’une représentation. J’ai été subjuguée par la jeune femme, son mystère, sa manière particulière de communiquer, la dichotomie extraordinaire entre son corps, qui est ce que nous percevons d’elle en premier, et tout ce qu’elle recèle de passionnant, de génial, de si perturbant pour nos petites logiques humaines. J’ai tout de suite eu envie de la filmer, c’était comme une évidence.
Comment vivez-vous cet engagement à long terme qu’exige le documentaire ?
J’ai filmé Hélène sur deux ans, en faisant le choix d’être seule derrière la caméra. Intuitivement, je souhaitais établir une relation directe, une intimité forte avec elle. Je voulais faire le portrait, non d’une autiste au quotidien, mais d’une artiste, d’une poétesse au talent fulgurant, qui nous transmet sa vision du monde et de nos relations humaines. Ces deux ans ont été une source d’émerveillement. Hélène ne parle pas, mais tant de choses passent par les rires, les regards, les silences, les gestes, en plus de son écriture. C’était très émouvant de vivre tout cela et, en même temps, je me suis posé beaucoup de questions : comment réussir à rendre compte de la force de son écriture à l’écran ? Comment trouver la bonne manière de mettre en image l’énigme existentielle qu’incarne Hélène ?
L’exercice du portrait soulève de nombreuses interrogations, tant d’ordre technique que d’ordre éthique. Comment la caméra trouve-t-elle se juste place ?
En documentaire, c’est toujours très délicat de filmer les gens dans leur intimité, car il n’y a rien d’objectif et il faut qu’ils acceptent l’image qu’on va garder d’eux. J’ai fait le choix d’approcher Hélène par son travail d’écriture… Il s’agissait de s’accepter mutuellement pas à pas, d’établir une relation de confiance et enfin d’être complice. ‘’Partir de rien pour se rencontrer’’, comme elle le dit magnifiquement. Elle se sentait attirée par la caméra et l’a tout de suite apprivoisée. Elle la regardait d’un œil coquin, et se disait elle-même ‘’filmo-magnétique’’… Si elle n’a pas la parole, Hélène se raconte par l’écriture. Grâce à Véronique, sa mère, et à son travail de longue haleine, on peut dire que l’écriture est comme une seconde naissance… Sans avoir la prétention d’être dans sa tête, j’espérais évoquer l’intériorité d’Hélène, approcher et rendre le spectateur curieux et sensible à ce qu’elle était en train de vivre, d’absorber, de capter, les sensations qu’elle pouvait traverser…
Votre film est une leçon de vie, une quête de liberté ?
Hélène témoigne d’une liberté de pensée exceptionnelle, au-delà des barrières sociales. J’ai été touchée par le chemin qu’ont fait la mère et la fille pour aller à la rencontre l’une de l’autre… Le parcours exemplaire d’Hélène vers l’écriture, sa ténacité pour acquérir la liberté de s’exprimer, nous interpellent dans notre rapport à la différence, à notre façon de juger les autres… Nous filtrons beaucoup ce que nous vivons, alors qu’Hélène se nourrit de tous ses sens, elle a conscience de toutes les strates de l’existence. Cette extraordinaire puissance d’ouverture se retrouve dans sa création. Hélène est un concentré de vie, elle nous emmène toujours plus loin. Avec elle, la réponse est toujours plus forte que la question.
Vous filmez admirablement les silences d’Hélène. Avez-vous ressenti une dimension spirituelle chez elle ?
Comme elle le dit elle-même, Hélène a une relation spirituelle aux choses et aux gens, comme un don médiumnique. Elle dit vivre un voyage intersidéral, un ‘’va et vient avec le cosmos’’. Ses rapports à la nature, à l’espace et au temps, sont toujours d’ordre symbolique, métaphorique… Au-delà du portrait, mon plus grand plaisir serait que le film pose la question philosophique de notre place dans l’univers. Je pense à Pascal : ‘’L’homme est pris entre deux abîmes, l’infiniment petit et l’infiniment grand’’. Hélène nous questionne sur la relation métaphysique qui existe entre le microcosme en nous et le macrocosme qu’est l’espace. ‘’Je guette les étoiles qui brillent dans ma tête’’, écrit-elle dans Algorithme éponyme. Hélène a constamment la tête dans les étoiles. Il y a quelque chose de profondément joyeux en elle ; elle est libre de ses rêveries, la tête en l’air comme une enfant’’…
Voilà donc le portrait d’Hélène dite Babouillec, grande enfant de trente ans qui, sans avoir appris ni à lire ni à écrire, crée des poèmes d’une beauté sidérante. Hélène regarde, écoute, exprime sa joie et sa colère dans des manifestations d’énervement qui la rendent incontrôlable, Hélène vit et communique avec les autres. Elle nous donne à voir son combat et son sourire permanents. Et nous invite, mine de rien, à nous débarrasser de nos idées toutes faites et nous ouvrir aux autres. Par exemple avec ces mots, pris parmi d’autres, à l’adresse de la réalisatrice en cours de tournage : "Le film usé de nos scénarios sociaux sature les envies énigmatiques. L’œil goguenard de ta caméra filme tout bas le haut de nos êtres. J’adore…"
Pourtant, ce fossé qui sépare Hélène des autres n’est jamais totalement résorbé : les réactions à ses prises de parole sont toujours de l’ordre de l’interprétation, de la lecture subjective approximative, du déchiffrement. Il n’y a jamais dialogue mais monologue commenté par des tiers. Sa mère elle-même tente de comprendre le sens profond de ses aphorismes mais ses hypothèses demeurent toujours en suspens, et ne sont que rarement confirmées par l’intéressée. Hélène est une Pythie auprès de laquelle se pressent de nombreux oracles qui se heurtent aux modalités pratiques de l’échange. Ralenti par l’écrit, disloqué et alourdi par le dispositif, le discours est toujours frustré et réduit, le plus souvent, au sens unique. Néanmoins, au-delà de ces conditions difficiles de prise de parole, il y a aussi chez Babouillec un désir ferme, propre à la poétesse, d’aller vers une parole nouvelle, non-explicative, énigmatique qu’illustre bien le face à face raté avec un mathématicien désireux de conclusions claires. Dans cette parole que l’on dissèque et analyse, dans ce texte offert qui invite à l’admiration, la réalisatrice propose une belle réflexion sur le travail de l’artiste. En effet, à travers la figure de l’autiste, elle propose une version outrée du désastre de la communication entre le créateur et son public, toujours condamné, comme Hélène lors de la dernière scène d’applaudissements à Avignon, à le regarder incrédule, aveuglé, et incompris.
Dépassant le simple cadre d’un film sur le handicap, ce documentaire est une superbe réflexion sur la création et la poésie. Transcendant le cadre médico-social, le film questionne avec empathie les arcanes de l’art et de l’intuition. Hélène est une autiste. Mais elle est aussi une artiste. Il n’y a qu’une lettre de différence, …
Février 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Comment vivre après le décès de son enfant ?
UNE SEMAINE ET UN JOUR
Film israélien de Asaph POLONSKY – 2016
 A la fin du Shiv’ah, les 7 jours de deuil dans la tradition juive, l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants… Asaph Polonsky est né en 1983 en Israël où il a grandi. Puis il a fait des études de cinéma aux États-Unis. Une semaine et un jour a été présenté avec succès à la Semaine de la Critique de Cannes en 2016 où il a remporté le prix de la Fondation GAN. Le film a également glané sept nominations aux Ophir 2016, les Prix de l’Académie du cinéma israélien, dans les catégories : meilleur film, réalisateur, acteur, actrice, second rôle masculin, scénario et montage.
A la fin du Shiv’ah, les 7 jours de deuil dans la tradition juive, l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants… Asaph Polonsky est né en 1983 en Israël où il a grandi. Puis il a fait des études de cinéma aux États-Unis. Une semaine et un jour a été présenté avec succès à la Semaine de la Critique de Cannes en 2016 où il a remporté le prix de la Fondation GAN. Le film a également glané sept nominations aux Ophir 2016, les Prix de l’Académie du cinéma israélien, dans les catégories : meilleur film, réalisateur, acteur, actrice, second rôle masculin, scénario et montage.
La bande-son a été composée et interprétée par Tamar Aphek, célèbre figure du rock israélien depuis une décennie, qui a aussi du succès en Europe. Ses compositions électro-rock trouvent un juste équilibre entre élégance et brutalité, force et fragilité, métal féroce et mélodie. Elle a débuté comme chanteuse guitariste dans les groupes Carusella et Shoshana, puis s’est lancée dans une carrière solo. En 2016, elle a fait une tournée en Europe et aux États-Unis pour la sortie de son second album. Asaph Polonsky a participé à un entretien pour le journal de Sophie Dulac Distribution :
Qu’est-ce que la Shiv’ah dans la religion juive ?
C’est la semaine de deuil qui suite les funérailles du défunt. Sept jours pendant lesquels les parents et les amis se relaient continuellement auprès de la famille endeuillée, pour la soutenir et la réconforter. Shiv’ah s’achève le matin du 7e jour. Pendant cette période, les personnes en deuil ne travaillent pas et, la plupart du temps, restent chez elles. C’est comme une parenthèse, une interruption de la vie, pour surmonter sa douleur et se souvenir.
Parlez-nous de la genèse du film
L’un de mes amis a perdu sa petite amie très jeune. Sa mort a été un choc. Plus tard, un groupe d’amis est venu lui rendre visite chez ses parents et se sont assis à ses côtés, dans le silence. Puis, l’un d’eux a demandé à notre ami endeuillé s’il lui restait l’herbe médicinale que fumait son amie. Tout le monde s’est tourné vers lui, interloqués par cette question incongrue. Ce moment m’a marqué car chacun a sa façon d’affronter le chagrin. Dans le film, Vicky, la mère et Eyal, le père font face au deuil à leur manière, mais finalement traversent la même épreuve : ils veulent, l’un et l’autre, vivre les choses comme ils l’entendent, sans prendre en considération les regards extérieurs. Vicky souhaite retrouver sa routine habituelle, tandis que Eyal rompt avec la sienne… Ce qui m’intéresse le plus, c’est la fin de cette parenthèse : ce qui se passe quand l’existence, ses obligations et sa routine reprennent leurs droits, et que le principe de réalité resurgit. Brutalement. C’est pour cela que mon film commence à ce moment, à la fin du Shiv’ah.
La musique du film joue un rôle fondamental…
Absolument. La bande originale mélange certaines chansons de Tamar Aphek et la musique créée sur mesure par Ran Bagno. J’aine beaucoup le morceau Star Quality de Carusella, le groupe dans lequel Tamar officiait avant. Je trouvais qu’il collait parfaitement avec la situation décrite. J’ai composé avec les chansons de Tamar, comme si elles étaient un personnage du film ; et ensuite, est intervenu le travail de Ran, qui devait différencier l’écriture de la musique des chansons elles-mêmes. Il a fallu trouver le juste équilibre…
Après avoir enterré leur fils, la mère se jette dans des rendez-vous concrets, au cimetière, chez le dentiste, à l’école où elle travaille, le père lâche les obligations et prend la tangente. Plus aucune concession, plus aucune retenue. Quitte à repousser les voisins et à chiper le cannabis thérapeutique de son fiston à l’hôpital pour le fumer à la maison. Par l’humour, Asaph Polonsky dynamite la douleur, tout en la reconnaissant. La première scène donne le ton, avec Eyal engageant les gosses présents chez lui à se prendre une raclée au ping-pong. D’une humanité réjouissante, le couple brille sous les traits de deux solistes, Shai Avivi et Evgenia Dodina, qui excellent dans la retenue et la finesse d’une incarnation sans esbroufe de parents dévastés. Face à eux, Tomer Kapon réjouit dans son rôle de jeune voisin un peu fou. Ce récit filme avec bienveillance extrême et maturité la survie de l’individu face à l’inacceptable. Et l’amour enveloppe tout sur son passage, des p’tits chatons trimballés à droite à gauche au partage de la fumette, d’une chorégraphie d’opération à une moustache inédite. Épatant et bouleversant. Un cinéaste est né.
Février 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
L’histoire d’un couple qui découvre l’enfer que vivent les enfants
amenés à fouiller pour survivre dans la décharge de Phnom-Penh.
LES PEPITES
Film français de Xavier de Lauzanne – 2016
 «On n'avait rien construit avant», remarque Marie-France, avant qu'elle et son époux Christian ne s'installent au Cambodge, il y a vingt ans, pour y créer une école pour les enfants des rues. A l'époque, ils ont vu ces gamins trimer dans les décharges à ciel ouvert de Phnom-Penh. Des filles et des garçons perdus, condamnés à une vie de misère. A ce jour, le couple a permis à près de 10 000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir... Lors d’un voyage au Cambodge, Christian et Marie-France des Pallières découvrent l’enfer que vivent les enfants amenés à fouiller pour survivre dans la décharge à ciel ouvert de Phnom-Penh. Dans un premier temps, ils commencent à leur distribuer des repas, puis construisent une paillote à la lisière de la décharge, où les gamins peuvent venir se restaurer. Pas à pas, le couple s’engage davantage encore, fonde l’association « Pour un sourire d’enfant (PSE) », part récolter des fonds pour faire construire une école et sortir ces enfants de la misère. Pour compenser le « manque à gagner » des familles récalcitrantes, dont la progéniture était jusqu’alors exploitée dans les décharges, ils font distribuer des kilos de riz et mettent en place une infirmerie pour soigner les enfants.
«On n'avait rien construit avant», remarque Marie-France, avant qu'elle et son époux Christian ne s'installent au Cambodge, il y a vingt ans, pour y créer une école pour les enfants des rues. A l'époque, ils ont vu ces gamins trimer dans les décharges à ciel ouvert de Phnom-Penh. Des filles et des garçons perdus, condamnés à une vie de misère. A ce jour, le couple a permis à près de 10 000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir... Lors d’un voyage au Cambodge, Christian et Marie-France des Pallières découvrent l’enfer que vivent les enfants amenés à fouiller pour survivre dans la décharge à ciel ouvert de Phnom-Penh. Dans un premier temps, ils commencent à leur distribuer des repas, puis construisent une paillote à la lisière de la décharge, où les gamins peuvent venir se restaurer. Pas à pas, le couple s’engage davantage encore, fonde l’association « Pour un sourire d’enfant (PSE) », part récolter des fonds pour faire construire une école et sortir ces enfants de la misère. Pour compenser le « manque à gagner » des familles récalcitrantes, dont la progéniture était jusqu’alors exploitée dans les décharges, ils font distribuer des kilos de riz et mettent en place une infirmerie pour soigner les enfants.
Le réalisateur Xavier de Lausanne retrace leur extraordinaire parcours, recueille des témoignages, et montre les actions concrètes menées par cet homme et cette femme, surnommés « Papy et Mamy », mus par un désir altruiste et généreux. Il y a beaucoup d’amour entre eux, cela se sent et touche au cœur. Ensemble, soudés et complices, ces deux aventuriers ont déplacé des montagnes et offert un horizon à ces enfants perdus. Il n’y a rien d’un conte de fées ici, juste une démonstration que le courage et l’espoir peuvent parfois triompher. Mais Christian des Pallières, est mort le 24 septembre dernier à Phnom Penh. Il ne verra donc pas la célébration des efforts accomplis avec son épouse Marie-France.
Le film de Xavier de Lauzanne ambitionne de faire le portrait de ce couple tout en donnant la mesure de son œuvre. L'histoire semble trop belle pour être vraie, sauf qu'elle est vraiment vraie. Là où ce film la rehausse encore et devient un vrai film de cinéma et pas seulement l'enregistrement d'une histoire édifiante, c'est par le montage émotionnel entre images d'aujourd'hui et d'archives.
Si le cinéaste, déjà auteur du réjouissant D'une seule voix, souhaitait mettre en avant l'émotion suscitée par ces liens familiaux de substitution, sa démarche prend une forme parfois convenue qui relève plus du récit hagiographique que du documentaire engagé. Dommage… Pourtant, ce film est un formidable documentaire, très émouvant et optimiste en même temps. Ce couple de français - et tous leurs parrains - ont mené une entreprise vraiment impressionnante à l'autre bout du monde.
Février 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Film en hommage au poète William Carlos Williams
PATERSON
Film américain de Jim JARMUSCH – 2016
 Paterson vit à Paterson (New Jersey), une ville de poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… Présenté en compétition au 69e Festival de Cannes, Paterson est le 12e long-métrage de Jim Jarmusch. Le nom de film fait référence à cette ville du New-Jersey qui compte 150.000 habitants. Le personnage de Paterson est créé en hommage au poète William Carlos Williams, que le cinéaste américain affectionne particulièrement. Il explique : ‘’Paterson est une histoire tranquille, sans conflit dramatique à proprement parler. Sa structure est simple : il s’agit de suivre sept journées dans la vie des personnages. Paterson rend hommage à la poésie des détails, des variations et des échanges quotidiens. Le film se veut un antidote à la noirceur et à la lourdeur des films dramatiques et du cinéma d’action. C’est un film que le spectateur devrait laisser flotter sous ses yeux, comme des images qu’on voit par la fenêtre d’un bus qui glisse, comme une gondole, à travers les rues d’une petite ville oubliée ‘’.
Paterson vit à Paterson (New Jersey), une ville de poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… Présenté en compétition au 69e Festival de Cannes, Paterson est le 12e long-métrage de Jim Jarmusch. Le nom de film fait référence à cette ville du New-Jersey qui compte 150.000 habitants. Le personnage de Paterson est créé en hommage au poète William Carlos Williams, que le cinéaste américain affectionne particulièrement. Il explique : ‘’Paterson est une histoire tranquille, sans conflit dramatique à proprement parler. Sa structure est simple : il s’agit de suivre sept journées dans la vie des personnages. Paterson rend hommage à la poésie des détails, des variations et des échanges quotidiens. Le film se veut un antidote à la noirceur et à la lourdeur des films dramatiques et du cinéma d’action. C’est un film que le spectateur devrait laisser flotter sous ses yeux, comme des images qu’on voit par la fenêtre d’un bus qui glisse, comme une gondole, à travers les rues d’une petite ville oubliée ‘’.
La ville de Paterson est connue par une histoire ouvrière et syndicale importante, ainsi que par sa diversité ethnique. Aujourd’hui, elle est davantage réputée pour sa criminalité. Plusieurs artistes sont issus de cette ville, notamment Allen Ginsberg qui y a passé sa jeunesse et William Carlos Williams ; deux artistes qui ont cherché à mettre en rapport la poésie et la ville. Dans le film de Jarmusch, un bar possède une collection de photographies et d’articles constituant une sorte d’anthologie artistique de la ville de Paterson. Du Land Art (Robert Smithson) au Hip Hop (Fetty Wap), en passant par la poésie, cette ville a été le berceau de nombreux talents, alors qu’elle semble aujourd’hui tombée en désuétude.
C’est, par la manière dont la ville de Paterson est personnalisée dans un poème de William Carlos Williams, que Jim Jarmusch a eu l’idée d’inventer un personnage du même nom. Interprété par Adam Driver, Paterson est un chauffeur de bus qui vit dans la routine. Ses journées se ressemblent, comme la promenade quotidienne du chien et l’arrêt dans le bar du quartier. Deux éléments rompent cette routine : d’abord sa femme Laura, artiste débordante d’énergie, mais surtout la poésie. Paterson écrit à longueur de journée sur son carnet secret. Il crée une poésie simple et drôle, concentrée sur les détails du quotidien et l’amour de sa compagne. Plus que le long et tourmenté Paterson de W.C.Williams, ses textes font allusion à ses œuvres plus courtes, comme son poème This is Just to Say, évoqué dans le film. Pour incarner la prose de son personnage, le cinéaste s’est entouré de Ron Padgett. Influencé par l’École de New York, le poète a créé les textes, attribués à Paterson dans le film.
Il faudrait toujours se trouver dans un état de demi-conscience pour pénétrer le cinéma de Jim Jarmusch. Cela semble encore plus vrai avec Paterson. Ne serait-ce que parce que ce nouveau voyage au bout des sens, proposé par le cinéaste, comporte peut-être plus de répétitions et de pérégrinations contemplatives qu’à l’accoutumée. Cette virée poétique pourrait devenir éprouvante rapidement sans sa douceur et son atmosphère flottante qui donne l’impression de basculer dans un autre monde duveteux. Schématiquement, Paterson consiste en la description d’une semaine de la vie de Paterson, protagoniste rêveur et attachant joué par Adam Driver. Chaque jour, celui-ci se rend à pied au travail en traversant une ancienne usine, profite du temps qu’il lui reste avant l’arrivée de son patron pour écrire un poème dans son carnet secret, écoute les conversations des badauds installés dans son bus, discute avec sa compagne et termine chaque promenade avec son chien par une bière au café du coin. Cet emploi du temps millimétré, toujours vécu avec flegme et nonchalance par Paterson, a quelque chose d’hypnotique.
Pour matérialiser le temps qui défile depuis l’habitacle du bus, Jarmusch multiplie les plans par surimpression, sur la musique de Sqürl, son propre groupe musical. Mais ces effets ne produisent pas une impression de remplissage. Car Jarmusch nous parle de notre propre quotidien et de la manière dont nous cherchons à échapper à l’ennui qu’il procure. Cet échappatoire, c’est la poétisation de l’ordinaire : une boîte d’allumettes, des gouttes de pluie, l’amour. Sous sa caméra, cette banalité du quotidien devient presque séduisante, en dépit d’un cynisme très proche de celui de Daniel Clowes - l’atmosphère de ses BD est très présente dans Paterson - : on ne sait par exemple qui, de Paterson ou de Marvin le bouledogue, promène l’autre. De même, Laura, jouée par Golshifteh Farahani, la compagne inventive de Paterson qui est obsédée par le noir & blanc, apparaît tantôt rasante tantôt attendrissante. C’est bien cette ambivalence et cette dualité qui donnent à Paterson toute sa profondeur.
Il y a d’ailleurs une dimension plus métaphysique qui se cache dans cet espace lyrique. Ce Paterson qui vit et travaille comme chauffeur de bus à Paterson et écrit des poèmes, n’est au fond que la personnification de la ville éponyme. La passion de Jarmusch pour la versification n’est pas nouvelle. Or, quoi de plus poétique pour ce dernier que de faire le portrait de cette ville du New Jersey en la transposant dans un personnage, comme si ‘’Je’’ était une ville ? Paterson, chauffeur de bus, poète un peu ringard, incarne l’identité même de la ville : il porte en lui son aspect fané, mais qui palpite encore, l’ombre d’une âme de poète. Conducteur de bus, il s’intéresse à Dante Alighieri, est passionné par les poèmes d’Emily Dickinson ou ceux de William Carlos Williams. La question de la dualité se retrouve dans tout le film : nombre de personnages se voient ainsi accompagnés de leur jumeau. Cette gémellité symbolique pourrait bien renvoyer à l’angoisse de Paterson qui se cherche dans une vie sans âme. C’est la ville qui en est l’âme ; âme qu’il retrouve grâce à la poésie, animant cette cité depuis des décennies. Le fait de perdre son carnet secret, déchiré en morceaux par son chien Marvin pendant qu’il sortait au cinéma avec Laura, n’est finalement que l’occasion d’une renaissance. Cette renaissance sera évoquée à demi-mot par l’homme qu’il va croiser dans le parc à la fin du film.
Mais qu’importe en définitive que les velléités de Jim Jarmusch soient à ce point littéraires ou pas : il réussit en tous cas une fois de plus à susciter une expérience nouvelle chez le spectateur. Spectaculaire, la mise en scène méritait une récompense au palmarès du Festival de Cannes 2016. Au moins Marvin le bouledogue anglais, hilarant, décrocha-t-il sans surprise la Palme Dog.
Février 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
![]()
Le film reflète les problèmes de drogue et de corruption aux Philippines.
MA’ ROSA
Film philippin de Brillante MENDOZA – 2016
 Ma'Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît et l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face à des policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour racheter la liberté de leurs parents… Lors de la cérémonie de clôture du dernier festival de Cannes, Jaclyn Rose a créé la surprise en remportant le Prix d’interprétation féminine pour son incarnation de Ma’Rosa. Elle est ainsi devenue la première actrice d’Asie du Sud-Est à recevoir cette prestigieuse récompense. Brillante Mendoza avait déjà collaboré avec la comédienne dans les années 1980, lorsqu’il travaillait dans la publicité. Son choix s’est naturellement dirigé vers elle pour porter cette histoire difficile qui reflète les problèmes de drogue et de corruption aux Philippines. Mi-novembre 2016, Brillante Mendoza créait la surprise en se déclarant supporter des politiques anti-dealers de Rodrigo Duterte, le président controversé des Philippines, jusqu’à mettre en images ses derniers discours. Une affiliation peut-être née des travaux de recherches établies par le réalisateur pour Ma’Rosa.
Ma'Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît et l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face à des policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour racheter la liberté de leurs parents… Lors de la cérémonie de clôture du dernier festival de Cannes, Jaclyn Rose a créé la surprise en remportant le Prix d’interprétation féminine pour son incarnation de Ma’Rosa. Elle est ainsi devenue la première actrice d’Asie du Sud-Est à recevoir cette prestigieuse récompense. Brillante Mendoza avait déjà collaboré avec la comédienne dans les années 1980, lorsqu’il travaillait dans la publicité. Son choix s’est naturellement dirigé vers elle pour porter cette histoire difficile qui reflète les problèmes de drogue et de corruption aux Philippines. Mi-novembre 2016, Brillante Mendoza créait la surprise en se déclarant supporter des politiques anti-dealers de Rodrigo Duterte, le président controversé des Philippines, jusqu’à mettre en images ses derniers discours. Une affiliation peut-être née des travaux de recherches établies par le réalisateur pour Ma’Rosa.
Ce film est né de sa rencontre avec une famille, coincée entre le trafic de drogues qu’elle pratiquait pour survivre à leur extrême pauvreté, et une police particulièrement corrompue. Mendoza s’est alors rendu compte de l’aspect pandémique de ces deux aspects, touchant aujourd’hui bien au-delà des quartiers de Manille qu’il filme. Il a alors voulu, plus encore que dans ses films précédents, être particulièrement réaliste avec Ma’Rosa , s’inspirant autant de cette famille que de la police sur laquelle il a aussi enquêtée. Le commissariat, dans lequel se déroule une grande partie de l’action, est d’ailleurs un véritable décor naturel. Peu à peu, Ma’Rosa s’écarte de tout ce qui pourrait être fictionnel pour glisser vers un documentaire terrifiant sur une galopante corruption morale des Philippines. Si le président Duterte se présente un jour à un second mandat, il reprendra peut-être Ma’Rosa comme démonstration du bilan de sa présidence.
Ma’Rosa est une femme ordinaire. Elle tient une épicerie à Manille et boucle ses fins de mois en vendant de la drogue dans sa petite boutique. Quand son mari et elle sont arrêtés commence un long cauchemar sur fond de corruption policière. Ma’Rosa, c’est avant tout Jaclyn Jose, qu’on a déjà vue dans plusieurs films de Mendoza dontSerbis (2008) ; elle incarne ici une mère gardée à vue qui se bat pour essayer de se dépêtrer d’une situation kafkaïenne. Brillante Mendoza parvient à faire ressentir de l’empathie pour cette femme pas vraiment recommandable, inspirée d’une véritable criminelle.
Le sordide suinte de chaque situation filmée dans un commissariat crasseux ce qui rend, paradoxalement, le film un peu lassant à la longue. Car on s’en doute : Ma’Rosa, avec ses vieux t-shirts et son visage las, n’est pas la plus pourrie dans cette galerie de portraits où dealers violents, délateurs de quartier et flics ripoux tiennent le haut du pavé. La performance pleine d’humanité de Jaclyn Jose donne heureusement du relief à ce personnage contraint d’évoluer en eaux troubles pour subsister. ‘’La situation misérable de cette femme est celle de 80 % de la population philippine. Je raconte le pays tout entier à travers elle’’, insiste Mendoza. C’est ce qui rend Ma’Rosa unique.
Voici ce que Brillante Mendoza a déclaré au journal du CNC (Centre National du Cinéma) venu l’interroger : Pourquoi est-ce pour vous une nécessité de raconter votre pays ?
‘’Un artiste est un instrument, le reflet de ce qui se passe autour de lui et qu’il interprète. Que l’on soit peintre, musicien, écrivain, on trouve son inspiration dans son environnement proche. Il ne s’agissait pas de signer un plaidoyer, mais faire ce film était pour moi une nécessité. Cette histoire devait être dite. Non pas à la façon d’un reportage, c’est la fonction des journalistes ; mais pour éduquer, éclairer, donner à comprendre sans chercher à faire plaisir : le cinéma dominant est truffé d’histoires flatteuses et fausses, qui ne reflètent pas le monde réel. Mon film ne transforme pas, de façon pornographique, la pauvreté en spectacle ; il montre des gens ordinaires qui racontent leur histoire.
Pourquoi l’action se déroule-t-elle en quelques heures ?
Parce que c’est conforme à la vérité de la situation. La question du temps est très importante. Aux Philippines, si vous arrêtez un trafiquant de drogue en semaine, il va directement en prison. Si vous l’arrêtez un vendredi soir, comme les tribunaux sont fermés le week-end, il reste en garde à vue jusqu’au lundi, au commissariat. La police a donc tout intérêt à faire des rafles en fin de semaine : cela lui laisse 48 h pour négocier et éventuellement remettre les trafiquants en liberté contre de l’argent. C’est exactement ce que raconte le film. Bien sûr, c’est la pauvreté qui déclenche la corruption : il faut se débrouiller, même au mépris de la loi et de la morale pour survivre. Ce genre de corruption n’est pas propre aux Philippines mais, ici, elle est voyante. Pourtant, il y a aussi de la corruption dans les pays plus développés, à un plus haut niveau que l’on ne connaît pas.
Le commissariat n’a-t-il pas été reconstitué en studio ?
Pas du tout. C’est un vrai commissariat de quartier. Et les policiers qui l’occupent d’habitude savaient ce que j’allais tourner. Ils m’ont dit qu’ils ne se sentaient pas du tout visés ! Les commissariats de Manille sont remplis d’enfants errants : des gamins qui ont été attrapés un jour pour un petit larcin ; comme ils n’ont pas de famille, ils restent au commissariat et font des petits boulots. C’est très courant.
Le film ne fait pas de psychologie : les personnages sont dans l’action, ils se battent, ils marchent, tombent, se relèvent…
Pour eux, c’est une situation habituelle ; ils prennent les choses comme elles viennent. Ils sont trop blasés pour se plaindre ou protester, du reste, ils n’ont pas d’autre choix. La chute de la fille de Ma’Rosa est symbolique : elle marche dans une ruelle étroite, il n’y a pas d’autre chemin. Quelqu’un jette de l’eau, non par méchanceté, mais parce que c’est son travail. La fille glisse et tombe, mais elle ne se plaint pas, elle n’engueule pas la vieille femme qui est responsable de sa chute. Elle se relève et reprend sa route.
La façon dont les enfants sont solidaires des dettes de leurs parents est aussi très marquante…
C’est ce qui s’est passé dans la réalité. C’est ce qui m’intéressait et me navrait aussi. Ces enfants sont encore très jeunes, ils ne seront peut-être pas tous de bons citoyens, mais ce sont de bons enfants. Leurs parents ne sont peut-être pas de bons citoyens, mais ce sont de bons parents. Les liens familiaux échappent parfois à la morale : vous pouvez être une mauvais personne d’un côté et une bonne de l’autre. C’est vrai que je me suis retenu de montrer les émotions de chacun des personnages. Jusqu’au plan final ou Ma’Rosa pleure. Elle ne regrette rien. Quand il s’agit de survivre, il n’y a pas de place pour le regret, ni pour penser à la morale ou aux fautes commises. Il faut aller de l’avant. Mais elle montre enfin son humanité, qui résume l’humanité entière. La douleur est pour elle, mais elle doit rester forte et faire ce qu’elle a à faire. Elle regarde une autre famille fermer boutique, une famille qui essaye de survivre et dont elle ne connaîtra jamais l’histoire. Une famille naïve et vulnérable…comme un reflet de ce qui est arrivé à la sienne’’.
La méthode de Brillante Mendoza est irrésistiblement efficace. Son cinéma semble filmé ‘’en direct’’, non dirigé, très proche du documentaire. Faits de plans-séquences tournés au plus près des personnages que l’on suit dans le moindre de leurs déplacement, son cinéma est formidable d’immersion et de proximité. Le film, déjà très frappant pour sa mise en scène – même si celle-ci n’est pas nouvelle -, elle n’en est pas moins l’une des plus saisissantes qui soient. Mais il est aussi frappant par le portrait terrible qu’il dresse de son pays : une société très pauvre où la corruption est généralisée (la découverte de l’étendue de la corruption est d’ailleurs l’un des plus gros chocs ménagés par le scénario du film, implacable), où tous les rapports sont gangrenés par l’argent (le grand sujet de Mendoza).
Janvier 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Une histoire sur la vie, l’individualisme et la solidarité.
BACCALAUREAT
Film roumain et franco-belge de Cristian Mungiu – 2016
 Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement hors de portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est remise en question quand il oublie alors tous les principes qu’il a inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions…
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement hors de portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est remise en question quand il oublie alors tous les principes qu’il a inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions…
Couronné du prix de la mise en scène lors du dernier Festival de Cannes, Baccalauréat est ‘’une histoire sur les compromis et les principes, sur les décisions et les choix, sur l’individualisme et la solidarité, mais aussi sur l’éducation, la famille et sur le vieillissement’’, comme l’explique le réalisateur. Cristian Mungiu ne cherche pas à imposer son point de vue mais invite les spectateurs à formuler leur propre opinion face à cette histoire réaliste et percutante.
Ce film aborde une période et une génération contemporaine : celle qui avait profité de la révolution de 1989 pour fuir la Roumanie, avant d’y revenir en espérant y trouver une démocratie. Mungiu élargit le champ en parlant, à travers cette situation particulière, de celle d’une Europe et plein marasme, pesant sur les choix de vie et les décisions de chacun. Il n’est jamais clairement dit où se déroule le film ; tout juste saura-t-on que l’action se situe dans une petite ville de Transylvanie. Donc, en dehors de Bucarest mais à un endroit suffisamment anonyme pour que chacun puisse y retrouver son quotidien familier.
Le motif récurrent de la nouvelle vague du cinéma roumain, dont Mungiu est l’une des figures, reste l’interrogation sur la capacité du pays à se libérer du système imposé par le communisme de Ceaucescu, dont le cinéaste filmait les dernières heures dans 4 mois, 3 semaines, 2 jours, récompensé par la palme d’Or au festival de Cannes en 2007.
‘’J’ai combiné plusieurs affaires de tricherie au bac, explique le réalisateur au journal 20 Minutes. Mais, si ces faits sont avérés, on n’en connaît pas toujours les tenants et les aboutissants. Il faut recourir à la fiction, imaginer le dilemme qui pousse des gens bien sous tous rapports, un jour, à tricher ou se compromettre’’. Le prix de la mise en scène, attribué à Baccalauréat, souligne les qualités formelles d’un redoutable conte moral mené avec un sens du suspense digne d’Alfred Hitchcock : ‘’Hitchcock ?, s’interroge le cinéaste. Oui comme lui, j’aime qu’il y ait de la tension dans un film. Mais je puise mon imagination directement dans la vie. Mes films sont toujours construits ainsi : un personnage principal dont on épouse le point de vue unique. S’il ne sait pas qui a jeté une pierre à sa fenêtre, c’est normal que le spectateur ne le sache pas non plus. S’il ne répond pas à son téléphone qui sonne, c’est la preuve du peu d’attention qu’il porte aux autres… Saisir le point de vue du père, avec les fautes qu’il commet, ce qu’il ne comprend pas, et comment la situation se retourne contre lui, c’est ça mon point de vue sur le cinéma. Formellement, ça veut dire que je tourne essentiellement en plans séquences : il faut pouvoir le suivre dans les moindres détails…’’ Baccalauréat traite de la paternité, via un drame d’une intensité rare dont l’enjeu dépasse la simple réussite à un examen. ‘’La question, c’est plutôt de savoir jusqu’où le fossé entre notre discours et nos actes nous est supportable, souligne Cristian Mungiu. Le père de famille est un médecin revenu de ses espoirs nés avec la chute du communisme en 1989. Lorsqu’il se retourne sur son passé, il ne voit rien de mirobolant. Il trompe sa femme de façon un peu minable et mise tout ce qui lui reste sur l’avenir de sa fille.’’
Un avenir qui passe par une mention au bac, condition indispensable pour continuer ses études à l’étranger. ‘’En tant que parent, on essaie d’être correct, et exemplaire vis-à-vis de ses enfants pour pouvoir leur tenir un discours moral, estime le cinéaste. Mais c’est parfois un double langage que l’on tient.’’ A la question morale s’ajoute une question politique : faut-il encourager ses enfants à rester étudier en Roumanie dans l’espoir de faire évoluer la société de l’intérieur ou les envoyer à l’étranger pour assurer leur avenir ?… ‘’Chez nous, on se pose tous cette question, raconte le cinéaste. A titre personnel, j’ai fait le choix de rester en Roumanie pour continuer à faire des films en langue roumaine. Avec de tout petits budgets et beaucoup de débrouillardise. Mais pour les diffuser, c’est une autre affaire. Il n’y a plus aujourd’hui qu’une dizaine de salles qui projettent du cinéma d’auteur. Tout cela n’est pas qu’une question d’argent, mais de stratégie politique. Souhaite-t-on éduquer le regard de nos enfants ? Veut-on les ouvrir au cinéma d’auteur ou les abandonner au cinéma commercial ?’’
Cristian Mungiu a inventé un système de cinéma itinérant, pour apporter ses films dans les villages. ‘’Je pensais que les autorités politiques tireraient des leçons du fait que la palme d’or attribuée à un cinéaste roumain doive être projetée dans de telles conditions dans son propre pays, mais rien ne s’est passé. Au contraire, cette façon artisanale de monter des projections est devenue la norme pour le cinéma d’auteur.’’ Depuis sa sortie, Baccalauréat a été vu par 55.000 spectateurs en Roumanie. Un bon score, les films d’auteur ne dépassant guère 10.000 entrées dans ce pays. ‘’Je suis heureux qu’il ait été vu, parce que ce n’est pas un film élitiste. C’est un film que j’ai fait en pensant aux parents.’’ A tous les parents, ceux de Roumanie et d’ailleurs.
‘’L’histoire tente de vous faire comprendre ce que le personnage ressent et à quoi il pense – mais seulement en l’observant à distance. Ce qui importe, c’est la vérité du moment. Le point de vue du réalisateur à propos des questions morales ou sociales que soulève l’histoire, l’interprétation de l’acteur, le style du film, rien de tout cela ne devrait vous distraire de tirer vos propres conclusions sur l’histoire, sur les personnages, sur les valeurs et les croyances qui sont mises en question. Si le film réussit à vous faire réfléchir à vos propres choix de vie, vos mensonges ou vos décisions passées, ce serait un merveilleux bonus. Nous faisons des films pour raconter des histoires, pour poser des questions, pour chercher un monde meilleur autour de nous. Mais il y a encore beaucoup d’histoires à raconter. En tant que réalisateur, vous devez vous demander pourquoi vous avez choisi cette histoire particulière ? Espérons que c’est parce qu’à un moment de votre vie, c’était ce qui vous semblait le plus important. Et vous étiez déterminé à la raconter aux autres, parce que vous pensiez que cela leur parlerait de choses qui ont vraiment de l’importance pour eux.
Baccalauréat est une radiographie du moment où vous réalisez que la majeure partie de votre vie est derrière vous. Vous avez pris les décisions importantes de votre vie, et voici où vous en êtes aujourd’hui. Souvent, la vie à cet âge ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé lorsque vous étiez jeune. Mais c’est comme ça, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez changer maintenant. Pourtant, vous sentez qu’il y a quelque chose que vous pouvez faire. Quelque chose qui donnerait du sens à toutes les épreuves que vous avez rencontrées : sauvez vos enfants, éduquez-les bien, aidez-les à faire de meilleurs choix que ceux que vous avez faits. Cependant, il n’est pas facile de décider ce qu’il est mieux de dire aux enfants.’’
Janvier 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Eva Peron, une idole pour certains, une gêneuse pour d'autres.
EVA NO DUERME
(EVA NE DORT PAS)
Film de Pablo Agüero – 2015
 Buenos Ayres 1952. Evita Perón vient de mourir à l’âge de 33 ans. Elle est une figure politique la plus aimée et la plus haïe d’Argentine. On charge un spécialiste de l’embaumer. Des années d’effort, une parfaite réussite ; mais les coups d’état se succèdent et certains politiciens veulent détruire jusqu’au souvenir d’Evita dans la mémoire populaire. Son corps devient l’enjeu de forces qui s’affrontent pendant 25 ans. Durant ce quart de siècle, Evita aura eu plus de pouvoir que n’importe quelle personnalité de son vivant… Eva ne dort pas revient sur la manière dont le corps d’Eva Perón, grande figure politique de l’Argentine, a disparu. Pour Pablo Agüero, ‘’le mythe d’Evita naît au moment de sa mort, tout comme celui du Christ qui achève de se former au moment de sa crucifixion’’. La femme de Juan Perón a déjà été incarnée au cinéma par Madona dans le célèbre film d’Alan Parker, Evita (1996).
Buenos Ayres 1952. Evita Perón vient de mourir à l’âge de 33 ans. Elle est une figure politique la plus aimée et la plus haïe d’Argentine. On charge un spécialiste de l’embaumer. Des années d’effort, une parfaite réussite ; mais les coups d’état se succèdent et certains politiciens veulent détruire jusqu’au souvenir d’Evita dans la mémoire populaire. Son corps devient l’enjeu de forces qui s’affrontent pendant 25 ans. Durant ce quart de siècle, Evita aura eu plus de pouvoir que n’importe quelle personnalité de son vivant… Eva ne dort pas revient sur la manière dont le corps d’Eva Perón, grande figure politique de l’Argentine, a disparu. Pour Pablo Agüero, ‘’le mythe d’Evita naît au moment de sa mort, tout comme celui du Christ qui achève de se former au moment de sa crucifixion’’. La femme de Juan Perón a déjà été incarnée au cinéma par Madona dans le célèbre film d’Alan Parker, Evita (1996).
Si une figure politique forte et engagée a bien marqué l'Argentine, c'est celle d'Eva Perón. Première Dame du pays en 1946, celle qui était mieux connue sous le nom d'Evita s'est battue pour les droits des femmes et des travailleurs durant des années. Une idole pour certains, une gêneuse pour d'autres. Une gêneuse pour le dictateur qui enterre le corps d'Evita sous six mètres de béton pour s'en débarrasser pour de bon après des années troubles. Parce que oui, Evita est bien morte, en 1952 à 33 ans, emportée par un cancer foudroyant.
C'est d'ailleurs à sa mort que le film commence. Il faut dire que l'histoire qui entoure le corps d'Evita est assez folle. Après avoir été embaumé, son corps est envoyé au Vatican pour être enterré en secret, loin du peuple argentin. Il y restera pendant 17 ans avant de revenir au pays. Une histoire faite pour le cinéma. Pablo Agüero s'en empare en s'appropriant la réalité historique comme cela lui convient. Il évite ainsi le cours d'histoire et concentre son film sur quatre segments, centrés sur quatre personnages plus affreux les uns que les autres. Le portrait d'Evita se fera donc à travers ces personnages. Plus un dictateur l'insulte (Gael Garcia Bernal est saisissant), plus on sent le combat farouche de cette femme pour le peuple. Laisser parler les salauds, c'est aussi éviter de tomber dans le portrait flatteur sans intérêt pour offrir une vision plus complexe.
En cinéaste intelligent, Agüero construit son film à partir de peu de choses : des images d'archives, de la musique rock et de larges séquences impeccables, tournées en plans-séquences fixes. Le manque de moyens force une fois de plus à l'inventivité et toute la construction du récit est audacieuse, avec une mise en scène et une photographie extrêmement travaillées. Eva ne dort pas a cependant ses limites. Les séquences forcent l'admiration mais laissent indifférents. Après un début très réussi, le film devient peu à peu hermétique et les personnages, pourtant intéressants, peinent à vraiment passionner. Ne s'encombrant guère de psychologie, l'ensemble du film se déroule avec une audace visuelle et narrative que l'on n'avait pas vue depuis longtemps et qui se retrouve ici bien exploitée, servant merveilleusement la figure d'Eva Perón.
Le film de Pablo Agüero, découpé en trois parties, mêle habilement des images d’archives, à la pure fiction. Chaque séquence révèle les étapes du long cheminement de la dépouille d'Eva Perón, une femme qui, de son vivant, fut adorée, voire idolâtrée par des millions d’Argentins. Haïe, pareillement par une oligarchie rétrograde et menacée. Après sa mort, en Argentine, les différents régimes qui prennent le pouvoir n'ont eu de cesse de vouloir effacer toutes traces du péronisme. Celles d'Evita en particulier. "Son poids historique repose plus sur l’introduction du concept de justice sociale que sur son programme politique. Evita m’intéresse en tant que parabole de cette revendication populaire que personne ne pourra faire taire. C’est une femme qui, même morte et disparue, continue de vivre dans les idéaux de milliers de personnes qui l’ont adoptée comme une mère de l’insurrection. C’est le cauchemar vivant des militaires et des néolibéraux.", note Pablo Agüero, récompensé en 2012 par le Grand Prix du meilleur scénariste.
Ce scénario intelligent, solide et parfaitement écrit, démontre avec justesse que rien, ni personne, n'a le pouvoir d'effacer un mythe. Les images sont sombres, souvent sinistres. La violence des dialogues donne une force supplémentaire à cette réalisation ténébreuse, singulière et parfaitement maîtrisée. En conclusion d’une interview, Pablo Agüero a déclaré : "Ce n’est pas un film pour ou contre le péronisme, mais un film contre les dictatures, contre le capitalisme sauvage et pour la liberté et l’égalité de droits." Et de rajouter "Ce nouveau film accroît encore plus mon intérêt pour la passion féminine et approfondit ma conviction qu’après des siècles de soumission, nous sommes entrés dans l’ère de la femme."
Le style docu-fiction n'est pas un genre facile. Mais, ce film un rien étrange nous retient avec l'exemple, unique dans l'histoire, où la mémoire du corps mort d'Eva Peron a joué grand rôle pendant 20 ans, plus grand que si elle avait été tout simplement enterrée. Intéressant pour se souvenir ou apprendre l'origine et les revendications du mouvement péroniste, d'après Péron, et découvrir le mécanisme fascinant du culte de la mémoire.
Janvier 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Ce film fait découvrir Téhéran en pleine mutation
LE CLIENT
Film franco-iranien de Asghar Farhadi – 2016
 Ranaa et Emad, un couple de la bourgeoisie de Téhéran, partagent leur temps entre leur métier et leur passion pour le théâtre, où ils sont en train de répéter Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller. Une nuit, alors que l’immeuble dans lequel ils vivent s’effondre, ils sont obligés de quitter précipitamment le bâtiment. En attendant d’être relogés, ils sont hébergés dans l’appartement d’un de leurs amis de la troupe de théâtre. Mais un soir, alors qu’elle est seule, Ranaa est agressée par un homme qui prend rapidement la fuite. Emad, traumatisé par l’évènement, décide de retrouver l’inconnu…
Ranaa et Emad, un couple de la bourgeoisie de Téhéran, partagent leur temps entre leur métier et leur passion pour le théâtre, où ils sont en train de répéter Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller. Une nuit, alors que l’immeuble dans lequel ils vivent s’effondre, ils sont obligés de quitter précipitamment le bâtiment. En attendant d’être relogés, ils sont hébergés dans l’appartement d’un de leurs amis de la troupe de théâtre. Mais un soir, alors qu’elle est seule, Ranaa est agressée par un homme qui prend rapidement la fuite. Emad, traumatisé par l’évènement, décide de retrouver l’inconnu…
Après le succès important d’Une séparation en 2011 – Ours d’or à Berlin, césarisé à Paris et oscarisé à Hollywood -, le cinéaste iranien Asghar Farhadi propose Le Client, un nouveau drame social épuré tourné en Iran et qui a reçu deux prix au dernier Festival de Cannes. Ce ‘’Client’’ est caractérisé par son style minimaliste et une mise en scène qui place le spectateur au plus près de ce récit haletant.
Le titre original du film fait écho à celui de la pièce d’Arthur Miller Mort d’un commis voyageur que Ranaa (Taraneh Alidoosti) et Emad (Shahab Hosseini) interprètent avec leurs amis.
Asghar Farhadi s’explique sur le choix de cette œuvre :
‘’J’ai été très marqué par cette pièce, sans doute en raison de ce qu’elle dit des relations humaines. Sa dimension la plus importante est celle d’une critique sociale d’un épisode de l’histoire américaine où la transformation soudaine de la ville a causé la ruine d’une certaine classe sociale. A ce titre, la pièce a une très forte résonance avec la situation actuelle de mon pays. Les choses évoluent très vite et ceux qui ne peuvent pas s’adapter à cette course effrénée sont sacrifiés. Une autre dimension de la pièce est celle de la complexité des relations humaines au sein de la famille, notamment dans le couple que forme le commis voyageur avec Linda. Lorsque j’ai décidé que les personnages principaux du film feraient partie d’une troupe de théâtre et seraient en train de jouer une pièce, l’œuvre de Miller m’a paru très intéressante, dans la mesure où elle me permettait d’établir un parallèle avec la vie personnelle du couple autour duquel se construit mon film. Sur scène Ranaa et Emad jouent les rôles du vendeur et de son épouse. Et dans leur propre vie, sans s’en rendre compte, ils vont être confrontés à un vendeur et à sa famille et devront décider du sort de cet homme’’.
Deux journalistes, Michel Ciment et Emmanuel Raspiengeas, de l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai (AFCAE), ont réalisé un entretien avec le cinéaste :
Quelle est l’origine de ce nouveau film ? J’avais une image en tête : celle d’un théâtre vide, plongé dans l’obscurité. Le décor s’éclairait par petites touches, dévoilant progressivement la scène. Quand la lumière totale était faite, on découvrait le décor dans sa totalité. C’est à l’image de ma façon de travailler dans mes films, où l’on voit d’abord les choses de manière parcellaire, avant que la lumière ne se fasse avec un léger recul. Donc, pour commencer, je n’avais pas vraiment de scénario. Il a fallu construire toute une histoire autour de cette image.
Votre film développe le concept de ‘’violence valable’’, auquel le mari s’accroche pour justifier sa vengeance, très égoïste et pas du tout motivé par le mieux-être de sa femme. En quoi cela exprime t-il votre inquiétude sur l’Iran d’aujourd’hui ?
Il y a une grande différence entre une colère impulsive et une violence préméditée que l’on programme dans un calme absolu, à l’aide d’une conviction qui nous semble pouvoir la justifier. Cette violence préméditée me semble envahir aujourd’hui le monde, et c’est extrêmement grave. C’est quelque chose de fondamental, mais qui ne m’est apparu qu’après, une fois le scénario écrit. Dans un premier temps, Emad est un homme modéré, calme, qui tente de dépasser ce traumatisme. Mais ce sont les autres, voisins ou amis, qui l’empêchent de tourner la page. La société l’entraîne dans cette soif de revanche.
Comment s’est fait le choix des deux comédiens, avec qui vous avez déjà tourné plusieurs films, trois avec Taraneh Alidoosti et deux avec Shahab Hosseini ?
Au début, mon intention était de travailler avec des acteurs non-professionnels. Mais, très vite, je me suis rendu compte que le rôle était trop complexe, qu’il y avait trop de finesses et trop d’enjeux pour que quelqu’un qui n’a jamais été face à une caméra puisse fournir un jeu satisfaisant. J’a i don choisi Taraneh et Shahab, puisque je connaissais leur intelligence, que je les savais capables de comprendre très vite ces nuances, et d’offrir des propositions intéressantes pour ma caméra. Notamment Shahab, le mari, a quelque chose de très particulier, un grand calme, mais toujours avec un fort potentiel d’imprévisibilité. Lui et Taraneh ont deux tempéraments très opposés. Elle est extrêmement intelligente, elle a une vision très analytique et précise des choses, tandis que Shahab, lui, est un impulsif, qui va à l’intuition, ce qui est d’ailleurs le propre de leurs personnages. Je leur ai demandé pendant le tournage de ne pas perdre de vue qu’ils étaient des comédiens de théâtre. J’ai vraiment tenu à ce qu’il y ait une sorte de continuité, de fusion, entre le métier de leurs personnages et ce qu’ils vivent en dehors du théâtre, que ce ne soit pas hermétique.
Ce fait divers banal fait basculer deux familles dans une forme réaliste de cauchemar quand les deux victimes doivent décider du sort d’un homme plus âgé. ‘’Ce couple se trouve placé dans une situation qui révèle des dimensions inattendues de leurs personnalités’’, commente le cinéaste. Dans le film, les héros sont deux acteurs qui jouent la pièce d’Arthur Miller au théâtre et se trouvent soudain confrontés à un cas de conscience. « La critique sociale au cœur de la pièce américaine reste valable en Iran aujourd’hui », insiste le Asghar Fahradi. Entre drame théâtral et drame réel, atermoiements, doutes et contradictions de l’un ou l’autre, nous voilà, nous aussi, transformés en limiers, dans la situation de soutenir l’un, puis l’autre, de compatir ou pas. Nous aussi, nous cherchons la vérité, nous nous interrogeons, incapables de trancher. C’est d’autant plus prenant que les personnages sont ambivalents, les situations ambiguës, que le film se construit sur l’ellipse, le contournement, le non-dit, que tout se passe dans les silences, les regards, sans compter le jeu avec la censure du ministère de la Culture et de l’Orientation islamique qui se confond avec le récit. La scène finale à couper le souffle est un choc. On se prend un coup dans l’estomac. On se demande où est l’humanité, en qui elle s’incarne, ce qui va advenir de pareille histoire d’amour. Une intimité a été violée. Une violence commise. Une humiliation posée. Est-il possible de les réparer sans entraîner d’autres violences, d’autres humiliations ? Est-il possible de pardonner sans être dans le déni, de ne pas faire se répéter la fin tragique du commis voyageur américain d’Arthur Miller ?
Si quelques lenteurs, notamment dans la description du milieu théâtral, rendent le film moins puissant que les œuvres précédentes du cinéaste, le spectateur se laisse tout de même emporter par l’histoire. Fahradi est un merveilleux directeur d’acteurs qui met en valeur la sensibilité de Taraneh Alidoosti contre la force butée de son partenaire (même si c’est lui qui a été primé à Cannes).
Les premières scènes du film, haletantes, dans un immeuble sur le point de s’écrouler communiquent une urgence immédiate à l’ensemble. C’est aussi la ville de Téhéran en pleine mutation qu’on découvre dans ce conte cruel, choc entre la tradition et la modernité.
Janvier 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
A la rencontre de pionniers qui sauvent le monde
DEMAIN
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent – 2015
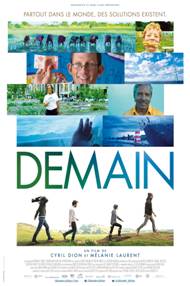 Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, qui traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis, avec une équipe de quatre personnes, enquêter dans dix pays différents pour comprendre ce que pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, qui traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis, avec une équipe de quatre personnes, enquêter dans dix pays différents pour comprendre ce que pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
Ceux qui attendaient de ce documentaire un débordement de mièvreries en seront pour leur frais : "Demain", sorti le 2 décembre 2015 sur les écrans, est d’abord un manifeste politique. Il a été présenté en avant-première dans le cadre de la COP 21 pour dénoncer la dégradation environnementale de la planète. Tout part d’une étude scientifique annonçant le possible effondrement d’une partie de l’humanité d’ici 2100. Suite à ce constat catastrophique, Mélanie Laurent et Cyril Dion, accompagnés d’une équipe de quatre personnes, partent à travers le monde, en quête de solutions pour éviter ce cataclysme. Ils ont exploré neuf pays différents et rencontré plusieurs personnages qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. Mises bout à bout, ces initiatives positives et concrètes forment un système qui fonctionne déjà et qui pourrait bien être l’ébauche du monde de demain… Un documentaire saisissant et plein d’espoir qui pourrait faire évoluer les consciences !
INTERVIEW
L’actrice-réalisatrice et Cyril Dion, cofondateur du mouvement Colibris avec Pierre Rabhi, réalisent "Demain", un documentaire sur les alternatives existantes pour construire un avenir meilleur. Rencontre avec un binôme engagé (par Maryline Letertre du journal ‘’Métro’’) :
Mélanie, comment Cyril vous a-t-il convaincue de coréaliser ce film avec lui
Mélanie Laurent. J’avais rencontré Cyril par l'intermédiaire de Pierre Rabhi et il m’avait proposé de me montrer des initiatives qui "changent le monde". Il m’a alors emmenée à la ferme de permaculture qui est dans le film. Nous avons fait le trajet ensemble et nous nous sommes découverts les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes colères... Au retour, il m’a parlé de son scénario : je venais d’être maman et j’avais particulièrement envie et besoin de faire partie de ce genre d’aventure positive et constructive. J’ai refusé des films pour me consacrer 100% à Demain.
Mais pourquoi un tel projet précisément ?
M.L. On me demande souvent de faire une photo pour servir une cause et basta. Mais là, on m'offrait de faire mon métier de réalisatrice. Cela avait du sens. Comme j’ai le bon réseau et que je connais ce métier, je pouvais porter ce projet et ne pas simplement donner mon image.
Cyril Dion. Sans elle, je n’aurais jamais pu faire ce documentaire. Elle a non seulement l’aura nécessaire, mais elle a aussi un talent incroyable. J’avais adoré Les Adoptés et j’avais envie de cette poésie, cette sensibilité et cette réflexion cinématographique pour Demain.
Demain se concentre sur les solutions possibles pour construire un monde plus solidaire, plus humain. Pourquoi ce parti-pris ?
M. L. On a vu ces quinze dernières années une vague de films passionnants, nécessaires mais catastrophistes. Aucun documentaire pour le cinéma n’avait encore posé la question du "Que faire pour s’en sortir ?". Il était temps…
C. D. Avec le mouvement Colibris, j’ai beaucoup parlé des catastrophes écologiques mais, alarmer sape l'énergie aux gens. Trouver une idée pour donner envie de construire différemment notre avenir est alors devenu une obsession.
Et la sortie à l’heure de la COP 21 ?
C.D. C’était une demande de Philippe Martin lorsqu’il était ministre de l’écologie. Il voulait soutenir une initiative positive : cela nous a paru cohérent d’accepter pour mettre en lumière la vision de l’avenir que nous défendons dans le film.
Le film est résolument optimiste. L'êtes-vous dans la vie ?
M.L. Je vis au jour le jour mais avec de l’espoir. C’est nécessaire pour ne pas tomber dans la colère ou la dépression.
C.D. Je reprendrais la phrase de Hubert Reeves : "Je suis déterminé." Il faut y aller, ne plus se poser de questions : tout le monde peut changer les choses. C’est ça le message du film.
Tranchant avec tous les films alarmistes abordant ces mêmes thématiques, leur ‘’road movie’’ adopte une approche optimiste et pédagogique, n’oubliant jamais au passage qu’un film est aussi une affaire d'émotion, de voyage, d’image et de rythme. Que demander de plus ? Le Britannique Rob Hopkins, fondateur du mouvement des ‘’villes en transition’’, donne le ton de ce documentaire : « Notre espèce est très douée pour imaginer sa propre extinction. Nous avons plein de films sur la fin du monde. Mais où sont les films racontant comment celle-ci peut être empêchée? »
Face aux risques majeurs que court aujourd’hui la planète, Cyril Dion et Mélanie Laurent veulent montrer que des solutions existent déjà en matière d’agriculture, d’énergie, d’économie, d’éducation et de démocratie. Si ce qu’ils montrent ne convainc pas toujours, leur démarche, constructive, suscite réflexion et espoir.
Ce documentaire n'a rien du projet opportuniste surfant sur la cause. D'abord, parce que leur engagement sur la question écologique ne date pas d'hier. Et surtout parce qu'en lieu et place de l'habituel constat anxiogène sur l'état dégradé de notre planète, le duo se concentre sur les solutions à travers des cas concrets. Ils partent à la recherche de solutions qui existent réellement. Dans un documentaire militant, ils proposent des points de vue parfois candides, mais aussi des expériences et des réussites qui ne demandent qu'à être multipliées. Ce film a le mérite de rassembler des initiatives qui semblent souvent désespérément isolées. La mise en scène de leur interdépendance dessine un monde en mouvement, tisse des fils entre des milliers de bonnes volontés, d’esprits ingénieux et de mains habiles.
Comment ne pas entendre, dans cet hymne à la création et à l’inventivité des hommes, un écho de la ‘’prière pour notre terre’’ que le Pape François propose dans son encyclique sur la sauvegarde de la maison commune ? : ‘’Seigneur, apprend-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie’’.
Janvier 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Film lumineux où l’émotion donne naissance à une autre vision du quotidien.
LE VOYAGE AU GROENLAND
Film français de Sébastien BETBEDER – 2016
 Thomas et Thomas sont les meilleurs amis du monde. Trentenaires, parisiens et comédiens, ils cumulent les difficultés. L’un d’eux décide d’emmener son ami au Groenland, dans le village de Kullorsuaq où vit son père Nathan, depuis des années. Une fois sur place, les deux amis en profitent pour faire connaissance avec la population, dont les coutumes les déconcertent. Au sein de la petite communauté Inuit, ils découvrent les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié… Présenté en mai dernier à l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) au Festival de Cannes, Le voyage au Groenland est un projet hybride que Sébastien Betbeder prépare depuis 2013. C’est le frère de son producteur qui lui propose de filmer ses deux amis Inuits pendant leur séjour en France. En échange, les protagonistes du film invitent le réalisateur chez eux, au Groenland. C’est ainsi que l’équipe de tournage débarque, en avril 2015 à Kullorsuaq où les températures avoisinent les -35°.
Thomas et Thomas sont les meilleurs amis du monde. Trentenaires, parisiens et comédiens, ils cumulent les difficultés. L’un d’eux décide d’emmener son ami au Groenland, dans le village de Kullorsuaq où vit son père Nathan, depuis des années. Une fois sur place, les deux amis en profitent pour faire connaissance avec la population, dont les coutumes les déconcertent. Au sein de la petite communauté Inuit, ils découvrent les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié… Présenté en mai dernier à l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) au Festival de Cannes, Le voyage au Groenland est un projet hybride que Sébastien Betbeder prépare depuis 2013. C’est le frère de son producteur qui lui propose de filmer ses deux amis Inuits pendant leur séjour en France. En échange, les protagonistes du film invitent le réalisateur chez eux, au Groenland. C’est ainsi que l’équipe de tournage débarque, en avril 2015 à Kullorsuaq où les températures avoisinent les -35°.
Caty Couteau, cinéaste et membre de l’ACID, livre ses impressions sur le film :
‘’Le voyage au Groenland est un film lumineux où l’émotion est d’autant plus forte qu’elle sourd d’un subtil décentrement du quotidien. Variation betbederienne autour de ses figures de paumés perchés, l’épopée drolatique de Thomas et Thomas, jeunes gens lunaires parachutés sur une terre lunaire, se déroule sous le patronage conjoint du philosophe Jankélévitch et du dessinateur de BD, Hergé. Sous les auspices malicieux du premier, un je-ne-sais-quoi flotte comme un charme dans ce village inuit, sorte d’idéal écolo : pas d’électricité, on charrie l’eau selon ses besoins, les toilettes sont sèches, les équipements techniques sont modestes, collectifs et souvent en panne, on y pratique le footing comme aux Buttes-Chaumont.
La luminosité particulière de ce territoire gelé éclaire le tragique familier de leur précarité et de leur maturité indécise, de façon plus aigüe qu’observées dans leur écosystème habituel. Un je-ne-sais-quoi d’infime, ici, décale la banalité des petits riens par lesquels on surprend les vibrations qui traversent les deux Thomas. Quand ni la langue de l’autre, ni ses codes ne sont intelligibles, quand la proximité amicale cache la connaissance de l’autre, l’altérité devient miroir et l’expérience de l’amitié se déploie, tandis que la relation au père se tisse dans la distance pudique.
Les séquences sont structurées et cadrées comme des planches de BD. La chasse au phoque est, à ce titre, exemplaire : l’absence d’ombre sur la banquise renvoie à la quasi-absence d’ombre dans les dessins d’Hergé, l’expressivité graphique des silhouettes des deux Thomas, le temps suspendu du final (viser-tuer) qu’on voudrait prolonger en revenant à son début, comme dans la relecture d’une page de BD pour en prolonger la fin … la jubilation d’un récit en soi.
Le voyage au Groenland excelle à déployer la palette des rêveries douces-amères des deux héros ? Merveilleux comédiens, très contemporains dans l’incertitude de leur statut social et affectif. Thomas Blanchard et Thomas Sciméca résistent au tragique familier avec une mélancolie souriante et une légèreté élégante. Ils distillent une émotion de haute intensité et s’en reviendront de cette contrée au froid revigorant avec une maturité nouvelle’’.
De son côté, Sebastien Betbeder le cinéaste, parle de ses deux acteurs :
‘’Les Thomas, un vrai duo. Ce sont des amis proches, ils ont chacun leurs faiblesses, mais ensemble, c’est comme s’ils devenaient un seul corps. Thomas B., ou plutôt son personnage, est sans doute plus sensible, moins frondeur. Il est plus dans l’hésitation et la retenue, là où Thomas S., ou du moins son personnage, provoque les évènements avec une forme d’inconscience. Une séquence comme celle qui se passe dans leur chambre les met en scène dans un ping-pong verbal qui échappe au registre de la pure comédie. J’avais pour idée, en faisant ce film, d’inverser la situation, que l’objet d’étude soit aussi ‘’les Thomas’’, en vis-à-vis de ce que vivent les habitants de Kullorsuaq. Un vis-à-vis qui révèle des choses sur l’absurdité de la vie occidentale. Même si leurs discussions peuvent paraître dérisoires face à ce que vivent les Inuits, elles sont pour moi essentielles : le débat sur l’esprit critique, le choix de métiers artistiques, la place de la culture dans nos existences (un thème déjà abordé dans 2 automnes 3 hivers, mais encore plus crucial ici), c’est aussi une question de survie.
Ce voyage aura été initiatique et nous aura, l’équipe et moi-même, bousculé dans nos certitudes. Il y a chez les hommes et femmes que nous avons côtoyés durant ces 5 semaines, une conception simple et fondamentale des relations humaines, du vivre ensemble, qui place l’amitié très haut et qui met aussi les enfants au cœur des préoccupations sociales. Le film parle aussi de nos différences et, de façon détournée de la paternité : décider ou pas d’être père. Avec cette scène comme une blague, où un habitant propose de donner un enfant à l’un des Thomas, qui répond poliment : Non merci !’’
Délaissant les images de cartes postales et afin de ne pas privilégier une civilisation plutôt qu’une autre, le réalisateur adopte un ton plus grave en évoquant la misère et les conditions de rudesse de la vie des Inuits à l’avenir peu encourageant. A part devenir chasseur de phoques, peu d’opportunités s’offrent à la jeunesse au sein de laquelle les suicides sont nombreux.
Un film qui, entre fantaisie et délicatesse, entre lucidité et flegme, vous donnera néanmoins le sourire. Alors, n’hésitez pas à embarquer pour cette contrée où, la chaleur, humaine à défaut d’être climatique, est assurée.
Janvier 2017 Jean-Claude Faivre d’Arcier
