Visionnaire de l'invisible
Le Cinéma
LA SOCIALE
VIVE LA SECU !
Film français de Gilles PERRET – 2016
Histoire d’ une grande bataille pour la dignité’ pour la santé et pour la vie.
 Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples – vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain – voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soient se nommait Ambroise CROIZAT. Qui le connaît encore aujourd’hui ? Il était temps de raconter cette belle histoire de ‘’La Sécu’’ : d’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, quels en furent les bâtisseurs et ce qu’elle est devenue au fil des ans ? La Sociale retrace l’histoire d’une longue lutte vers la dignité tout en dressant, en parallèle, le portrait d’un homme et celui d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.
Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples – vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain – voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soient se nommait Ambroise CROIZAT. Qui le connaît encore aujourd’hui ? Il était temps de raconter cette belle histoire de ‘’La Sécu’’ : d’où elle vient, comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, quels en furent les bâtisseurs et ce qu’elle est devenue au fil des ans ? La Sociale retrace l’histoire d’une longue lutte vers la dignité tout en dressant, en parallèle, le portrait d’un homme et celui d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.
Gilles Perret a réalisé 12 documentaires. Ses films ont pour lien ce pays qui est le sien, les Alpes. En s’attardant chez ses voisins de vallée, il aborde la réalité du monde politique, économique et social. Partir du local pour raconter le global. C’est ce regard singulier qui a fait le succès de ses derniers films sortis en salle comme Ma mondialisation, Walter, retour en résistance, De mémoires d’ouvriers, ou en 2014, Les Jours Heureux (ce dernier film fera l’objet d’une autre critique, car il retrace le contexte politique de la Résistance qui a permis la naissance de ‘’La Sécu’’). L’histoire de la Sécurité Sociale a été peu ou pas racontée jusqu’à ce jour, alors qu’elle nous concerne tous. C’est l’histoire d’une lutte qui n’est jamais terminée…
Ambroise Croizat
Ambroise Croizat est né en 1901 dans une famille ouvrière métallurgiste de Savoie. Son père, manœuvre ferblantier, lancera la première grève pour la protection sociale en 1906. Elle réussira, mais il est licencié et doit s’exiler à Lyon. Quand son père part à la guerre, Ambroise se fait embaucher comme ajusteur, à 13 ans, et adhère à la CGT. A 17 ans, il commence à animer les grèves de la métallurgie lyonnaise et, en 1927, il devient secrétaire de la fédération des métaux CGTU. Il participe au front Populaire et, en 1936, il est élu député PCF de Paris 14°. Sur les bancs de l’Assemblée Nationale, il fait voter la 1e loi sur les conventions collectives, qu’il signe de son nom.
Mais le Front Populaire se déchire. Suite à l’accord germano-soviétique, il est arrêté et incarcéré le 7 octobre avec d’autres députés communistes. Fers aux pieds, il traverse 14 prisons françaises avant de connaître, durant 3 ans, les horreurs du bagne à Alger : les coups, la dysenterie, l’humiliation. Libéré en 1943, il est nommé par le CGT clandestine à la commission consultative du gouvernement provisoire d’Alger autour du Général De Gaulle, où il exerce la présidence de la commission du Travail. Il déclare : ‘’Il faut en finir avec la souffrance et l’exclusion. Dans une France libérée, nous libèrerons les Français de l’angoisse du lendemain’’.
C’est ce vaste travail, mûri par l’apport du Conseil National de la Résistance, qui va aboutir à l’ordonnance d’octobre 1945, instituant la Sécurité Sociale. En novembre, il est nommé ministre du travail et le reste jusqu’au 5 mai 1947. Deux années consacrées à bâtir un système de protection sociale, envié dans le monde entier. Il laisse de belles conquêtes : la mise en place de ‘’la Sécu’’ avec Pierre Laroque, les comités d’entreprises, la formation professionnelle, la médecine du travail, le statut des mineurs, celui des électriciens et gaziers, la prévention dans l’entreprise et la reconnaissance des maladies professionnelles, de multiples ajouts de dignité au Code du Travail, le statut de la fonction publique, la caisse d’intempéries du bâtiment, la loi sur les heures supplémentaires, etc… Bref, l’œuvre entière d’une vie au service des autres. Il meurt le 10 février 1951 à Paris, où un million de personnes l’accompagnent au Père Lachaise.
Le 70e anniversaire de ‘’la Sécu’’ voit cette institution passer, progressivement, de la démocratie sociale à la privatisation, via son étatisation.
Conçue comme un service public original, directement géré par les assurés eux-mêmes, par l’intermédiaire de leurs élus, la Sécu a d’abord connu une gestion démocratique qui donnait 75% des sièges aux salariés et 25% au patronat (Cette répartition, apparemment inégale des sièges, était un garde-fou indispensable devant la division des organisations syndicales). La 1e loi du 22 mai 1946 posait le principe de la généralisation de ‘’la Sécu’’ à l’ensemble de la population, mais se heurta à l’opposition des professions non salariées (en particulier des médecins). La 2e loi du 22 août 1946 étendit les allocations familiales à pratiquement toute la population. La 3e loi du 30 octobre 1946 précisa les modalités de fonctionnement du système de réparation des accidents du travail. Le financement de ‘’la Sécu’’ fut prévu par la cotisation, soit un prélèvement sur la valeur ajoutée dès la création de richesse, soit un prélèvement sur les salaires. Ainsi, la charité faisait place à la solidarité : désormais chacun recevait selon ses besoins et cotisait selon ses moyens.
Ces principes constitutifs ont été progressivement fragilisés par une prise en main progressive de l’institution par l’Etat : le décret du 12 mai 1960 a accru les pouvoirs de la direction, nommée par l’Etat. Les 4 ‘’ordonnances Jeanneney’’ du 21 août 1967 établirent le paritarisme dans les conseils d’administration, 50% des sièges pour les salariés, 50% pour le patronat, mettant fin à la démocratie sociale. Par ailleurs, elles séparèrent les risques en 4 caisses distinctes. Ainsi, la dimension politique céda le pas au pouvoir économique. Cette étatisation de ‘’la Sécu’’ s’est faite aussi par la fiscalisation, notamment par la création de la CSG, créée en 1990 et finalisée en 1996 par le plan Juppé, destinée à financer en partie ‘’la Sécu’’ par l’entremise du ministère. Suivirent la création de la Cades, instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996, pour financer la dette sociale via les prêteurs privés. Le remplacement, en 2001, de l’ancien Code de la Mutualité par un code inspiré des assurances, la réforme Douste-Blazy de 2004, limitant les pouvoirs des conseils d’administration et créant l’Union nationale des organismes complémentaires à ‘’la Sécu’’ (UNOCAM), rassemblant les mutuelles avec les institutions de prévoyance et la branche assurantielle du Medef. Citons encore l’ordonnance de 2005, instaurant le financement des hôpitaux par la tarification à l’activité (T2A), permettant aux cliniques privées de se positionner sur les secteurs les plus rentables. La loi HPST, dite Bachelot (2009), concentrant les pouvoirs de la direction, désormais nommée par l’Agence régionale de santé (ARS), une émanation directe de l’appareil d’Etat, ou encore la nouvelle définition du service public hospitalier de Marisol Touraine, l’institutionnalisation et le développement des dépassements d’honoraires…
Aujourd’hui, 30% du financement de ‘’la Sécu’’ est sous le contrôle de l’Etat via la CSG, la moitié des complémentaires sont détenues par le privé, lesquelles se voient confier une part grandissante de la médecine de ville (la plus rentable)… Quant aux retraites, elles ont été soumises à la même chronologie des attaques libérales avec de multiples tentatives, plus ou moins réussies, de passer des retraites ‘’par répartition’’ vers des retraites ‘’par capitalisation’’. La place croissante prise par les complémentaires fait redouter cette évolution.
Interrogé sur l’esprit de la Résistance et sur le consensus politique qui avait permis la création de la Sécurité Sociale, Gilles Perret a dit : ‘’Ce consensus fut obtenu dans un rapport de forces. C’est parce que les forces progressistes sont sorties grandies et puissantes à la Libération, qu’elles ont pu imposer aux forces conservatrices un programme politique ambitieux. En tant que réalisateur et citoyen, je souhaiterais que les formations politiques fassent passer l’intérêt général avant leurs intérêts particuliers. Qu’ils placent l’économie à sa place, c'est-à-dire au service de l’homme, et non l’inverse.
Le film démontre que ‘’la Sécu’’ est moins chère, plus égalitaire et plus efficiente que les assurances privées. Il faut le redire face à la pression idéologique libérale omniprésente, qui veut imposer les solutions de la concurrence et du privé. Ce sont ces solutions qui sont archaïques car elles tendent à nous ramener au chacun pour soi, alors que notre force est dans le partage et la solidarité entre les citoyens’’.
Les intervenants sont tous remarquables : Colette Bec (professeur de sociologie des politiques sociales, à Paris-Descartes), Michel Etievent (historien et journaliste), Jolfred Fregonara (syndicaliste, qui a organisé la mise en place de la Sécu en Hte Savoie), Bernard Friot (Economiste), Anne Gervais (docteur hépatologue à l’hôpital Bichat-Claude Bernard), Frédéric Pierru (sociologue au CNRS). Sans oublier des personnalités, par ordre alphabétique : Laurent Berger, Ambroise Croizat, Charles de Gaulle, Alain Juppé, Denis Kessler, Pierre Laroque, Jean-Claude Mailly, Philippe Martinez, Georges Pompidou, François Rebsamen, Claude Reichman, Paul Reynaud, Michel Rocard.
Comme le rappelle l’historien Michel Etievent, dont les commentaires scandent cette oeuvre pédagogique, "la création de la sécu, c’est une grande bataille pour la dignité, une grand bataille pour la santé et la vie." C’est tout l’intérêt de ce documentaire que de réhabiliter un homme et une oeuvre, en rappelant combien les lois du marché et leurs appétits voraces constituent une menace pour notre système de protection sociale.
LES JOURS HEUREUX
Film français de Gilles PERRET – 2013
Ce film fait revivre l'esprit du Programme du Conseil national de la Résistance
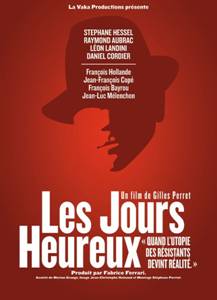 Quand l'utopie des Résistants devint réalité... Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance, intitulé magnifiquement : « Les Jours Heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, à la liberté de la presse… Pour combien de temps encore ? Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli Raconter comment une utopie, folle dans cette période sombre, devint réalité à la Libération. Raconter comment ce programme a été démantelé depuis. Questionner la réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde de demain.
Quand l'utopie des Résistants devint réalité... Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National de la Résistance, intitulé magnifiquement : « Les Jours Heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, à la liberté de la presse… Pour combien de temps encore ? Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli Raconter comment une utopie, folle dans cette période sombre, devint réalité à la Libération. Raconter comment ce programme a été démantelé depuis. Questionner la réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par ce programme pourraient irriguer le monde de demain.
Gilles Perret, après des études d'ingénieur en électronique, décide de s'orienter vers le cinéma. Depuis 1999, il consacre sa caméra à la Haute-Savoie. Préoccupé par les problématiques économiques et sociales, sa production devient, à partir de 2003, plus sociale. Gilles Perret réalise le film Walter, retour en résistance sur la vie et les convictions de Walter Bassan. Celui-ci est à l'origine du premier rassemblement le 4 mai 2007 sur le plateau des Glières en opposition à la venue de Nicolas Sarkozy, ‘’M. Sarkozy ne sert pas la mémoire des Glières et de la Résistance, M. Sarkozy se sert des Glières’’.
La projection en 2009 à Montpellier du film Walter, retour en résistance, où apparaît Stéphane Hessel, fait prendre conscience à Sylvie Crossman, fondatrice d'Indigène éditions du sens de la parole de Hessel et est à l'origine du livre Indignez-vous ! À l'occasion de la venue de N. Sarkozy le 8 avril 2010 aux Glières, Gilles Perret indique dans Le Dauphiné libéré du 15 mai 2010 : ‘’Il n'y a pas d'attaques contre les personnes, mais contre une politique qui s’oppose de façon vive au programme du CNR. On a fait des résistants des icônes, mais on a oublié leur projet !’’
C'est justement l'ambition du film sorti en 2013 Les Jours Heureux que de faire revivre l'esprit du Programme du Conseil national de la Résistance. Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n’a pas d’autre raison d’être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat n’a pas pris fin à la Libération. En effet, ce n’est qu’en regroupant ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation que la France pouvait retrouver son équilibre moral et social, en donnant au monde la preuve de son unité. Aussi les représentants des organisations de la Résistance, des centrales syndicales et des partis politiques, groupés au sein du CNR, vont-ils délibérer en assemblée plénière le 15 mars 1944, et décider de s’unir sur un programme, qui comporte à la fois un plan d’action immédiate contre l’occupant et des mesures destinées à instaurer un ordre social plus juste, dès la Libération.
Dans la présentation de son film, Gilles Perret explique pourquoi cette histoire n’est pas mieux connue : ‘’L’histoire de la Résistance a toujours été racontée à travers ses faits d’armes. La pensée politique qui l’accompagnait n’a pas été enseignée. Je crois que c’est dû au fait que, en période de gaullisme, il n’était pas de bon ton de rappeler que toutes ces avancées sociales étaient de gauche. Ensuite, avec le néo-libéralisme dans les années 80, les gouvernements se sont employés à détricoter ce programme avec les privatisations, la mise en concurrence des services publics, etc. Plus personne n’avait donc intérêt à rappeler cette histoire, qui est celle de la vraie gauche. J’ai eu la chance de rencontrer Raymond Aubrac et Robert Chambeiron, qui ont travaillé avec Jean Moulin, lequel à été le vrai penseur de cette histoire du CNR. Au-delà du film, ces hommes sont pour moi des exemples de courage, de droiture, de combativité et de fidélité à leurs idées… J’avais découvert Les jours heureux, en 2004, comme un appel « à vivre les valeurs de ce programme, toujours actuelles ». Ca a été pour moi une révélation. Ces résistants m’ont incité à faire le film, non pour la gloire, mais bien pour que les principes qui sont à la base de ce programme puissent éclairer le monde de demain. Ces gens n’ont pas pour habitude de regarder dans le rétroviseur ; ils étaient et sont encore de grands optimistes.
Les politiques néolibérales, menées en France depuis 30 ans, ont consisté à s’attaquer au programme du CNR et à l’Etat social tel que le définit l’économiste Christophe Ramaux. En octobre 2007, Denis Kessler, éminence grise du Medef encore aujourd’hui, déclarait dans le journal Challenges, à propos de la politique de Nicolas Sarkozy : « Il y a une profonde unité à ce programme ambitieux (…).Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du CNR ». En réaction à cette entreprise de démantèlement, l’association ‘’Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui’’ organise chaque année, sur le Plateau des Glières, un rassemblement autour des valeurs du CNR. Résistants, anciens et contemporains, se partagent la tribune afin de rappeler que ces valeurs sont toujours d’actualité’’. L’importance donnée à la parole, rafraîchissante, des anciens résistants ne donne pas seulement lieu à un retour narratif : elle crée un véritable réseau de mémoires qui s’accordent sur un certain nombre de points comme la nécessité d’un optimisme presque utopique, l’importance d’une stratégie de conquête politique et militaire. Mais le film souligne aussi les divergences marquées au sein du CNR, notamment entre communistes et socialistes, entre mouvements de Résistance et gaullistes - la décolonisation n’apparaîtra qu’en pointillés dans le programme final, largement inspiré par les idées de la SFIO. En outre, le film utilise avec délicatesse ses sources et ses analystes : la présence des historiens Laurent Douzou et Nicolas Offenstadt, discrète et précise, n’a pas pour seul objet la légitimation d’un discours. Elle montre le mélange d’intégrité et d’émotion du scientifique face au document, l’impossible discordance de l’objectif et du subjectif que Gilles Perret fait d’ailleurs sienne. Son engagement est in fine à la croisée des chemins historiques et intérieurs : il met l’accent sur l’accomplissement des hommes (l’union nécessaire, l’effacement de l’individu devant la finalité collective) mais également sur leur expérience humaine de la Résistance (l’angoisse de l’arrestation, l’horreur de la torture et de l’emprisonnement). Au milieu des ténors -dont on ne niera pas le rayonnement, un ancien FTP surgit : Léon Landini, résistant lyonnais arrêté et torturé par Klaus Barbie, raconte sa guérilla et s’arrête, le temps d’une visite du fort Montluc, sur la cellule où il a survécu avant la libération de Lyon. Le film prend alors son envol, en laissant simplement courir la respiration de celui qui se rappelle et qui s’accroche au souvenir de ceux qui n’avaient pas vu les enjeux politiques de la lutte qui était menée.
MOI, DANIEL BLACK
Film franco-belgo-britannique de Ken LOACH – 2016
Le poids d’une administration particulièrement étouffante, accroissant la précarité
 ‘’Dan a près de 60 ans et il a été menuisier toute sa vie. Quand il s’engage à faire quelque chose, il le fait. Il s’est occupé de sa femme mais, depuis son décès, il est un peu paumé. Et puis, il fait une crise cardiaque : son médecin lui explique qu’il ne faut plus travailler et il se retrouve face à l’administration et à des fonctionnaires tatillons qui refusent catégoriquement de l’écouter. C’est ce qui le fait bondir : il essaie alors de gérer la situation à sa façon, en étant très direct, en restant digne et en faisant appel à son sens de l’humour. Mais c’est de plus en plus difficile car tout se joue en faveur de l’administration : le système cherche à le faire taire. Puis, il rencontre Katie, qui arrive de Londres avec ses deux enfants, et ils deviennent amis. Elle est aux abois, et je pense qu’il considère Katie comme une cause qui vaut le coup de se battre. Il veut lui venir en aide, sans se rendre compte qu’il est lui-même dans une mauvaise passe.’’ (Présentation du film par Dave Johns, acteur qui joue le rôle de Daniel Blake).
‘’Dan a près de 60 ans et il a été menuisier toute sa vie. Quand il s’engage à faire quelque chose, il le fait. Il s’est occupé de sa femme mais, depuis son décès, il est un peu paumé. Et puis, il fait une crise cardiaque : son médecin lui explique qu’il ne faut plus travailler et il se retrouve face à l’administration et à des fonctionnaires tatillons qui refusent catégoriquement de l’écouter. C’est ce qui le fait bondir : il essaie alors de gérer la situation à sa façon, en étant très direct, en restant digne et en faisant appel à son sens de l’humour. Mais c’est de plus en plus difficile car tout se joue en faveur de l’administration : le système cherche à le faire taire. Puis, il rencontre Katie, qui arrive de Londres avec ses deux enfants, et ils deviennent amis. Elle est aux abois, et je pense qu’il considère Katie comme une cause qui vaut le coup de se battre. Il veut lui venir en aide, sans se rendre compte qu’il est lui-même dans une mauvaise passe.’’ (Présentation du film par Dave Johns, acteur qui joue le rôle de Daniel Blake).
Récompensé par la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, Ken Loach nous propose une radiographie, glaciale mais d’une infinie pudeur, de son Angleterre des laissés-pour-compte. Avec ses 13 participations à la compétition officielle et ses 18 films présentés à Cannes, Ken Loach fait partie des figures du festival. Si on a pu se poser des questions sur la pertinence de certaines de ses participations, comme Route Irish, un thriller un peu essoufflé sur fond de guerre en Irak présenté en 2010, sa dernière réalisation ne laisse aucune place au doute. Si Loach s’est rendu tant de fois sur la Croisette, c’est tout simplement parce qu’il reste, à 80 ans, l’un des plus grands réalisateurs de notre époque.
Capable, en poursuivant perpétuellement les mêmes obsessions, de se réinventer le cinéaste, désormais membre du club très fermé des détenteurs d'une double-Palme d’or (avec Le vent se lève en 2006), a signé un chef d’œuvre de pureté et de pudeur. Un chef d’œuvre dépouillé, teinté d’une colère glaçante. Ken Loach, qui avait pourtant laissé entendre que Jimmy’s Hall, qui contait le retour sur ses terres irlandaises d’un ancien leader communiste parti en exil aux États-Unis, serait son ultime réalisation, a pourtant décidé de reprendre la caméra pour raconter l’histoire de Daniel Blake, un héros ordinaire et sublime à la fois.
Au scénario, Paul Laverty l’acolyte de toujours, l’alter ego venu de Glasgow. Celui du magnifique Le Vent se lève, celui de My name is Joe, celui encore de Sweet Sixteen. Les deux hommes, une nouvelle fois, parviennent à proposer une radiographie saisissante de l’Angleterre des pauvres. Et on sent aussitôt que ce Moi, Daniel Blake ne sera pas qu’un simple film de plus. Loin de là. Daniel a une bonhomie toute naturelle. L’œil rieur et le contact facile. Il vit dans un immeuble modeste d’un quartier anglais défavorisé. Un quartier oublié, qu’on découvre par un caddie abandonné, des ordures qui jonchent les trottoirs et qu’un chien à trois pattes tente de contourner. Là-bas, même les bêtes sont éclopées, semble nous dire K. Loach. Dans ce décor de la fatalité sociale, Dan’ tente de continuer, malgré tout. Car, pour la première fois de sa vie, il se voit contraint de faire appel à l’aide sociale à cause d’un problème cardiaque qui l’empêche de travailler, selon l’avis de son médecin, car l’administration a ses aberrations qui l’obligent à rechercher un emploi, sous peine de ne plus toucher les indemnités de chômage. Un drame kafkaïen, qui rappelle l’époque victorienne où la pauvreté n’était combattue que par la pénalisation des pauvres, rendus responsables de leur malheur.
Mais Dan’ n’a pas les codes. Lors de l’un de ses rendez-vous au "Job Center", il croise la route de Katie, une jeune mère célibataire, qui est en train de sombrer. Ensemble, ils vont se battre. Elle avec rage pour ses deux enfants. Lui, fièrement et jusqu’au bout, pour que ses droits soient reconnus.
On admire chez Daniel Blake, des qualités de droiture et de désintéressement déconcertantes, sans doute l’ombre de Ken Loach lui-même. L’un des derniers cinéastes de son pays, ultralibéral, à parler encore de la classe ouvrière de cette Angleterre du Brexit. Celle des démunis, des oubliés.
Le film se situe et a été tourné à Newcastle. Ken Loach a choisi cette ville parce qu'il ne la connaît pas bien et qu'il voulait découvrir un autre endroit. Il poursuit: "Newcastle est d’une grande richesse culturelle. Comme Liverpool, Glasgow et ces autres grandes villes de bord de mer. Elles rendent magnifiquement bien à l’image, le patrimoine culturel y est très riche, et les particularismes linguistiques y sont très marqués. C’est une région qui affirme sa différence : des générations d’hommes et de femmes se sont battus et ont développé une conscience politique très solidement ancrée."
Le thème principal de Moi, Daniel Blake est le poids d’une administration particulièrement étouffante, accroissant encore plus la précarité. "Quand on a affaire à une administration aussi consternante de bêtise, aussi ouvertement déterminée à vous rendre fou, on éprouve une terrible frustration qui peut donner lieu à de vraies scènes d’humour noir. À mon avis, si on arrive à raconter cela de manière réaliste, et si on réussit à percevoir les sous-entendus d’une relation entre un simple citoyen et un fonctionnaire tout-puissant, au guichet ou au téléphone, on devrait en comprendre l’humour, la cruauté et, au final, le tragique. “Les pauvres sont responsables de leur pauvreté” : Voilà ce qui protège le pouvoir de la classe dominante", confie Ken Loach. Dave Johns a été choisi par Ken Loach pour se glisser dans la peau de Daniel. Il a jeté son dévolu sur lui parce qu'il est aussi humoriste et, selon le cinéaste, les humoristes connaissent généralement bien le monde ouvrier. "Ils sont marqués par leurs origines et leur personnage sur scène s’en fait souvent l’écho – et c’est ça que nous recherchions. Dave possède cette dimension. Il est de Byker, où nous avons tourné certaines scènes. Il a l’âge du rôle, et c’est un garçon d’origine ouvrière capable de vous faire rire et sourire – ce qui correspond à ce que l’on voulait", note Loach. Pour se préparer au tournage, Dave Johns a suivi un apprentissage de menuiserie. Il a par ailleurs passé deux jours sous un pont, dans un endroit où les SDF peuvent se rendre pour réparer des meubles, aux côtés d'un sculpteur sur bois, et aussi pour apprendre à faire les poissons que son personnage Dan aime sculpter. Bien qu’ayant côtoyé plusieurs tranches d'âges de personnes dans la précarité lors de la phase de documentation, Ken Loach et Paul Laverty ont voulu centrer l'intrigue de Moi, Daniel Blake sur les quinquagénaires et les sexagénaires. Le cinéaste explique : "Il y a toute une génération de travailleurs manuels qualifiés qui se rapprochent aujourd’hui de l’âge de la retraite. Ils souffrent de problèmes de santé et ils sont incapables de reprendre le travail car ils ne sont plus assez vifs pour jongler entre deux intérims et passer d’un petit boulot à l’autre. Ils sont habitués à un cadre professionnel plus traditionnel et du coup, ils sont perdus. Ils sont déboussolés par les nouvelles technologies, ils ont des problèmes de santé, et leur prise en charge par l’“Employment Support” est conditionnée par une série d’évaluations : ils peuvent très bien être jugés aptes au travail alors qu’ils ne le sont pas."
A 80 ans, Ken Loach n'a pas baissé sa caméra. Il a gardé intacts sa colère, son empathie, son humanisme. Il peint, à nouveau, « son » Angleterre, celle du peuple qu’il est le seul, désormais, sur son île ultralibérale, à les défendre. Il rappelle ici qu'il est question de vie ou de mort. De la vraie faim et de la vraie misère, avec toute leur suite d'exclusions et d'humiliations. Dans une banque alimentaire, Katie, qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, s'effondre. Cette scène déchirante évoque autant l'Angleterre victorienne que celle d'aujourd'hui. Manière, pour Ken Loach, de nous rappeler que, dans ce monde ‘’moderne’’, ce n'est pas Daniel Blake qui est anachronique, c'est la violence sociale.
Réaction d'une internaute :
Très beau film, "remuant" au bon sens du terme. Je n'oublierai pas de sitôt, Daniel et Katie, les deux personnages principaux du film. Ken Loach, a su nous décrire, sans grands effets ni sentimentalisme, la précarité et la chute vers la très grande pauvreté, que vivent ses deux
héros. La scène dans la banque alimentaire où l'on s'aperçoit que Katie meurt littéralement de faim est saisissante. En même temps Katie et Daniel vivent une belle amitié qui les aide à vivre l'insupportable. Quelques belles figures aussi de personnages secondaires comme ce jeune noir, qui vit de petits trafics ou cette employée plus compréhensive que
ses collègues... De quoi réfléchir sur la rigueur administrative et les sanctions
frappant les plus pauvres, décidées en haut lieu... Marie-Madeleine
L’HISTOIRE DE L’AMOUR
Film américain de Radu MIHAILEANU – 2016
Une lumineuse fresque romanesque
 Il y a 60 ans, la guerre a séparé Léo et Alma, deux jeunes polonais. Parce qu’elle est juive, Alma a dû fuir à New York. Elle a fait promettre au jeune homme de venir la retrouver. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Pourtant, Léo a survécu à tout pour la retrouver et tenir sa promesse. Depuis Léo, qui n’a jamais oublié son grand amour, mène une vie fantasque auprès de son ami Bruno Leibovitch à Chinatown.
Il y a 60 ans, la guerre a séparé Léo et Alma, deux jeunes polonais. Parce qu’elle est juive, Alma a dû fuir à New York. Elle a fait promettre au jeune homme de venir la retrouver. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Pourtant, Léo a survécu à tout pour la retrouver et tenir sa promesse. Depuis Léo, qui n’a jamais oublié son grand amour, mène une vie fantasque auprès de son ami Bruno Leibovitch à Chinatown.
A Brooklyn, de nos jours, une autre jeune fille, prénommée aussi Alma, connaît ses premiers émois amoureux. Elle sort avec un garçon mais le repousse pour ne pas passer pour une fille facile. Malgré son jeune âge, la jeune fille ne se fait guère d’illusions sur l’amour. C’est alors qu’elle croise la route de Léo : devenu un vieux monsieur, espiègle et drôle, il vit avec le souvenir de ‘’la femme la plus aimée du monde’’, le grand amour de sa vie. Rien ne semble lier Léo à la jeune Alma. Et pourtant… De la Pologne des années 30 à Central Park aujourd’hui, un voyage à travers le temps et les continents va unir leurs destins.
L’histoire de l’amour est une adaptation du roman de l’auteure Nicole Krauss. Si ce choix peut surprendre, au vu de la filmographie militante de Radu Mihaileanu, le réalisateur explique avoir voulu ‘’défendre ces dinosaures utopistes qui se battent pour le sentiment amoureux, pour l’amour qui aide à survivre à tout (car) aujourd’hui la plus grave et profonde crise que l’humanité traverse, et qui engendre toutes les autres, c’est l’incapacité d’aimer l’autre’’. Le compositeur français Armand Amar, qui avait déjà gagné un César pour la musique du Concert en 2010, signe la bande originale du film.
Après Le Concert et La Source des femmes, Radu Mihaileanu réalise une lumineuse fresque romanesque, aussi espiègle que grave, qui embrasse généreusement personnages, pays et époques diverses.
Dans leur village natal, dans la Pologne de 1940, ces projets radieux se heurtent à la dure réalité historique: les Allemands s’approchent de leur village, semant partout la désolation et la mort. La famille d’Alma fuit vers l’Amérique. Mais Leo n’a pas les moyens de la suivre ; alors, il lui promet de survivre pour venir la retrouver à New York.
Dans cette même ville, en 2006, Alma adolescente vit ses premières amours contrariées. Sa mère, qui avait choisi ce prénom en référence à un roman sublime, lui assure qu’elle sera comme son héroïne « la femme la plus aimée au monde. » Mais entre la disparition brutale de son père, sa mère dépressive et son petit frère qui se prend pour le messie, cette perspective paraît bien lointaine, voire dénuée d’intérêt, à Alma.
‘’La femme la plus aimée au monde’’: c’est la promesse de Leo à Alma et, comme si ce serment d’un amour hors du commun pour la vie ne suffisait pas, il jure de la faire rire jusqu’à la fin de leurs jours. Pour plaire à cette passionnée de littérature et écarter Zvi et Bruno, ses rivaux, il veut devenir un grand écrivain afin d’ajouter à son bonheur réel les évasions de la fiction.
L’Histoire de l’amour que Radu Mihaileanu, membre du jury, a présenté au Festival de Deauville, porte en lui toute l’énergie et la fantaisie de son réalisateur. Ce récit adapté du roman de Nicole Krauss trouve un écho dans sa propre histoire familiale. Né en 1958 sous la dictature communiste en Roumanie, Radu Mihaileanu est le fils d’un journaliste juif, qui fut déporté dans un camp de travail mais qui a survécu au nazisme, au stalinisme, à Ceausescu et à l’émigration, grâce à son humour.
L’Histoire de l’amour sait allier le souffle d’une grande romance sur un fond historique dramatique avec une ambiance espiègle et pétillante. Ce récit complexe se déroule sur soixante années et dans trois pays différents (la Pologne, les États-Unis et le Chili) sans perdre en route les spectateurs. Le travail sur l’image, plus proche du 35 mm pour les scènes qui se passent dans le passé et en numérique pour celles qui se passent au présent, facilite le repérage dans le temps.
Pour ces personnages aux destins exceptionnels, le film réunit des acteurs charismatiques. Gemma Arterton est très crédible dans son rôle de ‘’femme la plus aimée du monde’’ sous le regard ébloui de Leo. Derek Jacobi est cet amoureux transi, devenu un vieux monsieur fantasque qui cache son chagrin tout en retenue; il forme un duo déjanté et émouvant avec Elliott Gould, étonnant Bruno. Sophie Nélisse apporte sa grâce et son dynamisme à l’adolescente new-yorkaise qu’elle joue.
Certains s’agaceront peut-être d’une mise en scène trop démonstrative soulignée par les violons. D’autres se laisseront emporter par cette saga ambitieuse qui est un hymne à l’amour lumineux et bouleversant.
D’autres encore reprocheront à Radu Mihaileanu sa vision trop large et trop grande. Le réalisateur de Vas, vis et deviens et du Concert aime les vastes espaces qui font voyager les sentiments à travers les tragédies de l'histoire. Il est porté par une inspiration généreuse, il déborde de vitalité chaleureuse, et son invitation lyrique à célébrer l’amour sincère et durable ne peut laisser indifférent
LE MYSTERE JEROME BOSCH
Film franco-espagnol de José Luis Lopez-Linares – 2016
A l’heure de la mondialisation, ce film chante le langage universel de l’art.
 500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands peintres flamands, continue à intriguer avec une œuvre aussi fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À travers « Le Jardin des Délices », historiens de l’art, philosophes, psychanalystes en cherchent le sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le temps. Le Mystère Jérôme Bosch s’achève comme il a commencé : par la contemplation du chef-d’œuvre de l’artiste, Le Jardin des délices. Dans le célèbre musée du Prado, ce sont d’abord des visiteurs que l’on voit, presque sidérés par l’inépuisable richesse de cette fresque et à qui l’on donnerait volontiers laissé la parole, puisque Bosch résiste aux lectures les plus savantes. Les spécialistes, les uns après les autres, partagent leurs diverses interprétations, convoquant la religion, la psychanalyse ou le surréalisme, sans jamais réussir à épuiser le contenu de l’œuvre.
500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un des plus grands peintres flamands, continue à intriguer avec une œuvre aussi fascinante qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À travers « Le Jardin des Délices », historiens de l’art, philosophes, psychanalystes en cherchent le sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le temps. Le Mystère Jérôme Bosch s’achève comme il a commencé : par la contemplation du chef-d’œuvre de l’artiste, Le Jardin des délices. Dans le célèbre musée du Prado, ce sont d’abord des visiteurs que l’on voit, presque sidérés par l’inépuisable richesse de cette fresque et à qui l’on donnerait volontiers laissé la parole, puisque Bosch résiste aux lectures les plus savantes. Les spécialistes, les uns après les autres, partagent leurs diverses interprétations, convoquant la religion, la psychanalyse ou le surréalisme, sans jamais réussir à épuiser le contenu de l’œuvre.
Pour la première fois, une caméra scrute les mille et un détails du Jardin des délices. Une caméra envieuse qui capte des regards fascinés. Au Prado, devant les mille et un détails du Jardin des délices, triptyque de Jérôme Bosch, des Japonais croient reconnaître leurs mangas. Des adolescentes pouffent devant les scènes érotiques. Des adultes qui ont connu la guerre et le baby-boom admirent la prescience: tout, de la civilisation des loisirs et des boucheries modernes, semble déjà là en effet.
En plus de faire la direction de la photographie sur de nombreux films de Carlos Saura, José Luis López-Linares occupe les postes de chef opérateur et assistant réalisateur, mais aussi ceux de producteur de documentaires et de scénariste. Avec Le mystère Jérôme Bosch, il signe un foisonnant et passionnant documentaire sur cet étrange triptyque qui continue d’interroger la place et le rôle de l’art dans l’histoire du monde. Pour en donner d’autres visions, mettre en évidence son importance, le documentariste donne la parole à de nombreux experts ou artistes issus de différents pays. Devant le tableau, chacun y va de son ressenti, de son analyse, le réalisateur multipliant les points de vue et les interprétations. ‘’Je souhaitais faire un film qui soit le plus international possible autour d’un tableau qui, à l’échelle mondiale, est iconique’’, explique le documentariste. Le mystère Jérôme Bosch devient alors un film sur le langage universel de l’art, ces témoignages de différents pays qui se répondent dans plusieurs langues finissant ainsi par tisser une mosaïque aux diverses tonalités.
‘’L’idée était d’instaurer une conversation entre des personnes qui avaient réfléchi et travaillé sur le tableau’’, poursuit José Luis López-Linares.‘’Je ne cherchais pas vraiment à comprendre tous les aspects techniques, ni les théories visant à élucider le style de Jérôme Bosch. Je voulais réunir des individus qui posent des questions perspicaces et spirituelles et qui m’aideraient, ainsi que les spectateurs, à mieux appréhender le tableau plus qu’à l’expliquer. D’une certaine manière, j’ai fait appel à des visiteurs du musée du Prado, mais des visiteurs un peu « spéciaux »’’. Son but est bien d’apporter un éclairage différent et plus exhaustif de l’œuvre de Jérôme Bosch tout en s’éloignant de toute velléité avant-gardiste et obscure. Sous la démarche pédagogique de faire un film à la fois riche et abordable, José Luis López-Linares, s’il ne convie aucun cinéaste, n’en oublie pas pour autant de faire du cinéma.
Un tel sujet se voit souvent menacé par l’académisme, ou par une réalisation peu ingénieuse qui enchaîne les entretiens les uns après les autres. José Luis López-Linares arrive à se tirer de ce mauvais pas en donnant à son documentaire un rythme alerte soutenu par une utilisation volontairement anachronique de la musique. ’’Grâce à la musique, il est aisé pour un réalisateur d’orienter les émotions du spectateur, d’élargir son champ de perceptions visuelles’’, explique le documentariste. ‘’Le sens de l’objet n’est pas modifié mais il prend une autre couleur. Le public le perçoit (ou du moins, on lui donne l’opportunité de le percevoir) comme une nouvelle entité dans laquelle la musique prend toute sa place. C’est pourquoi elle est aussi fondamentale pour moi qu’un scénario. Dès le début du film, j’ai travaillé avec Universal Music Espagne qui m’a offert de puiser dans son généreux catalogue. J’ai demandé Jacques Brel et il y figurait, de même que Lana del Rey, Arvo Pärt, Bach et Elvis Costello. La bande originale, éditée par leurs soins, est d’ailleurs disponible. Trouver la bonne musique pour un film est toujours une étape difficile pour moi. Dans ce cas précis, je ne voulais pas d’une musique d’époque. J’ai essayé de concevoir une bande originale aussi variée et moderne que le tableau.’’ À ce parti pris osé, de mélanger les genres musicaux et les époques, José Luis López-Linares propose un découpage enlevé et serré qui multiplie les gros plans, alternant les vues sur des détails du tableau avec des images d’archives d’événements plus ou moins récents qui y font écho.
Ainsi, Le mystère Jérôme Bosch met en évidence les différentes étapes de la création du tableau, révèle images et sens cachés, mais aussi la modernité de son esthétique et de son regard sur l’humanité, ses mœurs et ses peurs. Par le rapport qu’entretenait Jérôme Bosch avec la religion, et qui se ressent dans son œuvre, José Luis López-Linares concède au Jardin des délices et à ses visions oniriques, tantôt paradisiaques tantôt infernales, des vertus quasi-prophétiques. Par là, le cinéaste évoque également la place de la religion dans la société, son influence et le regard qu’elle porte sur les événements.
Voilà bien par le montage, par celui des images et des idées, la magie du cinéma qui opère : celle d’établir des liens de révélation entre les individus et les événements qui façonnent l’Histoire et les peuples. Le mystère Jérôme Bosch, entre documentaire historique et réflexion philosophique voire existentielle, célèbre le prestige de l’art et perpétue néanmoins tout le mystère qui entoure Le jardin des délices et son auteur.
LA MORT DE LOUIS XIV
Film français de Albert SERRA – 2016
Le film s’intéresse à la mort. Elle survient au moment où on ne l’attend plus, comme un rien.
 Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe. Les jours suivants, le Roi poursuit ses obligations mais ses nuits sont agitées, la fièvre et la gangrène le gagnent. Il se nourrit peu et s'affaiblit de plus en plus. C’est le début de la lente agonie du plus grand roi de France, entouré de ses fidèles, de ses médecins et des représentants de l’Eglise. Acteur fétiche de François Truffaut et véritable icône de la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud se glisse dans la peau de Louis XIV, un personnage à la mesure de son talent. C’est d’ailleurs avec ce rôle qu’il s’est vu remettre une Palme d’honneur au 69e Festival de Cannes. Pour rester le plus fidèle possible à l’Histoire, Albert Serra a lu les Mémoires de Saint-Simon et les Mémoires du Marquis de Dangeau, qui relatent avec précision les derniers moments du Roi Soleil. « Le film s’intéresse en premier lieu à cette banalité de la mort. Elle survient au moment où on ne l’attend plus, comme un rien. »
Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe. Les jours suivants, le Roi poursuit ses obligations mais ses nuits sont agitées, la fièvre et la gangrène le gagnent. Il se nourrit peu et s'affaiblit de plus en plus. C’est le début de la lente agonie du plus grand roi de France, entouré de ses fidèles, de ses médecins et des représentants de l’Eglise. Acteur fétiche de François Truffaut et véritable icône de la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud se glisse dans la peau de Louis XIV, un personnage à la mesure de son talent. C’est d’ailleurs avec ce rôle qu’il s’est vu remettre une Palme d’honneur au 69e Festival de Cannes. Pour rester le plus fidèle possible à l’Histoire, Albert Serra a lu les Mémoires de Saint-Simon et les Mémoires du Marquis de Dangeau, qui relatent avec précision les derniers moments du Roi Soleil. « Le film s’intéresse en premier lieu à cette banalité de la mort. Elle survient au moment où on ne l’attend plus, comme un rien. »
Albert Serra est catalan. Il appartient à ces réalisateurs que l’on pourrait qualifier ‘’d’hypnotiques’’ ; rien dans son œuvre n’est a priori facile, ni le choix de ses sujets : celui de Don Quichotte dans Honor de Cavalleria (2006) ou encore Histoire de ma mort (2013) d’après Casanova, ni non plus le rythme mélancolique imprégnant les séquences qui suivent, du 9 août au 1e septembre 1715, l’agonie du Roi. Il ne propose pas un miroir au spectateur ni même son envers, mais un autre temps où il faut plonger et ainsi peut-être percevoir, dans les voix et les transports des fantômes qu’il expose, un monde poétique où le morbide voisine avec l’humour et où l’impuissance est une part d’enfance retrouvée. Le cinéma d’Albert Serra peint un sujet relatif, sans ignorer, qu’en lui, rayonne l’absolu. Voici comment il présente son travail :
‘’Le cinéma est entré dans ma vie un peu par hasard. Cela provient d’une rencontre entre un moment de ma vie où, avec mes amis, nous voulions produire des objets esthétiques et l’apparition de petites caméras numériques. Le numérique a, en quelque sorte, déverrouillé la possibilité de l’action. Il nous a permis de « faire du vrai cinéma » en interaction avec notre vie. Avec lui, la connaissance technique n’était plus un problème insurmontable. En 2002, on a commencé à faire des films. Aucune nécessité ne m’a obligé à employer des techniciens professionnels, et j’ai privilégié le travail avec les gens que j’aime. J’ai approché l’idée qu’un film s’apparente à une célébration, une espèce de fête conçue comme une vie parallèle, où l’on sort de la routine, de l’ennui. Le numérique m’a autorisé à créer des films dans un esprit similaire aux récits automatiques. Honor de Cavalleria, je l’ai tourné en quinze jours. Ça n’a pas été très long non plus pour la Mort de Louis XIV. Je n’aime pas les pauses. Je tourne en continu. Je préfère que les scènes s’enchaînent les unes aux autres. De toutes les manières, je suis, pour le dire d’une façon banale, un serviteur des acteurs. J’essaie de bouger le film en fonction de leurs inspirations. Avant tout, je tente d’inventer des signes. La Mort de Louis XIV est dans ce sens un récit inédit. On assiste aux derniers instants du roi de droit divin. Il est entouré de médecins plus extravagants et perdus les uns que les autres. Il y a beaucoup d’ironie et de drôlerie dans cette dernière affirmation de la vie. Le film s’intéresse en premier lieu à cette banalité de la mort. Elle survient au moment où on ne l’attend plus, comme un rien.
Avec Jean-Pierre Léaud, on s’est croisé lors d’un festival. Avant tout, j’aime sa relation au cinéma. Il a un rapport non mercantile à son art. Il m’a dit n’avoir fait aucun film pour l’argent. Après, l’homme m’a séduit. Je ne parle pas de son statut d’icône. Je connais, bien sûr, ses films mais je ne porte pas cette tradition de la nouvelle vague. Bref, il ne s’agissait pas de montrer la mort d’Antoine Doinel (personnage de fiction, inventé par F. Truffaut pour 5 de ses films). J’apprécie chez lui son intégrité morale, sa photogénie et sa folie. Son talent lié à son éthique confine au génie’’…
Splendide dans sa royale agonie, Jean-Pierre Léaud donne chair et corps au film du réalisateur catalan, dans un clair-obscur où se mêlent magie et médecine. Celui qui voudrait dire un mot de la Mort de Louis XIV d’Albert Serra se trouverait placé dans une position que le film précisément ne cesse de décrire. Cette Mort ne nous invite à son chevet. C’est une position elle-même dédoublée, divisée : celle du médecin qui scrute sur le corps du roi les signes d’une agonie indéchiffrable, et celle du valet qui cherche à en soulager les plaintes. Le film veille le roi et le spectateur veille le film, dans l’attente grave de la mort annoncée. Tout un jeu de regards se construit là, saturant l’espace clos de la chambre autour du lit central où un corps nous regarde, impressionnant.
Albert Serra est un homme de son temps, qui s’intéresse à l’Histoire et à la manière dont elle peut influencer notre vie courante. Aussi, en 2015, alors que la France célébrait le tricentenaire de la mort de Louis XIV, a-t-il réalisé ce film puissant qui s’attarde sur les deux dernières semaines d’un homme qui a régné plus de 70 ans sur le pays. En s’appuyant sur Les Mémoires de Saint-Simon et du Marquis de Dangeau, deux courtisans tous les deux présents lors de l’agonie du roi, le réalisateur propose ce huis-clos pour représenter les derniers instants d’un homme malade, dans son intimité et sa douleur. Il met en scène une dichotomie entre la mort d’un personnage public comme le Roi de France et la longue agonie vue dans l’intimité d’un malade banal. Car loin de dramatiser, ou de s’intéresser uniquement à la fin d’un homme célèbre, le réalisateur s’attarde plutôt sur un corps, qu’il filme au plus près, afin de montrer comment la maladie prend, progressivement, toute la place.
Comment rester insensible, quand on est un public du XXIe siècle, aux longues discussions entre médecins, qui prennent des décisions que nous pouvons juger abracadabrantes aujourd’hui ? Ce qui est jugé comme potentiellement efficace en 1715 sur un patient malade est une aberration pour un public converti aux soins et à la médecine générale. Aussi, pendant que le roi attend son traitement en toute confiance, le spectateur se glisse dans une conversation qui a vraiment eu lieu il y a 300 ans.
Bien que le public connaisse l’issue des trois semaines d’agonie du Roi-Soleil, l’intérêt du film est incontestable, aussi bien d’un point du vue historique que médical. Mise en scène intime, cadrage impeccable, photographie minutieuse… Si la forme est de qualité, le fond est également intéressant, puisqu’il s’agit à la fois d’évoquer la maladie, la dépendance et la souffrance de la fin de vie, autant pour le patient que pour son entourage. On ne sait plus bien dans quel monde on végète. Ce film est comme une psalmodie, accompagnant le grand homme confronté à sa condition de simple mortel. En terminant, je reprends la remarque de Jacques Morice dans sa critique pour Télérama : Que Jean-Pierre Léaud, avec sa perruque haute et large qui diffuse une lumière blafarde, incarne le Roi-Soleil apporte beaucoup à l’histoire. Qui, mieux que ce mythe vivant, aurait pu ainsi gémir, s’assoupir et râler devant nous ? Certains donnent leur corps à la science, lui c’est au cinéma’’.
Ce film est un hymne au sentiment amoureux, à la rébellion et à la folie.
MAL DE PIERRES
Film franco-belge de NICOLE GARCIA – 2016
 Dans un petit village du sud de la France, Gabrielle a le tort d’exprimer de façon passionnée ses émotions et ses sentiments. Elle est animée, presque dévorée par le désir, toujours inassouvi, une quête extrême qui la conduit presque à la folie. Elle vit dans un état de rage, de frustration charnelle, presque d’obsession. Ses parents décident de la marier plutôt que de la faire interner. Ils font de José, un ouvrier agricole patient et généreux de leur exploitation, l’heureux élu. Malgré l’attention et l’amour qu’il lui porte, Gabrielle affirme qu’elle n’aimera jamais cet homme qui lui est imposé. Tout bascule lorsqu’elle est envoyée en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, la maladie de la pierre. Elle y rencontre André Sauvage, un soldat qui revient de la guerre d’Indochine, avec qui elle découvre l’amour et la passion…
Dans un petit village du sud de la France, Gabrielle a le tort d’exprimer de façon passionnée ses émotions et ses sentiments. Elle est animée, presque dévorée par le désir, toujours inassouvi, une quête extrême qui la conduit presque à la folie. Elle vit dans un état de rage, de frustration charnelle, presque d’obsession. Ses parents décident de la marier plutôt que de la faire interner. Ils font de José, un ouvrier agricole patient et généreux de leur exploitation, l’heureux élu. Malgré l’attention et l’amour qu’il lui porte, Gabrielle affirme qu’elle n’aimera jamais cet homme qui lui est imposé. Tout bascule lorsqu’elle est envoyée en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, la maladie de la pierre. Elle y rencontre André Sauvage, un soldat qui revient de la guerre d’Indochine, avec qui elle découvre l’amour et la passion…
Nicole Garcia sait tout faire : jouer sous la direction des plus grands (Alain Resnais, Claude Sautet, Henri Verneuil…), monter sur scène comme dans La Mouette, et même réaliser des films. Le dernier en date est Le mal de pierres, qui était dans la sélection officielle de Cannes. Son audace y fut saluée et son histoire d’amour, voire sa maladie d’amour, très appréciée bien que non récompensée ! Marion Cotillard, qui illumine ce film, fit un aller-retour de Londres, juste pour assister à la projection. Le scénario est adapté du livre de l’écrivain italien Milena Angus, Mal de pierre.
Nicole Garcia compare son héroïne Gabrielle à la Adèle H de Truffaut (1975). Elle pourrait aussi être une cousine éloignée de Mademoiselle Julie (de Liv Ullmann, en 2014), ou de Madame Bovary dont elle partage la folie ou le romantisme. Car Gabrielle aime, ou plutôt veut aimer, au point d’en être embarrassante pour ses parents, bourgeois provinciaux des années 50 qui la marieront à un ouvrier pour la ‘’caser’’. Mais jamais la jeune femme ne renoncera "à la chose absolue", surtout pas quand elle rencontrera un soldat français qui lui fera tourner la tête en l’entraînant dans une valse des sentiments balayant tout sur son passage.
Elle l’avait déjà prouvé avec The Immigrant, De rouille et d’os ou Macbeth : Marion Cotillard est une tragédienne hors pair et le démontre à nouveau avec ce personnage sensuel, moderne et farouche, enrichi par ses contradictions. Capable de la pire froideur avec son mari (la révélation Alex Brendemühl, bouleversant de dévotion) comme de l’abandon le plus total avec son amant distant, l’héroïne qu’elle incarne nous fait vibrer aux rythmes des battements de son cœur, trop bruyants pour la société dans laquelle elle vit.
Rares sont les cinéastes qui osent inventer des personnages aussi exaltés, amoureux excessifs, dont les sentiments et les désirs doivent faire plier le réel, qui les magnifient plutôt que d’en faire l’objet de risée ou de jugement. Gabrielle est une femme qui se fourvoie et qui a raison de se fourvoyer. On se laisse emporter par le Mal de pierres de Nicole Garcia car c’est un hymne au sentiment amoureux, mais aussi à la rébellion et à la folie.
Grand film romantique, Mal de pierres montre la trajectoire de Gabrielle, portée par Marion Cotillard incandescente, qui ne se résout pas à accepter sa condition d’épouse du bel ouvrier catalan auquel la destine sa mère, pressée de se débarrasser de sa fille fantasque. Son corps se révolte, lui tord les boyaux et finalement, les dérèglements de sa vie intérieure et affective l’obligent à partir de faire soigner dans un sanatorium. Elle y rencontre un séduisant opiomane (Louis Garrel). Variation de ton et de lumière entre le gel de la montagne suisse et le ciel bleu électrique du Sud, où la jeune femme retournera vivre avec son mari, une fois soignée. Mais guérit-on jamais d’une passion ? Dans ce film, Nicole Garcia dessine en creux un manifeste et rend hommage à la jeune fille enfouie toujours vibrante.
Mal de pierres est comme un ruban que l’on déroule : en arrivant au bout, on découvre qu’il contient un bijou. Le passage à l’écran de ce roman magnifie l’histoire originelle. On apprécie le travail délicat sur le mouvement, les lignes corporelles, chaque geste qui transforme les scènes en ballet. L’époque est montrée par touches, qui affinent le style de l’image tout en donnant un sentiment d’intemporalité ; et la présence continuelle de l’eau reflète les émotions de Gabrielle, finalement mieux que les mots eux-mêmes.
Ce très beau drame psychologique nous transporte jusqu’à la dernière minute. L’héroïne, qui souffre tout au long de sa vie d’un mal-être diffus, va se forger une carapace émotionnelle, tout simplement pour vivre. Marion Cotillard porte le film avec une étonnante justesse, extrêmement touchante.
‘’Ce destin de femme incarne pour moi la forme de l’imaginaire, la puissance créatrice dont nous sommes tous capables lorsque nos aspirations, nos sentiments, nous conduisent aux extrémités de nous-mêmes, à notre propre dépassement’’, a déclaré Nicole Garcia, qui s’est approprié le matériau initial, s’éloignant de la trame du roman sans en trahir l’esprit. Il en ressort un récit alliant simplicité narrative et complexité psychologique des personnages, qui flirte un temps avec le fantastique mais sans s’y frotter véritablement (ce qu’ont déploré certains), préférant la suggestion et l’installation du doute aux ruptures radicales de ton et de genre. On est bien sûr à mille lieues des fulgurances de Max Ophuls (Madame de...) ou de Jane Campion (La Leçon de piano), qui ont filmé la passion dévorante avec plus d’ardeur. Mais Nicole Garcia n’a pas l’ambition de renouveler les formes cinématographiques et s’inscrit davantage dans la lignée du classicisme maîtrisé du Claude Sautet de Un cœur en hiver (1992).
Dans un entretien entre Nicole Garcia et Marion Cotillard, mené par Romain Thoral pour la revue Illimité éditée par UGC, la cinéaste parle de l’actrice principale qu’elle a choisie ‘’pour la dose de mystère qu’elle dégageait’’ : ‘’Marion a quelque chose de mystérieux oui, mais pas comme une nappe de brouillard façon Garbo ou Gardner, parce qu’elle est très vivante. Disons qu’elle a du mystère dans son aura, sa sensualité, son côté sauvage. Elle possède quelque chose de l’ordre de l’indicible. Surtout, je crois que ce mystère vient de sa photogénie, de l’alchimie qu’elle fait naître entre la pellicule et son visage.
« La star est star parce que le système technique du film développe et excite une projection-identification. Il culmine en divinisation lorsqu’il se fixe sur ce que l’homme connaît de plus émouvant au monde : un beau visage humain ». Le journaliste cite ici Edgar Morin, en 1957, dans son essai Les stars. Pour lui, Marion Cotillard est l’incarnation de cette idée-là. Celle-ci réagit à ses propos : ‘’La chose, qui peut être invisible, mais ce qui va être le point de départ dans ma construction du personnage, c’est ma manière de respirer. Tout se joue là-dedans… Après cela, je laisse libre cours à mon imaginaire : j’explore, par exemple, la petite enfance de Gabrielle ; j’essaye de trouver le moment où le formatage et le conditionnement ont altéré sa personnalité. Pour Gabrielle, je ne saisissais pas pourquoi elle ne s’était pas enfuie de chez ses parents, pourquoi elle acceptait d’être en quelque sorte leur prisonnière. Alors, j’ai imaginé sa fugue et j’ai compris que ça s’était très très mal terminé et qu’elle avait dû retourner chez eux. C’est nécessaire tout ça, parce qu’il faut vraiment que chaque cellule de votre corps prenne vie pour quelqu’un d’autre’’. Fidèle à son crédo, elle met son art au service du metteur en scène, rien d’autre. Ce qui fait dire à Nicole Garcia : ‘’C’est très émouvant, un acteur qui fait confiance à un metteur en scène. Je vous jure que c’est un sentiment très fort. Marion, c’est encore plus que de la confiance qu’elle vous offre, c’est carrément de l’abandon. Elle ne vous dit jamais : « Mais pourquoi je ferai ça ? ». C’est d’autant plus impressionnant que, après s’être donnée à ce point, elle reconnecte ensuite immédiatement avec le réel, juste après que vous avez dit : « Coupez ». Ca aussi, pour moi, ça tient du mystère…’’
Ni sainte, ni soumise, sa Gabrielle donne le la à ce film très singulier, très stimulant, qui trouve son souffle romanesque dans les petits yeux humides de Marion. C’est bluffant, une fois de plus.
Novembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Comment des jeunes filles ordinaires sombrent dans la radicalisation ?
LE CIEL ATTENDRA
Film de Marie-Castille MENTION-SCHAAR – 2016
 Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » à sa mère une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Marion, Leïla ou Clara et, comme elles, croiser un jour la route de l’embrigadement....Pourraient-elles en revenir ?
Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » à sa mère une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Marion, Leïla ou Clara et, comme elles, croiser un jour la route de l’embrigadement....Pourraient-elles en revenir ?
Pour être plus proche de la réalité, Marie-Castille Mention-Schaar a fait un véritable travail d’investigation avant de tourner Le ciel attendra. Elle a rencontré plusieurs journalistes, a regardé des vidéos de propagande ‘’d’une violence absolue’’ et a travaillé en collaboration avec le Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l’Islam. Le tournage a commencé trois jours après les attentats du 13 novembre à Paris. Même si la réalisatrice a pensé tout arrêter, son envie de comprendre de tels actes l’a poussée à continuer. Ce film est le parcours d’une combattante. Elle s’est emparée d’une actualité brûlante qui la sidère et qu’elle cherche à comprendre : comment des jeunes filles tout à fait ordinaires peuvent-elles sombrer dans la radicalisation ?
C’est toujours avec tendresse et délicatesse que Marie-Castille Mention Schaar, réalisatrice en 2014 du superbe Les héritiers’, tourne sa caméra vers l’adolescence en perdition. La réalisatrice a privilégié une étude psychologique détaillée. Pour tenter de mettre au jour les rouages du phénomène d’embrigadement qui touche un nombre croissant de jeunes, elle s’est lancée dans un travail d’enquête minutieux. Sur le tournage, elle se fait aider par une jeune femme partie en Syrie rejoindre Daech et qui en est revenue. Dounia Bouzar, créatrice du Centre de Prévention, de Déradicalisation et de Suivi Individuel (CDPSI), qui l’a autorisée à la filmer dans des scènes d’une grande authenticité, qui permettent au spectateur de mesurer l’énergie qu’il faut déployer pour remettre des jeunes sur la voie de la raison ou réconforter des parents désespérés de n’avoir rien vu venir.
En s’appuyant sur un scénario bien construit et sur des situations justes et pour dissiper une croyance trop largement répandue, la réalisatrice répète qu’il n’est pas nécessaire d’être fragilisé ou d’habiter dans des quartiers abandonnés pour tomber dans les griffes des « rabatteurs » de Daech. De manière directe et brutale, le film nous plonge alors dans l’enfer de deux jeunes filles qui semblent ne manquer de rien mais qui, en quête d’absolu et d’idéal amoureux, deviennent des proies faciles pour des personnages peu scrupuleux. Comme on se désintoxique d’une drogue, la première entame un lent chemin vers la guérison, tandis qu’à l’opposé, l’autre s’enfonce inexorablement dans une intoxication définitive.
Sonia, 17 ans, vit au sein d’une famille sans histoires, entre sa petite sœur et ses parents qui ont le sentiment de tout faire pour le bonheur de leurs enfants. Une nuit, la police débarque chez eux. C’est lors de cette arrestation qu’ils apprennent, sans parvenir à y croire vraiment, que leur fille s’apprête à commettre un attentat. S’engage alors un long et douloureux combat contre le désenvoûtement, avec toute la famille (touchante Sandrine Bonnaire en mère compréhensive et désarmée, avec Zinedine Soualem, parfaitement juste en père meurtri et inquiet).
Mélanie a sensiblement le même âge. Elle va au lycée où elle est bonne élève, elle joue du violoncelle et est engagée dans une association humanitaire. Elle vit seule avec sa mère seule (ses parents sont séparés mais son père est présent dans l’adversité), qui tient un petit salon de coiffure. Toutes les deux s’entendent bien, jusqu’au jour où Mélanie commence à se fermer, sans que sa mère n’en comprenne les raisons (crise d’adolescence oblige, pense t-elle). La mort de sa grand-mère, avec qui elle entretenait une réelle complicité, perturbe profondément Mélanie. Sur Facebook, elle accepte alors l’invitation d’un garçon qu’elle ne connaît pas mais qui sait trouver les mots justes dont elle a besoin. Et le piège se referme peu à peu. Grâce à une mise en scène habile, on assiste, médusés et impuissants, à son avancée inexorable vers l’emprisonnement mental.
Parallèlement, on suit le parcours de Sylvie, sa mère (jouée par Clotilde Courau), qui est partagée entre la colère et le désespoir de n’avoir à aucun moment soupçonné les prémices de cette tragédie qui s’abat sur elle. L’intensité du jeu de l’actrice, méconnaissable sous les traits de cette femme au visage marqué et aux yeux d’une tristesse infinie, permettra, sans aucun doute, à toutes les mères d’adhérer à sa détresse. Les regards se tournent aussi vers les deux jeunes actrices, Noémie Merlant (Sonia) et Naomi Amarger (Mélanie). On les avait déjà remarquées dans Les héritiers et elles confirment ici leurs talents en se glissant, avec une aisance bouleversante, dans la peau de ces personnages tourmentés dont elles parviennent parfaitement restituer la sincérité.
Dans un entretien avec Anouk Brissac, pour la revue ‘’Illimité’’ de la firme UGC, Marie-Castille Mention-Schaar s’est exprimé sur son film :
‘’Est-ce parce que le sujet est si brûlant que votre vigilance vis-à-vis de la vérité a été si minutieuse ?
Bien sûr, c’était impensable d’inventer. Le film est une fiction, mais pétrie de réel, où rien n’est faux, où tout est véridique.
Pourquoi Dounia Bouzar joue-t-elle son propre rôle ? Pourquoi ce choix de l’intervention d’un réel ‘’si réel’’ dans la fiction, au risque d’en extraire le spectateur ?
C’est en assistant aux séances que Dounia anime que ce personnage ‘’tiers’’, qui remet les choses dans leur contexte et les décrypte, m’est apparu fondamental. Même une très bonne comédienne ne pourrait pas improviser avec une telle justesse. Dounia réagit de façon instinctive, mais très juste. A la caméra, ça n’a pas de prix, il n’y a pas le mensonge de la réincarnation.
Vous n’avez pas eu peur de vous attaquer au sujet de la radicalisation, si sensible et source de crispation ?
Au contraire. Il faut se détacher de la crispation, ce que je fais en essayant de comprendre le cheminement vers la radicalisation. On a tellement besoin de resserrer les liens les uns avec les autres, c’est affolant cette nécessité. Je vois les réactions du public : il y a un basculement dans leur tête : ils ont vu, identifié, ressenti et compris enfin ce mal invisible. Avoir ce film devant les yeux, même si c’est une fiction, rend cette réalité tangible, réelle. La fiction, paradoxalement, fait exister le réel.. C’est le pouvoir fou de la fiction, qui libère quelque chose de par son essence même. Je n’ai pas fait un film sur l’Etat Islamique, sa propagation, son fonctionnement ; j’ai fait un film centré sur les humains et sur la façon dont ce mal les touche physiquement, émotionnellement et psychologiquement. On est collés à eux, ils mettent des visages et des corps sur un phénomène invisible.
On a le sentiment que votre cinéma est de plus en plus engagé…
C’est vrai et je ne me l’explique pas. Je travaille à la pulsion, à l’instinct. On vit une époque avec ce climat. Cet engagement m’advient malgré moi et je décide de le suivre. C’est lui qui me guide.’’
Les groupes de parole où les adultes expriment leur désarroi, mélange de honte et de désespoir, sont tout aussi poignants que leurs réactions quand ils tentent de communiquer avec leurs filles qui les considèrent comme des ennemis. « Ils s’en veulent de ne pas avoir vu comment leur enfant évoluait », dit la cinéaste. Quant à ces jeunes, ils sont en recherche d’un but, d’un sens à leur vie. La proposition ‘’religieuse’’ qui leur est présentée, détourne leur recherche de la vérité de leur être, détruit les liens qui les ont construits et dénature leur foi dans l’adoration d’une caricature de Dieu. Au-delà de son sujet brûlant d’actualité, Marie-Castille Mention-Schaar signe un film sensible sur l’adolescence et ses fragilités, toujours à juste distance de ses personnages.
Instructif sans être didactique, Le ciel attendra est un film important. Il donne à réfléchir après avoir été pris aux tripes, en abordant de front un sujet délicat et angoissant. On ne saurait trop recommander d’aller le découvrir.
Novembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Ce film égyptien milite pour la liberté d’expression
CLASH
Film de Mohamed DIAB – 2016

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution, par l’armée, du président islamiste Mohamed Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants sont arrêtés par l’armée. Un groupe d’hommes, aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon minuscule, avec une mère de famille infirmière, une jeune fille voilée et son vieux père, un journaliste américano-égyptien et un photographe. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ?...
Après le succès de son premier film les femmes du bus 678 (2012), Mohamed Diab s’intéresse aux évènements violents qui ont suivi la destitution, par la rue, du nouveau président Morsi, membre des Frères Musulmans.
C’est, au sens propre, un film étouffant. On peut le conseiller aux cinéphiles, mais pas aux claustrophobes. Pendant une heure et demie, Mohamed Diab nous enferme dans un fourgon de police, avec une vingtaine de personnes, manifestants ou simples passants, qui brûlent sous l’implacable soleil du Caire, tandis qu’à l’extérieur, des scènes de guerre civile empêchent toute progression dans la ville. La situation est bloquée et absurde. Les policiers en noir finissent par ne plus savoir s’ils doivent résister dehors aux manifestants ou surveiller, à travers les barreaux, les prisonniers qui en viennent aux mains dans ce cachot ambulant. Par peur d’être mêlés aux sanglants combats de rue ou d’être les cibles des snipers, ils finissent par ne plus vouloir sortir.
C’est un concentré explosif de la société égyptienne de l’été 2013, au cours duquel l’armée du général Abdel Fattah al-Sissi a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. Les personnes arrêtées et jetées pêle-mêle dans le fourgon appartiennent à toutes les obédiences, toutes les classes sociales, toutes les générations. Plus le temps passe, plus la chaleur et la colère montent. Entassés, assoiffés, affamés, au bord de l’évanouissement, ces ennemis fratricides que le hasard contraint à cohabiter sont décidément irréconciliables. Trois ans après la révolution, ces fanatiques des deux bords continuent à s’opposer. Le film suffocant et haletant de Mohamed Diab n’est pas anachronique, il est visionnaire. Comme le remarque Jérôme Garcin dans L’Obs : ‘’Entre la loi islamiste et la loi martiale, Mohamed Diab a l’intelligence de ne pas choisir : son film ne milite que pour la liberté d’expression et contre toutes les formes d’oppression. Un film aussi efficace et virtuose dans la mise en scène très théâtrale du huis clos, que dans le découpage très cinématographique, à travers les fenestrons, de la guérilla urbaine. Un film, enfin, où le spectateur étranger, placé contre son gré derrière les barreaux, ne pourra plus dire que c’est loin et que ça ne le concerne pas’’.
C’est un moment crucial pour ce pays divisé en deux, dont ce panier à salades est le témoin. Deux enfants y sont pris au piège avec leurs parents : ils tracent sur une paroi un jeu de morpion qui fait aussi l’affiche du film, ronds contre croix, c’est le clash. Si vous pouvez discutez avec des Égyptiens, ils vous diront que c’est encore le cas. Il faudra un canon à eau pour séparer les prisonniers qui en viennent à s’étriper. Le sang coule. Mais, pris au piège dans la même galère, confrontés aux mêmes tortures, condamnés à se parler, ils devront bien finir par composer. C’est là que la tension du film prend tout son sens : plutôt qu’un film politique, Mohamed Diab nous propose un film humain sur ses compatriotes, qui ont la responsabilité commune de construire leur pays dans la paix.
Mohamed Diab conclut en disant : ‘’Il faut être prudent avec les mots, car l’Egypte est aujourd’hui divisée de façon manichéenne. Par exemple, si vous employez le terme « coup d’état » pour décrire la destitution de Morsi, vous serez immédiatement considéré comme un pro-Frère Musulman. De même, si vous vous y référez en termes de « Révolution », ce mot vous propulsera dans le camp des militaires. Je voudrais que l’on voie mon film sans me demander sans cesse dans quel camp je suis. Ce n’est pas un film sur la politique, c’est un film sur l’humain … Il y a plusieurs choses que je veux dire au peuple égyptien, mais la plus claire c’est que, si on continue comme ça, on ne s’en sortira pas… Je continue à rêver au jour où quelqu’un, issu de la Révolution, qui ne représenterait ni la loi islamiste, ni la loi martiale, pourra gouverner en Egypte.’’
Novembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Ce film chilien est une véritable déclaration d'amour au cinéma, à la vie.
Il est aussi un hymne à la jeunesse qui réveille, et questionne.
POESIA SIN FIN
Film chilien de Alejandro JODOROWSKY – 2016
 Nous sommes au milieu du siècle dernier. « Alejandrito » Jodorowsky quitte, avec ses parents, le petit village chilien de Tocopilla pour la capitale Santiago. Son père, un homme autoritaire, incapable du moindre geste affectueux, rêve de voir son fils devenir médecin et méprise la poésie qu’Alejandro vénère tant. Un beau jour, dans un geste symbolique fort, le jeune homme abat l’arbre familial à coups de hache, envoie paître les siens, et part accomplir sa vocation profonde : celle de poète. Il rencontrera, dès lors, un ‘’supra ténor’’, un ‘’poly peintre’’, un ‘’ultra pianiste’’, des ‘’danseurs symbiotiques’’ ; bref, tout un univers bohème, intellectuel et artistique, qui le conduira à fréquenter de grands noms de la poésie, comme Stella Diaz, Nicanor Parra ou Enrique Lihn. Tous, artistes en action, lui ouvriront l’esprit et jalonneront, chacun à sa manière, son chemin de vie, jusqu’à son départ pour la France (promesse d’un troisième volet réjouissant).
Nous sommes au milieu du siècle dernier. « Alejandrito » Jodorowsky quitte, avec ses parents, le petit village chilien de Tocopilla pour la capitale Santiago. Son père, un homme autoritaire, incapable du moindre geste affectueux, rêve de voir son fils devenir médecin et méprise la poésie qu’Alejandro vénère tant. Un beau jour, dans un geste symbolique fort, le jeune homme abat l’arbre familial à coups de hache, envoie paître les siens, et part accomplir sa vocation profonde : celle de poète. Il rencontrera, dès lors, un ‘’supra ténor’’, un ‘’poly peintre’’, un ‘’ultra pianiste’’, des ‘’danseurs symbiotiques’’ ; bref, tout un univers bohème, intellectuel et artistique, qui le conduira à fréquenter de grands noms de la poésie, comme Stella Diaz, Nicanor Parra ou Enrique Lihn. Tous, artistes en action, lui ouvriront l’esprit et jalonneront, chacun à sa manière, son chemin de vie, jusqu’à son départ pour la France (promesse d’un troisième volet réjouissant).
Poesia sin fin est le 8e long-métrage d’Alejandro Jodorowsky. Le célèbre réalisateur s’est interrogé sur l’utilité de l’art et sa capacité de guérir : ’’Qui guérir ? Principalement, moi. Deuxièmement, ma famille. Et en troisième lieu seulement, le public que je saurai inventer…’’ Son film a pu voir le jour notamment grâce au financement participatif et à la générosité du producteur Michel Seydoux qui n’a pas hésité à faire confiance à son ami de longue date.
Le réalisateur de El Topo et La Montagne sacrée, aujourd’hui âgé de 87 ans, revient sur les traces de sa jeunesse (littéralement, car le film fut tout entier tourné sur les lieux où il a vraiment grandit), et transcende ce récit initiatique pour proposer une belle œuvre qui chante et danse l’amour de la vie et des hommes.
Chaque plan de Poesía sin fin, par ses couleurs chatoyantes et l’inventivité de son orchestration, dégage un élan vital profond. La poésie en question est à comprendre dans son sens étymologique grec, celui d’acte de création, dont le premier consiste ici à marcher d’un pas enjoué (‘’Vamos !’’), puis à traverser la ville en ligne droite, comme le firent Jodo et son ami Enrique Lihn. ‘’La poésie est un acte, une façon de vivre’’, explique le cinéaste.
Au contact des personnages qu’il rencontre, comme ce clochard lui prédisaant : ‘’Une vierge nue illuminera ton chemin avec un papillon ardent’’, ou comme ce public de cirque qui porte son corps nu en triomphe, Jodorowsky grandit, se révèle à lui-même et aux autres, et déploie sa vitalité avec générosité et amour. De la même manière qu’il tente de soigner les individus qui, longtemps, l’ont consulté lors de séances de tarots et de ‘’cabaret mystique’’, il ouvre les consciences et y insuffle son énergie. ‘’La vie est un jeu, il faut rire de tout, même du pire’’, est-il dit dans l’un des dialogues.
Ainsi circule, d’un bout à l’autre de ces deux heures de film, un joyeux chant d’amour, porté par des comédiens toniques (dont les fils Jodorowsky, Adan et Brontis, dans les rôles de Jodo fils, pour le premier, et père pour le second), une équipe technique inventive, et la musique (composée par Adan Jodorowsky). Tout cela est fou, créatif, et amoureux. Il semblerait, en effet, que le cœur de Jodorowsky soit ‘’capable d’aimer le monde entier’’.
Avec Poesia sin fin, Alejandro Jodorowsky nous offre une véritable festival émotionnel qui touche au cœur, dans une oeuvre à nulle autre pareille, imaginative, hallucinée, vibrante d'énergie pure et de joie de vivre, bourrée d'inventions multiples. On pense à Federico Fellini : c'est un spectacle total, une véritable déclaration d'amour au cinéma, à la vie, un hymne à la jeunesse qui réveille, et nous questionne, nous aussi, sur nos rêves et nos aspirations.
Novembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue est vivre dans une prison intérieure
que Stephan Zweig, écrivain autrichien, n'a pas supporté.
STEFAN ZWEIG ADIEU L’EUROPE
Film de Maria SCHRADER – 2016
 En 1936, Stefan Zweig quitte l’Europe pour l’Amérique du Sud. D’abord accueilli à Rio de Janeiro, l’auteur de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme est célébré par la bonne société brésilienne. Mais le romancier, interrogé sur ses positions et son engagement, refuse de se laisser aller aux simplifications. Par ailleurs, fasciné par le Brésil, l’écrivain entreprend l’écriture d’une nouvelle œuvre (Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen). Accompagné par sa nouvelle épouse Lotte, il explore différentes régions du pays.
En 1936, Stefan Zweig quitte l’Europe pour l’Amérique du Sud. D’abord accueilli à Rio de Janeiro, l’auteur de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme est célébré par la bonne société brésilienne. Mais le romancier, interrogé sur ses positions et son engagement, refuse de se laisser aller aux simplifications. Par ailleurs, fasciné par le Brésil, l’écrivain entreprend l’écriture d’une nouvelle œuvre (Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen). Accompagné par sa nouvelle épouse Lotte, il explore différentes régions du pays.
Incarné par l’acteur autrichien Josef Hader, l’écrivain Stefan Zweig est notamment connu pour ses romans La confusion des sentiments, La Pitié dangereuse ou encore Amok. Bouleversé par ce que devient ‘’son’’ Europe qu’il considère comme ‘’l’échec d’une civilisation’’, il décide de la quitter en 1936 pour l’Amérique du Sud, où il écrit, en 1942, une célèbre lettre d’adieu avant de se suicider par empoisonnement.
Fuir la guerre ne l'aura pas épargné : Stefan Zweig finit par quitter la vie en 1942. Maria Schrader retrace ses années d'exil dans un film empreint d'authenticité. Comme le remarque Charlotte Landru-Chandès dans sa critique du Point, le moindre détail du film reconstitue le cadre dans lequel l'écrivain autrichien a vécu ses dernières années. Nous sommes à la fin des années 1930. Même à l'autre bout du monde, le nom de Stefan Zweig est connu de tous. Où qu'il passe, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique latine, des foules d'admirateurs et de journalistes tentent de l'approcher pour le presser de questions. Condamne-t-il l'Allemagne nazie ? Croit-il en une Europe en paix ?
En s'éloignant, il pensait échapper à la guerre, mais il la retrouve à chaque coin de rue. De New York à Petrópolis, les figures du passé accompagnent son chemin. Le spectateur croisera successivement le journaliste Ernst Feder, l'écrivain Thomas Mann ou encore Friderike Zweig, l'ex-femme de Stefan. Joseph Hader jour le rôle de l'écrivain viennois de manière remarquable. Et ce n’est pas seulement une question de moustache. Ses expressions se passent de mots. Il suffit de le voir se prendre la tête entre les mains lors d'une conférence ou tout simplement d'observer son visage agité pour y croire.
Stefan Zweig est-il le véritable héros du film ? Cela reste à nuancer. Si l'Europe est matériellement absente, le spectre du Vieux Continent apparaît au détour de chaque scène. Il hante le regard perdu de l'écrivain et s'impose dans toutes les conversations. Derrière la jungle, ce sont encore les montagnes autrichiennes qui se dessinent en filigrane. Et à travers cet ensemble de cuivres maladroit qui lui joue une aubade, c'est la musique de Strauss que Zweig reconnaît.
Le film renforce le mythe de l'écrivain en exil. Le mot d'apatride y revient constamment. Le Brésil est-il une « terre d'avenir » ? Rien n'est moins sûr. Isolé de ses amis et rongé par la mélancolie, Stefan Zweig cède à ses idées noires. La déroute des Britanniques à Singapour et le bombardement d'un bateau marchand brésilien le conduisent au geste fatal.
L’acteur autrichien Josef Hader incarne avec subtilité ces tourments, alors que le soleil brésilien et les hommages rendus à l’écrivain auraient pu le détourner de la guerre et des fascismes. Auprès de lui, Aenne Schwarz interprète avec une belle présence Lotte, dont la jeunesse n’a pas suffi à contrer le sentiment de fin d’un monde, d’autant qu’un asthme sévère la mettait régulièrement en danger.
L'écrivain s'empoisonne en février 1942, emmenant avec lui son épouse dans la tombe. L'adaptation de cet événement offre au spectateur une très belle scène de cinéma qui termine le film. Les corps des époux, la lettre d'adieu, la douleur des proches… tout se laisse deviner à travers le reflet d'un miroir. Après Vingt-quatre heures de la vie d'une femme, nous voici donc plongés pour deux heures dans la vie d'un homme obsédé par le souvenir de sa patrie.
Voilà une tranche de vie d’un auteur majeur autrichien qui n'a vécu que pour s'exprimer, s'engager dans ses écrits. À cause du nazisme il a dû s'exiler en Amérique, au Brésil, et finalement, il n'est bien nulle part. Malgré l'hospitalité du Brésil, la chaleur des Brésiliens et des Argentins, malgré ses admirateurs, ses confrères en exil, ses femmes, Stefan Zweig vit un double arrachement : à sa patrie et surtout à sa langue. Le film donne à ressentir cet étouffement progressif d’un intellectuel muselé, impuissant, épuisé par l'errance. Et que rien ne console
On fait bien sûr le parallèle avec tous les écrivains persécutés et exilés d'aujourd'hui, qu’ils soient Iraniens, Syriens, Turcs... Ne plus pouvoir s'exprimer dans sa langue, c'est une prison intérieure que S. Zweig n'a pas supporté. Il s’est suicidé par empoisonnement à 60 ans. Au cœur de la riante nature brésilienne. C’est paradoxal et poignant.
Message d’adieu de Stefan Zweig
"Avant de quitter la vie de ma propre volonté et avec ma lucidité, j'éprouve le besoin de remplir un dernier devoir : adresser de profonds remerciements au Brésil, ce merveilleux pays qui m'a procuré, ainsi qu'à mon travail, un repos si amical et si hospitalier. De jour en jour, j'ai appris à l'aimer davantage et nulle part ailleurs je n'aurais préféré édifier une nouvelle existence, maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est détruite elle-même.
Mais à soixante ans passés il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. Et les miennes sont épuisées par les longues années d'errance. Aussi, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde.
Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux."
Stefan Zweig, Pétrópolis, 22-2-42
Récit de la reconquête d’un amour filial
Toni Erdmann
Film de Maren ADE – 2016
 Winfried, un allemand excentrique, s’inquiète de voir sa fille Inès perdre sa joie de vivre depuis qu’elle s’est installée en Roumanie pour travailler dans une grande multinationale. Il débarque à Bucarest sans crier gare et se fait passer pour un client potentiel…
Winfried, un allemand excentrique, s’inquiète de voir sa fille Inès perdre sa joie de vivre depuis qu’elle s’est installée en Roumanie pour travailler dans une grande multinationale. Il débarque à Bucarest sans crier gare et se fait passer pour un client potentiel…
Maren Ade avait déjà été remarquée par The Forest for the Trees (2005) et Everyone Else (2009), respectivement primés aux Festivals de Sundance et de Berlin. Tony Erdmann, ovationné à Cannes, devrait élargir son audience. Ce récit de la reconquête d’un amour filial est un petit bijou d’émotion contenue et de burlesque inattendu. Le film prend son temps avant de dévoiler ses véritables intentions, et une longue exposition décrit le quotidien d’un retraité facétieux, dont l’humour pince-sans-rire contraste avec le ton très policé des membres de sa famille, dont son ex-épouse et sa fille.
Il s’est passé quelque chose de rare, lors de la projection de ce film au dernier Festival de Cannes. La salle des journalistes a applaudi généreusement deux séquences du film. Est-ce l’effet libérateur de voir Inès, femme rigidifiée par son travail, se mettre à chanter The greatest love of all de Whitney Houston devant des inconnus ou bien, plus tard, d’inventer une nouvelle forme de fête d’anniversaire, ou encore de se défaire de sa carapace de cadre irréprochable ? Toni Erdmann, c’est l’histoire de ce père et de sa fille qui se retrouvent et qui s’affrontent.
Winfried, prof de musique à la retraite, passe son temps à faire des blagues plus ou moins bonnes, un papy ébouriffé qui persiste à vivre comme si Mai 68 venait de se produire. A l’inverse, Inès est très en phase avec la génération des années 2010, où tout n’est question que d’efficacité et de résultats ; même sa vie amoureuse ressemble à un business. Ces deux-là vivent chacun dans leur bulle, jusqu’à ce que le père se donne la mission de faite éclater celle de sa fille.
Chez Winfried, le signal de son changement est donné par un dentier en plastique : lorsqu’il le met, avec une improbable moumoute rousse, il devient Toni Erdmann, celui qui met Inès dans l’embarras dès qu’il le peut, d’une réception chez l’ambassadeur allemand à un diner avec ses copines ou avec son supérieur hiérarchique. Inès, en bon petit soldat, ne se laisse pas démonter et se prend au jeu de son père, tout en lui imposant des règles. C’est à peine si on se rend compte comment Toni installe des situations qui pourraient paraître glauques dans un autre contexte.
Quelque chose de nouveau pointe, derrière les éclats de rire, dénonçant l’époque actuelle et sa volonté de compétitivité à tout prix qui a détérioré les rapports humains : ici, une discussion froide entre Inès et l’employé du Spa ; là, une vue du ciel dévoilant la séparation entre une Roumanie embourgeoisée et son quart-monde. En fait, la réalisatrice met en place un second film, plus caché et plus grinçant, dévoilant comment l’humiliation est devenue monnaie courante. Elle prendra même Winfreid/Toni sur le fait quand il devient involontairement responsable du licenciement d’un ouvrier de l’entreprise où travaille Inès : celle-ci dira froidement que son job consiste essentiellement à trouver les moyens de virer les gens.
Alors Toni Erdmann est-il vraiment une comédie de mœurs ? On en est moins sûr au fur et à mesure que le film avance. Le personnage de bouffon qu’invente Winfried devient de plus en plus salutaire et nécessaire pour adoucir un film qui ne parle finalement que de limites de rupture et de dépression nerveuse qui guette. Les rires des spectateurs ne sont peut-être au fond que les signes extérieurs d’une prise de conscience devant ce film qui n’explore pas tant le malaise grandissant d’une femme qui se noie, que la situation d’une Europe qui ne sait plus prendre le recul nécessaire pour éviter d’aller droit dans le mur. Toni Erdmann nous réveillera-t-il à temps ?
Octobre 2016 Jean- Claude Faivre d’Arcier
LA TORTUE ROUGE
Film d’animation de Michael Dudok de Wit – 2016

Un homme, rescapé d’un naufrage, se retrouve seul sur une île tropicale. Après avoir découvert le lieu, le naufragé organise sa survie. Observé par les crabes et se nourrissant de fruits, l’homme apprivoise son environnement. La végétation de l’île lui permet bientôt de se construire un radeau. Mais ses multiples tentatives pour quitter le lieu sont déjouées par une force sous-marine qui s’en prend à son embarcation. L’homme découvre bientôt que l’animal qui détruit son esquif est une tortue à la carapace rouge…
Pour réaliser La tortue rouge, son premier long-métrage, Michael Dudok de Wit a collaboré avec le très prestigieux studio d’animation japonais Ghibbi, fondé par Hayaho Miyazaki et Isao Takahata. Le film ne comporte aucun dialogue et a été conçu grâce à un mélange de numérique et de techniques artisanales. Il a reçu le Prix Spécial ‘’Un Certain Regard’’ lors du festival de Cannes 2016.
Michaël Dudok de Wit a eu un contrôle total sur son film. « J’ai eu des réunions avec Isao Takahata et le producteur Toshio Suzuki, précise-t-il, mais c’était moi qui étais client pour leurs conseils. Eux me disaient toujours qu’il s’agissait de mon film et que je faisais à mon idée. » Ce spécialiste du court-métrage, césarisé en 1996 pour Le moine et le poisson, puis oscarisé en 2000 pour Père et fille, a d’abord eu du mal à se faire au format long. « Déjà parce que je ne dessinais plus moi-même, bien qu’ayant fait de nombreux croquis préparatoires. Ce sont des artistes européens qui ont fait ce travail pour moi. »
La Tortue rouge a été principalement réalisé en France avec le soutien notamment de Vincent Maraval car « les Japonais souhaitaient que j’ai un contact proche de moi », précise le cinéaste. Michaël Dudok de Wit se sent cependant très en phase avec l’esprit du studio Ghibli. « Il n’y a que Takahata-san pour parvenir à faire des haïkus cinématographiques qui disent beaucoup de choses sans être narratifs », avoue-t-il. Son admiration pour le réalisateur du Tombeau des lucioles (1988) et de Mes voisins les Yamada (1999) est réciproque. « La confiance qu’il m’a accordée a été d’un grand soutien pendant les moments de doute. »
Supprimer les dialogues n’était pas un choix économique (afin de mieux distribuer le film à l’international), mais artistique. « Après les avoir beaucoup travaillés avec Pascale Ferran, nous nous sommes rendu compte qu’ils n’étaient pas indispensables », déclare Michaël Dudok de Wit. L’épure semble avoir été la ligne directrice d’un récit simple et envoûtant qui ressemble à aucun autre film d’animation. « Peut-être parce que je pense en prises de vues réelles et que c’est là que se trouvent mes références », insiste le réalisateur. Quelles que soient les influences de son auteur, cette Tortue rouge est une œuvre unique, un bijou.
Somptueuse allégorie de la vie. Douce poésie du temps qui passe et de la transmission. Le cinéaste prodige de l’animation livre enfin son premier long-métrage. Une épopée humaine, où la finesse se mêle à son art de raconter l’universalité.
L’histoire est simple. Un homme, seul rescapé d’un naufrage, échoue sur une île déserte. Une plage. Des rochers. Une forêt de bambous. Des crabes dans le sable. Des poissons dans l’eau. Et puis le miracle du conte. L’homme n’est plus seul et la fable peut décoller. Les fils narratifs des films de Michaël Dudok de Wit sont toujours rudimentaires. Ils se nourrissent de l’altérité et reposent sur le lien profond qui unit l’être humain à l’autre : adulte, enfant (court-métrage Father and Daughter) ou animal (court-métrage Le Moine et le Poisson). Avec toujours, la fantaisie, et une émotion intense, qui déborde de l’écran et reste imprimée dans la mémoire du spectateur. Son passage au long-métrage est éclatant. Mais en douceur. Car le cinéaste néerlandais ne cherche pas l’épate. Son univers repose sur l’art de la délicatesse, de la subtilité, des petits riens qui deviennent immenses. Immenses comme l’universalité qu’il atteint indéniablement. Mais toujours sur le fil. Ses personnages ne parlent pas. Tout est dit dans le trait du dessin, simplissime, dans le mouvement choisi, dans le choix des couleurs, dans les situations et dans l’évolution humaine. Et dans le travail sur le son. Du craquement des pas sur le sable au bruissement des feuilles. L’expérience vécue avec le héros de La Tortue rouge et sa famille naissante se fait en totale immersion pour celui ou celle qui la regarde. L’ampleur domine : ampleur de la mer, de la solitude, de l’isolement, de l’attente, de l’espoir, de la forêt, de l’amour, et des mouvements de nage de la fameuse tortue. Ampleur de la menace aussi, de l’abandon au tsunami. Dudok de Wit revisite l’Éden comme idéal de vie, avec une poésie qui rappelle l’animation japonaise. C’est logique, quand on sait que le fameux Studio Ghibli est producteur de cette aventure, et que le maître Isao Takahata (Le Tombeau des lucioles, Mes voisins les Yamada) en a assuré la direction artistique. On y retrouve ce même esprit du divertissement, en images créées de toutes pièces, et transcendé par l’humanisme et la pensée magique. Car il faut renverser l’adage, et ici ‘’croire pour voir’’.
Pascale Ferran l’a bien compris en rejoignant le projet comme scénariste. Elle qui, dans son dernier opus Bird People, a convoqué la magie en transformant l’humain en oiseau. Ici, la tortue devient femme et peut déjouer le réalisme et la fatalité. La Tortue rouge reste l’un des moments clés de l’édition cannoise 2016, qui a enfin fait la part belle au cinéma d’animation.
Ce film est un modèle de clarté graphique et d'animation lumineuse. Il ne s'y passe rien ou presque, mais c'est toute la vie qui se déroule sous nos yeux avec une fluidité étourdissante. Cette Tortue rouge, maîtresse du silence et de la mer, est une jolie petite perle.
Octobre 2016 Jean- Claude Faivre d’Arcier
Une vision assez réaliste
d'un moment charnière dans la vie de trois cinquantenaires
PARENTHESE
Film de Bernard TANGUY – 2014
 Raphaël paraît avoir tous les symptômes d’une crise de la cinquantaine aiguë. Son ami Alain, plus lucide, est bloqué par des angoisses et des peurs. Quant à Patrick, c’est un éternel adolescent, même s’il prend conscience qu’il arrive au bout de son modèle en vivant à 50 ans dans une chambre de bonne et en continuant à fréquenter des filles de 20 ans. Ensemble, ils décident de partir sur un voilier, afin de retrouver un peu de leur jeunesse perdue. Mais tous se révèlent être de piètres navigateurs. Bloqués entre les îles de Port-Cros et Porquerolles, ils croisent la route de trois jeunes femmes qui finissent par monter à bord du bateau…
Raphaël paraît avoir tous les symptômes d’une crise de la cinquantaine aiguë. Son ami Alain, plus lucide, est bloqué par des angoisses et des peurs. Quant à Patrick, c’est un éternel adolescent, même s’il prend conscience qu’il arrive au bout de son modèle en vivant à 50 ans dans une chambre de bonne et en continuant à fréquenter des filles de 20 ans. Ensemble, ils décident de partir sur un voilier, afin de retrouver un peu de leur jeunesse perdue. Mais tous se révèlent être de piètres navigateurs. Bloqués entre les îles de Port-Cros et Porquerolles, ils croisent la route de trois jeunes femmes qui finissent par monter à bord du bateau…
Parenthèse est le premier long-métrage de Bernard Tanguy, qui a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur. Avant de se lancer concrètement dans la réalisation, il a été producteur et a pris des cours de théâtre. L’un de ses courts-métrages, Je pourrai être votre grand-mère a été nommé aux César et présélectionné pour les Oscars en 2010.
Comme le remarque Jérôme Garcin dans l’Obs, ‘’il s’agit de trois quinquas à la dérive qui embarquent, dans un port de la Côte, sans savoir naviguer, sur un voilier loué et qui draguent des ondines qui pourraient être leurs filles. A vue de nez, ça sentait la daube franchouillarde, la pesante tarte à la crème tropézienne. On craignait même de voir surgir, de la cabine qui prend l’eau, Franck Dubosc en string ou Richard Anconina en débardeur. Mais non ! Il ne s’agit pas du tout de cela...’’
A quoi tient donc, pour son premier long-métrage (précédé, en guise de coup d’essai en 2010, d’un court-métrage très remarqué avec les mêmes acteurs), que Bernard Tanguy évite les écueils et le naufrage ? D’abord à son scénario, qui renverse et affine les clichés sur la crise de la cinquantaine. Ensuite à ses trois personnages, le père de famille (Vincent Winterhalter) fortuné et désabusé, le célibataire hypocondriaque (Gilles Gaston-Dreyfus) et le gratteur de guitare (Eric Viellard) grisonnant et sans le sou : ils brûlent leurs vaisseaux en Méditerranée, mais ne sont jamais dans la caricature épaisse. Enfin, et surtout, aux trois formidables interprètes, avec mention spéciale pour le comédien, dramaturge et binoclard Gilles Gaston-Dreyfus, sorte de Woody Allen français. Et puis il y a dans cette Parenthèse pleine de points de suspension, dans cette comédie sans prétention, tournée caméra à l’épaule, une mélancolie sincère. Et la discrète naissance d’un nouveau genre : le film d’auteur populaire.
Comédie générationnelle, inspirée d'anecdotes glanées de-ci de-là, Parenthèse va dans le sens du vent avec un six comédiens et comédiennes que l'on sent comme en vacances. Le film donne l'impression d'avoir été tourné sur le vif, au fil du temps, presque comme un documentaire, sur un ton de comédie qui fait la différence. Chacun des protagonistes campe des archétypes bien identifiables : Raphaël est l'entrepreneur bling-bling au bord de la séparation, Alain, le célibataire endurci hypocondriaque, et Patrick, l'éternel ado tombeur de ces dames ; Olga (Dinara Droukarova) est une sentimentale russophone libertaire, Alice (Anne Serra) la farouche lesbienne et Vanessa (Sophie Verbeeck), celle qui est à deux doigts de craquer.
Les profils des personnages sont quelque peu attendus, mais le cocktail fonctionne bien, au gré de l’aventure d'un bateau qui vogue en eaux calmes. Car rien ne vient vraiment bousculer le fil du film. Les trois compères, un rien vieux jeu, tombent sous le charme des trois séduisantes jeunes femmes qui font preuve de beaucoup d'indulgence. Et nous avec elles et eux, nous nous laissons, emporter par ce récit nonchalant, plaisant, mais un peu vain.
Portrait d'une génération ? "Parenthèse" n'a pas cette ambition, restant à la surface des eaux mouvementées que peut engendrer la cinquantaine. Tous les acteurs s'en sortent bien, Gilles Gaston-Dreyfus, trop peu employé au cinéma, en tête, et les trois comédiennes dégagent beaucoup de charme et de personnalité. Agréable, le film passe comme une brise d'été, une parenthèse.
Cette parenthèse, qui est un joli coup de fraîcheur dans un été plombant et caniculaire, fait beaucoup de bien. Bien sûr, à cause de la fraîcheur et de la gaîté des jeunes femmes, de leur présence, des jeux sensibles de séduction de l'été, mais aussi des interrogations sur l'âge, sur les différences de génération, qui nous embarquent dans cette histoire. Cela ne tombe ni dans la vulgarité, ni dans la comédie légère, ni dans le drame lourdingue ; on a une vision finalement assez réaliste d'un moment charnière dans la vie de ces trois cinquantenaires. Ce sont bien des questionnements que nous pouvons nous poser. Même si jamais nous ne nous lancerions dans une telle navigation avec trois copains, une émotion particulière nous touche dans ce film que nous sommes amenés à lire au présent. Les jeunes femmes ne sont pas là pour le décor ou pour l’ambiance, il y a une réelle profondeur et une justesse dans les rôles et le jeu de chacune. L'étrangeté de la jeune femme russe apporte une note complexe et multiple qui élargit ce film qui se laisse voir avec bonheur. Un très bon moment, et un film qui nous restera en tête.
Octobre 2016 Jean- Claude Faivre d’Arcier
Hôtel Singapura démontre la vitalité de ce cinéma singapourien
HOTEL SINGAPURA
Film d’Eric KHOO – 2015
 Dans les années 1940, dans la chambre n° 27 de l’hôtel, deux hommes – un Anglais et un Singapourien – se font de poignants adieux au moment de l’invasion japonaise. Puis, un homme élit domicile dans cette même chambre avant de subir une intervention chirurgicale. Un Singapourien célibataire et une Japonaise mariée y vivent un rendez-vous passionné : l’homme veut croire au futur de leur couple, tandis que la femme sait que leur histoire se limite aux murs de cette chambre. Toutes ces histoires sont observées par le fantôme de Damien, un musicien qui hante les lieux depuis qu’il y a trouvé la mort, par overdose d’héroïne…
Dans les années 1940, dans la chambre n° 27 de l’hôtel, deux hommes – un Anglais et un Singapourien – se font de poignants adieux au moment de l’invasion japonaise. Puis, un homme élit domicile dans cette même chambre avant de subir une intervention chirurgicale. Un Singapourien célibataire et une Japonaise mariée y vivent un rendez-vous passionné : l’homme veut croire au futur de leur couple, tandis que la femme sait que leur histoire se limite aux murs de cette chambre. Toutes ces histoires sont observées par le fantôme de Damien, un musicien qui hante les lieux depuis qu’il y a trouvé la mort, par overdose d’héroïne…
Eric Khoo réussit un film à la fois tendre et érotique, sur le désir et sur l’amour, à partir de ces quelques couples qui se succèdent dans la chambre d’hôtel. A partir de ce scénario, il réussit le tour de force de dresser un portrait de son pays, à travers ce jeu des êtres, sensuels et émouvants. Voici ce qu’il dit de son film : ‘’J’ai toujours été fasciné par les chambres d’hôtel et ce qui peut bien se passer derrières leurs portes. Quels secrets renferment-elles ? Qui les occupe ? Quelle est leur histoire ?’’. Tout le film se passe dans le huis-clos de cette chambre n° 27.
A travers les changements de décors, nous partageons la vie privée des occupants, depuis l’apogée de l’Hôtel dans les années 1940 jusqu’à l’époque récente de sa décrépitude. Chaque histoire marque le passage d’une nouvelle décennie, identifiable par le décor de la chambre et par l’univers musical qui environne la scène.
Le film démarre alors que les forces japonaises s’apprêtent à envahir Singapour. En déroulant le temps, nous éprouvons la violence des années 50, puis l’euphorie des années 60, tout en observant l’évolution des rapports sociaux et le changement des comportements sexuels. Dans les années 90, l’Hôtel Singapura est devenu un motel, un repaire pour les âmes échouées sur la route. Dans chaque histoire, le sexe est l’élément commun révélateur, qui permet de connaître intimement chaque protagoniste. Si les murs pouvaient parler, ce serait leurs histoires qu’elles raconteraient. Imrah en est le témoin en voyant l’état de la chambre qu’elle vient nettoyer après leurs passages.
Curieux film que cette balade mélancolique dans le temps, mais qui se déroule dans un lieu unique, la chambre 27 de l’hôtel Singapura ; des couples s’y succèdent, font l’amour ou en parlent, sans qu’on se défasse d’un sentiment de tristesse, exprimé par la voix de Damien qui parle de la dégradation de l’édifice. Damien, c’est le personnage récurrent : mort d’une overdose dans la chambre, il réapparaît à chaque fin de scène pour assurer la transition entre elles. En tant que fantôme, il a tout pouvoir : faire couler un robinet ou épanouir une jeune fille frigide, par exemple ; mais sa qualité essentielle est une infinie compassion qu’il exprime par des regards très doux, sur des personnages qui ne sont pas forcément agréables ni fascinants. Surtout, il est resté amoureux de la jeune femme de chambre, Imrah, qu’il croise pour son premier jour de travail (à elle) et pour le dernier jour de vie (à lui). La fin les réunit en un épilogue aussi étrange que vaguement futuriste.
D’une certaine manière, Hôtel Singapura est une gageure : pendant une heure et demie, on ne quittera pas cette chambre et, un peu à la manière de Georges Perec dans son roman Vie, mode d’emploi, il s’agit d’épuiser un lieu et les histoires qu’il contient. Un immeuble chez l’écrivain, une chambre chez le cinéaste ; le pari est que chaque couple porte une histoire intéressante, que l’on peut raconter dans un temps plus ou moins court. Mis bout à bout, ces destins dessinent une image de la vie, foisonnante et multiple, mais limitée aux sentiments de base et au désir. Eric Khoo s’attarde surtout sur les corps qu’il filme amoureusement, qu’ils se frôlent, se caressent ou fassent l’amour. Ce sont des corps plutôt jeunes et séduisants, comme si seul l’âge des possibles l’intéressait. Il sait également cadrer ses personnages en gros plans et obtenir une certaine émotion, au contrairement à la mort d’Imrah, complètement dédramatisée.
Hôtel Singapura démontre la vitalité de ce cinéma venu d’un pays du bout du monde que l’on peine à situer sur la carte, et dont on ne connaît pas l’histoire. Au fil des ans, Eric Khoo se révèle comme le chef de file du nouveau cinéma singapourien, avec My Magic (2008), où son excellent film d’animation Tatsumi (2011). S’attarder avec lui dans la chambre 27 est un moment de découverte, une leçon de cinéma et de poésie, légère et profonde à la fois.
Octobre 2016 Jean- Claude Faivre d’Arcier
CARMINA y Amén
Film de Paco LEON – 2014
 Antonio, le mari de Carmina, meurt subitement dans son salon. Sous le choc, la Sévillane demande à Maria, sa fille, de la rejoindre au plus vite. Devant elle, elle réalise que la prochaine mensualité de la retraite de son époux doit arriver deux jours plus tard. Elle décide alors de cacher le décès pour pouvoir profiter de la pension. Elle demande donc à Maria, choquée, de tenir sa langue. Les deux femmes doivent non seulement cacher le corps, mais aussi expliquer l’absence soudaine d’Antonio. Mais dans le quartier où vit Carmina, la discrétion et la pudeur ne sont pas des qualités très répandues. Tout risque de se savoir très rapidement…
Antonio, le mari de Carmina, meurt subitement dans son salon. Sous le choc, la Sévillane demande à Maria, sa fille, de la rejoindre au plus vite. Devant elle, elle réalise que la prochaine mensualité de la retraite de son époux doit arriver deux jours plus tard. Elle décide alors de cacher le décès pour pouvoir profiter de la pension. Elle demande donc à Maria, choquée, de tenir sa langue. Les deux femmes doivent non seulement cacher le corps, mais aussi expliquer l’absence soudaine d’Antonio. Mais dans le quartier où vit Carmina, la discrétion et la pudeur ne sont pas des qualités très répandues. Tout risque de se savoir très rapidement…
Pour son premier long métrage en tant que réalisateur, Paco Leon a dirigé sa mère (Carmina Barrios) et sa sœur (Maria Leon). Si celle-ci est une actrice professionnelle très reconnue en Espagne, sa mère est une illustre inconnue qui s’est essayée au cinéma par pur hasard : ‘Elle n’avait jamais tourné auparavant, raconte son fils, et c’est à 58 ans qu’elle a trouvé sa vocation ! A présent, elle est une star en Espagne’. Le personnage d’Antonio est joué par Paco Pasaus.
En Espagne, à côté des maîtres de la comédie que sont Pedro Almodóvar et Alex de La Iglesia, quelques jeunes pousses, comme Paco León, commencent à sortir du lot à leurs côtés. En effet, avec sa première sortie française, le jeune réalisateur nous livre ici une comédie estivale, intelligente et drôle, avec un humour noir tout à fait glaçant à côté duquel il serait dommage de passer.
Carmina !, c’est en réalité le deuxième volet d’un diptyque commencé par un premier film, Carmina o revienta, en 2012, qui n’est malheureusement pas parvenu à sortir sur nos écrans. Ce deuxième chapitre, quant à lui, est parvenu à ravir des prix dans plusieurs festivals hexagonaux, dont le Prix du Public au Festival du Cinéma Espagnol de Toulouse, Cinespaña.
Carmina tente de faire vivre sa famille, entre la mort de son époux et des finances en berne, dans une société espagnole minée par la crise. Ce quasi huis clos, au cœur de son appartement, est l’occasion d’une vision déjantée des relations humaines, tant familiales qu’amicales ou amoureuses.
Cette histoire ne manque pas totalement de potentiel. Dans un premier temps, on est tenté de croire que le dispositif choisi par le réalisateur lui permettra de jouer avec ses personnages en explorant leurs tréfonds. Constamment sous-éclairées, les scènes de Carmina sont dépourvues du moindre éclat. Cette ambiance mortuaire (volets fermés, peu de plans vers l’extérieur) donne à l’appartement des allures de caveau et aurait pu nous rendre prisonnier du caractère morbide des personnages, qui croient que le fantôme du mari décédé rôde dans la pièce pour régler ses comptes. Mais plutôt que d’explorer cette dimension mystérieuse, le réalisateur a préféré jouer sur une dynamique d’opposition : au drame familial s’oppose le mysticisme de pacotille du voisinage, tandis que se dessine pour Carmina une fin plus prématurée, elle qui entendait goûter enfin à la liberté et l’indépendance.
Personnellement, j’ai apprécié l'originalité de ce film et surtout l'actrice qui joue à merveille Carmina, la mère qui décide de tout, qui gère tout pour une fin à laquelle on ne s'attend pas ; elle fait preuve de beaucoup d’à-propos pour parvenir à ses fins, pleine de vie et de force pour garder, de son mari décédé, la prime. Pour cela, elle s’y entend pour manipuler son entourage. Un bon moment avec ce film que je vous recommande.
Septembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
COLONIA
Film de Florian GALLENBERGER – 2015
Une romance amoureuse au cœur d’un enfer régressif
 Chili, 1973. Le Général Pinochet s’empare du pouvoir par la force. Les opposants au coup d’Etat descendent dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel photographe (Daniel Brühl) et son amie Lena (Emma Watson). Daniel est arrêté par la nouvelle police politique. Il est conduit dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d’une secte dirigée par un ancien nazi. Une prison dont peu de personnes sont sorties. Pour retrouver son amant, Lena va pourtant rentrer dans la ‘Colonia Dignidad’. Pour être fidèle à l’histoire vraie de la secte de Paul Shäffer, Florian Gallenberger s’est rendu dans la ‘’Colonia Dignidad’’, fondée en 1961 : ‘J’ai vu les souterrains, les endroits où les prisonniers politiques étaient torturés… J’ai marché dans les couloirs tristement célèbres de l’hôpital et j’ai parlé aux victimes…’ Le film a été tourné, à la fois au Chili, en Argentine, au Luxembourg et en Allemagne.
Chili, 1973. Le Général Pinochet s’empare du pouvoir par la force. Les opposants au coup d’Etat descendent dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel photographe (Daniel Brühl) et son amie Lena (Emma Watson). Daniel est arrêté par la nouvelle police politique. Il est conduit dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d’une secte dirigée par un ancien nazi. Une prison dont peu de personnes sont sorties. Pour retrouver son amant, Lena va pourtant rentrer dans la ‘Colonia Dignidad’. Pour être fidèle à l’histoire vraie de la secte de Paul Shäffer, Florian Gallenberger s’est rendu dans la ‘’Colonia Dignidad’’, fondée en 1961 : ‘J’ai vu les souterrains, les endroits où les prisonniers politiques étaient torturés… J’ai marché dans les couloirs tristement célèbres de l’hôpital et j’ai parlé aux victimes…’ Le film a été tourné, à la fois au Chili, en Argentine, au Luxembourg et en Allemagne.
Si ces deux amants sont une pure fiction, ce micro-Etat totalitaire régi par les mécanismes de la peur a bel et bien existé pendant près de 40 ans. Et c’est là l’un des atouts majeurs de ce long-métrage : s’appuyer sur une réalité glaçante que le spectateur découvre avec stupeur. De ce postulat historique, Florian Gallenberger tire un suspense très efficace : la tension est constante et atteint son paroxysme dans les scènes de face-à-face entre Emma Watson, irréprochable en amoureuse courageuse, et Michael Nyqvist, terrifiant en leader sadique et pédophile de la Colonia. Daniel Brühl, inoubliable héros de Good Bye Lenin, de W. Becker en 2002 et chouchou allemand des productions internationales (Rush de Ron Howards en 2013, Inglourious basterds de Quentin Tarentino en 2009, et La vengeance dans la peau de Paul Greengrass en 2007), est un cran en dessous de ses partenaires mais rien qui ne justifie la punition infligée jusqu’à présent au box-office à ce thriller historique de facture très honnête. Ce dernier long-métrage d’Emma Watson, lors du premier jour de sa sortie au Royaume-Uni, a été un échec commercial. En cause : une exploitation dans trois salles seulement, provoquée par la diffusion simultanée du film sur les plateformes de vidéo à la demande. Emma Watson, habituée aux cimes du box-office grâce à la saga Harry Potter, n’avait jamais connu un tel bide. C’est d’autant plus regrettable que le film mérite vraiment le détour !
Colonia est moins le récit d’un drame de guerre qu’un thriller qui décrit les exactions nihilistes d’une secte, Colonia est pourtant un film d’aventure plus romanesque que ténébreux. De par sa réalisation, le scénario et le choix des acteurs prestigieux, Florian Gallenberger (John Rabe, le juste de Nankin) présente une romance amoureuse au cœur d’un enfer régressif dans lequel un photographe arrêté par le nouvel état dictatorial chilien se voit plonger, avant d’y être rejoint par sa compagne, qui abandonne tout, notamment sa liberté, pour retrouver celui qu’elle aime. Le cinéaste suggère beaucoup, s’intéressant moins à sonder les racines du mal qu’à décrire la flamme romantique de ce combat contre la corruption d’une démocratie évanouie. S’intéressant davantage aux exploits et à l’abnégation de l’héroïne plutôt qu’à la réalité historique des événements, Gallenberger choisit l’efficacité du divertissement plutôt que la description approfondie des faits historiques qui auraient donné au film davantage d’intérêt.
En effet, qu’est-ce que ce Chili où tout le monde parle anglais? Qu’apporte cette peinture aussi vague que légère du tragique contexte politique de cette époque ? Daniel Brühl y paraît terne et Emma Watson garde un teint éclatant malgré les mauvais traitements qu’elle subi… L’histoire, au lieu d’être mise en perspective par la fiction, est ici reléguée au dernier plan. En fait de contexte, le Chili se trouve réduit à un prétexte dramatique.
Oui, les ficelles sont un peu grosses, mais la mise en scène est intéressante et la photographie très belle, le jeu des acteurs en harmonie avec l'histoire des années 70, ainsi que les décors, les costumes, les musiques (Carlos Santana). Je crois qu'une des clés du film est Emma Watson qui devrait attirer un public nombreux ; elle est d'ailleurs excellente et très intuitive... Alors si vous voulez allier un film grand public et la découverte d’un épisode méconnu de l'histoire du Chili, il serait dommage de passer à côté de ce film qui reste très intéressant durant toute sa durée.
Septembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
A TOUS LES VENTS DU CIEL
Film de Christophe LIOUD – 2016
Le metteur en scène la culpabilité liée à la mort de ses parents
et sa quête de liberté de Claire
 Claire a 17 ans. Avec les siens, elle passe ses vacances en Afrique du Sud lorsque sa famille disparaît dans un accident. Par un coup du sort, elle échappe au drame. En plein désarroi, persuadée d’être responsable de la mort des siens et assommée par la culpabilité, elle s’enfuit et décide que le hasard, par lequel elle a survécu, guidera désormais sa vie. Désormais, elle s’en remet au sort des dés pour guider sa vie. Au fil de ses aventures et de ses rencontres, heureuses ou tragiques, elle brûle les étapes de la vie et découvre qu’elle porte en elle la force de créer son destin.
Claire a 17 ans. Avec les siens, elle passe ses vacances en Afrique du Sud lorsque sa famille disparaît dans un accident. Par un coup du sort, elle échappe au drame. En plein désarroi, persuadée d’être responsable de la mort des siens et assommée par la culpabilité, elle s’enfuit et décide que le hasard, par lequel elle a survécu, guidera désormais sa vie. Désormais, elle s’en remet au sort des dés pour guider sa vie. Au fil de ses aventures et de ses rencontres, heureuses ou tragiques, elle brûle les étapes de la vie et découvre qu’elle porte en elle la force de créer son destin.
À tous les vents du ciel est le premier long-métrage de Christophe Lioud. Le cinéaste a notamment été le producteur de La Marche de l'empereur, J'irai dormir à Hollywood et le récent C'est quoi cette famille ? ! Il expose ainsi son projet :"Après plus de vingt ans passés dans la production, j’ai souhaité revenir à mes premières amours et repasser à la réalisation. J’avais tourné des choses très variées et j’ai eu envie de me lancer dans un premier long métrage de fiction avec le désir d’aborder un certain nombre de thèmes qui me touchaient : la culpabilité liée à la mort d’un proche (qu’il a vécue au moment du décès de sa sœur), la quête de liberté… Le livre de Jean-Baptiste Destremau, Si par hasard, dont un ami m’avait conseillé la lecture, m’a plu car il contenait tous ces motifs". Ce roman a servi de trame au scénario du film. Ch. Lioud situe l’histoire non plus aux USA mais en Afrique du Sud et offre des paysages exceptionnels, comme la Grande Arche de Céderberg où Claire renonce à mettre fin à sa vie.
Noémie Merlant incarne Claire, le personnage principal de À tous les vents du ciel. Bien qu'elle soit âgée de 27 ans, elle joue le rôle d’une jeune fille de 17 ans. L'incandescente actrice ne se contente pas seulement de jouer la comédie, elle est également une chanteuse accomplie. En effet, c'est elle qui interprète la chanson "Fate", tirée de la bande-originale du long-métrage. La jeune femme avait été révélée en 2014 dans le film Les Héritiers, série danoise écrite par Maya Isloe.
Trichant sur son nom et son âge, elle enchaîne les rencontres, mauvaises ou bonnes, dans un pays qu’elle ne connaît pas et elle s’interroge : Doit-elle payer de sa vie la faute d’avoir survécu ? Peut-elle accepter l’amour d’un homme qui ignore tout d’elle, jusqu’à son prénom et son âge ?... Sur la Toile, elle découvre qu’on la recherche. Sa meilleure amie poste sur un blog des vidéos où elle lui demande de revenir, tout comme sa grand-mère (magnifique Marie-Christine Barrault) dont Claire a toujours été très proche.
Porté par le jeu subtil de Noémie Merlant, A tous les vents du ciel, « drame optimiste » comme le définit son réalisateur, se révèle une sorte de pèlerinage initiatique d’une grande force et d’une émouvante justesse, à travers le portrait bouleversant de cette jeune fille, à peine sortie de l’adolescence, qui tente de dominer ses émotions pour traverser le drame. Dans ce terrible chemin du deuil, Claire devra apprendre à faire face à la perte des êtres aimés et à comprendre la valeur de sa vie préservée.
J'avais adoré le roman et le film ne m'a pas déçu ! L'actrice principale Noémie Merlant déploie une large palette dans son jeu : d’abord ado boudeuse, puis jeune femme successivement atterrée, désespérée, tentée, amoureuse, lumineuse… Les paysages d’Afrique du Sud sont superbes ; les personnages de la grand mère et de l'amie restées en France sont très attachants. Je suis allé voir ce film avec un peu d'hésitation compte tenu des critiques (que je ne comprends pas a posteriori) Le film est excellent : il nous donne un enseignement magnifique sur le deuil, le déni, la culpabilité et l'insouciance de la jeunesse, teintée souvent d’une grande maturité. Le film est très émouvant pour plusieurs raisons : L'actrice (Noémie Merlant) joue très juste et rend son personnage attachant, malgré quelques invraisemblances du scénario. Elle fait, tour à tour, pleurer, sourire et vivre. Le scénario est assez bien ficelé et accompagne le cheminement intérieur de la jeune actrice avec émotion. Le livre dont le film est adapté est incroyable et le film aussi ! Je vous conseille vivement d'aller le voir vous ne le regretterez pas... surtout si vous prenez le temps de lire aussi le roman de Jean-Baptiste Destremau.
Septembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
BLACK STONE
Film de Roh GYEONG-TAE – 2015
. « Mon intention était de créer un poème visuel et nostalgique sur la nature en danger. »
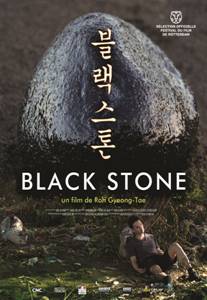 Les parents adoptifs de Shon Sun ont quitté, depuis longtemps, la jungle et leur village de pêcheurs pour aller travailler à Séoul dans une usine illégale de fabrication de nourriture animale. Contraint d’effectuer son service militaire, Shon Sun subit de mauvais traitements, en particulier de la part du lieutenant Ko Ah-Shen qui le viole et lui transmet le SIDA. Il est obligé de quitter l’armée et s’enfuit, clandestin, en direction de son village d’origine. De retour à Séoul, il s’aperçoit que ses parents ont disparu. Bien décidé à les retrouver, il entame alors tout un périple à travers la jungle polluée, vers le village d’où son père est originaire…
Les parents adoptifs de Shon Sun ont quitté, depuis longtemps, la jungle et leur village de pêcheurs pour aller travailler à Séoul dans une usine illégale de fabrication de nourriture animale. Contraint d’effectuer son service militaire, Shon Sun subit de mauvais traitements, en particulier de la part du lieutenant Ko Ah-Shen qui le viole et lui transmet le SIDA. Il est obligé de quitter l’armée et s’enfuit, clandestin, en direction de son village d’origine. De retour à Séoul, il s’aperçoit que ses parents ont disparu. Bien décidé à les retrouver, il entame alors tout un périple à travers la jungle polluée, vers le village d’où son père est originaire…
Avec Black Stone (La pierre noire), le réalisateur conclut la trilogie qu’il a commencée avec Land of Scrarecrows (Terre d’épouvantails, 2009) et Black Dove (Pigeon noir, 2011). Très préoccupé par l’écologie et la façon inconsidérée dont l’être humain saccage la nature, il explique sa démarche : ‘’ Les humains polluent l’environnement afin d’étendre leur civilisation, et cet environnement pollué nous retransmet à son tour sa douleur. Dans un monde où le capitalisme matérialiste étend de plus en plus son emprise, l’humanité est menacée de contamination mentale et physique. Mon intention était de créer un poème visuel et nostalgique sur la nature en danger, tout en faisant des recherches sur les idéaux des sociétés primitives retrouvés dans le socialisme.
En travaillant sur ce dernier volet de ma trilogie sur la pollution environnementale, je me suis inspiré du cinéma de Robert Bresson et d’Apichatpong Weerasethakul, talentueux cinéaste thaiïlandais, en créant des images symboliques et contemplatives plutôt qu’un récit classique. A la surface, le film semble être un simple ‘’road movie’’ à propos de Shon Sun, un sang mêlé, un métis qui quitte la ville pour se rendre dans un village tropical afin de trouver des réponses sur la disparition de son père. Mais le récit se fond peu à peu dans des images symbolique sur la pollution et la nostalgie’’.
Black Stone raconte l’histoire d’une quête initiatique sur un fond de thèmes qui sont encore tabous dans la société coréenne :
*L’identité ethnique coréenne, farouchement défendue et érigée en symbole d’unité nationale : le peuple coréen ne serait ‘’qu’un’’ et tout ce qui ne serait pas coréen (on a envie de dire ‘’de souche’’) serait donc à rejeter. Cette crispation identitaire a son origine dans le lourd passé d’occupations et de colonisations étrangères subies par les habitants de la péninsule coréenne au cours des siècles.
*L’adoption : Ce sujet demeure une épine douloureuse dans la société coréenne, car il met l’accent sur l’incapacité des Coréens à regarder en face leurs problèmes et les origines de ceux-ci. Il y a eu des guerres, des famines, des relations illégitimes, des naissances hors mariage, une natalité non contrôlée qui a fait exploser le nombre des abandons d’enfants, et donc le nombre d’orphelins à adopter (plus de 200.000 enfants coréens furent adoptés un peu partout dans le monde). Autant pour les parents adoptifs que pour les enfants adoptés, il est difficile de s’intégrer dans la société lorsque la filiation ne se fait pas par les liens du sang.
*L’armée est un passage obligatoire dans la vie d’un jeune homme. Il ne peut y échapper et subit, pendant près de 2 ans, une série d’humiliations et d’exactions plus ou moins violentes. Pour beaucoup de jeunes, c’est une période traumatisante à cause des mauvais traitements subis. Elle explique en partie le taux de suicides en Corée, qui est le plus important de tous les pays de l’OCDE.
*La mentalité insulaire : Bien que la Corée du Sud soit une péninsule rattachée au continent, la zone démilitarisée, partagée avec la Corée du Nord et ses frontières littorales, isolent les sud-coréens du reste du monde, leur permettant ainsi de se considérer comme des îliens à part entière. Ce pays, resté ‘’ermite’’ pendant de nombreux siècles, fut découvert par des missionnaires étrangers qui manquèrent de se faire séquestrer et massacrer par ce peuple insulaire et uni. L’unité du peuple est aujourd’hui toujours présente (une langue, une monnaie, une culture, un pays = une île) et continue à donner lieu à des luttes diplomatiques tendues dans les eaux territoriales avec le Japon (Cf. L’île Dokdo). En un mot, les îles sont très importantes dans l’imaginaire collectif coréen, elles sont un motif récurrent chez le réalisateur : lieu de retraite, loin de la ville et des menaces, elles sont un havre de paix, mais saccagé par la pollution.
*Mais le sujet qui tient le plus à cœur à Roh Gyeong-Tae est l’écologie et la façon dont l’être humain détruit son environnement. Black Stone se réfère au naufrage du ‘’Hebei Spirit’’ en 2007, non loin du pont de Daeson sur la Mer Jaune, le long de la côte de Mallipo. Le pays dût alors mobiliser des centaines de milliers de personnes (militaires, scientifiques, bénévoles…) pour récupérer les 10.500 tonnes de fuel échappé du cargo et polluant les plus belles côtes sud-coréennes, où de nombreux oiseaux migrateurs venaient nicher. Cette catastrophe coûta plus de 300 milliards de Wan (233 millions d’euros) à l’Etat et nécessita la mobilisation de plus de 20.000 personnes pendant 2 mois pour nettoyer les côtes. Ce fut le pire désastre écologique que connut la Corée du Sud.
Tous ces sujets apparaissent comme des motifs récurrents dans la filmographie du réalisateur.
Voici donc un long métrage qui sort des sentiers battus ; à la fois drame d’une extraordinaire noirceur et improbable féerie, qui prend le spectateur à témoin sans pourtant le captiver totalement. Black Stone est un film étrange et obscur, mélangé de registres différents et, ce qui en fait sa qualité principale, suffisamment surprenant pour intéresser dans sa totalité. Nettement scindé en deux parties, il présente un itinéraire initiatique, qui part de l’ombre pour aller vers la lumière, du réel vers le surnaturel, en un chemin austère : plans longs et silencieux, ellipses, quasi-absence de musique … On est bien dans une œuvre d’auteur qui refuse les facilités. De même le jeu des acteurs est singulièrement intérieur, à la limite de l’ascétisme : c’est que le cinéaste refuse la psychologie facile et l’explication, centré sur son regard précis d’entomologiste. Le comportement est privilégié par rapport au dialogue et il revient au spectateur de faire des liens, de combler les vides et de laisser libre cours à son imagination.
Dépassant l’itinéraire spirituel et matériel du personnage central, on peut voir Black Stone comme un film post-apocalyptique : le film commence après la fin du monde, blessé par une perte d’humanité, où le profit est devenu la seule valeur, mais qui est aussi défiguré par la pollution et l’environnement misérable. Roh Gyeong-Tae décrit un univers fantomatique où les êtres parlent peu et sont réduits à l’obéissance et aux fonctions essentielles. De ce constat désespéré, il tire une conclusion logique : fuyant une société épuisée, devenue incapable de sentiments, il faut partir. Le père, puis Shon, reviennent donc à la mer originelle et entreprennent une initiation au monde d’avant, lavant, en même temps que les pierres salies de fuel, leurs fautes passées, retrouvant ainsi une sorte d’Éden loin de la civilisation. En extrapolant, on pourrait lire le film comme une parabole sur notre situation présente et sur les solutions que nous cherchons pour y échapper. Certes la solution proposée, ‘’cultiver son jardin’’ comme le souhaitait Voltaire, peut paraître un peu courte, même quand elle s’accompagne d’une spiritualité, étrangère à notre culture occidentale. Reste que le cinéaste n’a pas choisi la facilité de s’enfermer dans le noir et le dramatique : il change de cap, et, tout en gardant une cohérence de style, prend le contre-pied de son propos initial. En cela, il réussit un film étrange, mélange de tragique et de naïf, qui s’écarte des modes pour offrir un itinéraire intérieur passionnant mais souvent déroutant.
Septembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
La forêt de Quinconces
Film de Grégoire LEPRINCE-RINGUET – 2016
Une fable enfiévrée, bizarroïde et sensuelle sur l’amour
 Paul (Grégoire LR) et Ondine (Amandine Truffy) ont vécu quelques années ensemble mais la jeune femme n'en peut plus. Alors qu'elle court dans un parc avec lui, elle décide de le quitter. Profondément blessé, il refuse de se laisser aller au désespoir. Par vengeance, il décide de multiplier les conquêtes. Dans le métro, il jette son dévolu sur la jolie Camille (Pauline Caupenne). Il la charme, elle se laisse faire. Mais Paul est envoûté par Camille qui cherche un amour exclusif. C'est alors qu’Ondine revient vers Paul, regrettant finalement d'avoir quitté le jeune homme. Paul est désormais partagé entre la promesse d'une nouvelle relation et le souvenir d'une histoire terminée ...
Paul (Grégoire LR) et Ondine (Amandine Truffy) ont vécu quelques années ensemble mais la jeune femme n'en peut plus. Alors qu'elle court dans un parc avec lui, elle décide de le quitter. Profondément blessé, il refuse de se laisser aller au désespoir. Par vengeance, il décide de multiplier les conquêtes. Dans le métro, il jette son dévolu sur la jolie Camille (Pauline Caupenne). Il la charme, elle se laisse faire. Mais Paul est envoûté par Camille qui cherche un amour exclusif. C'est alors qu’Ondine revient vers Paul, regrettant finalement d'avoir quitté le jeune homme. Paul est désormais partagé entre la promesse d'une nouvelle relation et le souvenir d'une histoire terminée ...
Romantiques des deux sexes et même du troisième, accourez ! Allez voir ce film en vers, délicieusement audacieux, délicatement ébouriffant, qui raconte une histoire d'amour consumée dans les sortilèges de la passion. Parce qu'il l'a maladroitement fait tomber et qu'elle se retrouve écorchée aux coudes, aux genoux et au cœur, Ondine décide de quitter Paul. Dépité, ce dernier séduit une inconnue et lui fait subir les tourments de sa vengeance... Rien à voir avec du théâtre filmé ! La Forêt de Quinconces ; ce titre trouve son explication dans le décor naturel : le quinconce est un mode de plantation forestier, géométrique, qui ouvre un nombre important de lignes de fuites ou de chemins à prendre. Soit une multitude de destins qui s'offrent au héros... La route que prend Grégoire Leprince-Ringuet n’est pas droite ; elle évolue au gré de ce conte romantique, écrit pour partie en vers. Une fable enfiévrée, bizarroïde et sensuelle, habitée par l'engagement sans faille, la jeunesse et le charme de ses interprètes. C’est un beau spectacle de cinéma, sans la moindre pédanterie et que le rythme des vers, dilué dans un profond naturel, rend totalement envoûtant. Pauline Caupenne et Amandine Truffy sont éblouissantes. Quant à Grégoire Leprince-Ringuet, qui n’a que 28 ans, il sait où il va. Il sait, par exemple, qu’il veut être réalisateur depuis qu’il a 14 ans, quand il avait tourné avec André Téchiné dans Les Égarés. Il propose aujourd’hui un premier long métrage écrit en vers qui a de quoi intriguer. ‘’Ondine et Paul se sont aimés. Quand elle le quitte, il jure qu'il n'aimera plus. Pour se le prouver, il compte séduire la belle Camille, puis la délaisser. Mais Camille envoûte Paul...’’ Nous voilà en plein drame amoureux entre jeunes gens passionnés et lyriques. L’auteur a réuni quelques uns de ses poèmes et en a fait une histoire d’amour. Il aime la contrainte des rimes et de la métrique, qu’il juge « libératrice ». Le cinéma se met ainsi au service de la poésie et du théâtre. Les acteurs déclament les vers avec un naturel qu’on leur envie. Les mots coulent, se transforment en musique. Et nous voilà entraînés dans un ballet sensible et unique.
Amour, romantisme, rêve, c'est bien ce qui parcourt le premier film de Grégoire Leprince-Ringuet, La forêt de Quinconces. Des jeunes gens qui se désaiment, se vengent, subissent des sortilèges et sont hantés par leurs sentiments. Des tirades qu'on croirait tirées d'une pièce de Musset ou d'un poème de Valéry. Des joutes de langage et des élans de passion dans un Paris où un clochard parle comme un devin, où on se faufile sur les toits et où un hangar devient une scène sur laquelle danser. L'univers de Grégoire Leprince-Ringuet est très loin du réalisme français, résolument tourné du côté de l'onirisme et du théâtre, à cheval entre la prose et les vers, entre le jour et la nuit, la violence et la naïveté. Il s'en dégage une fraîcheur peu habituelle, quelque que chose qui sent l'artifice, les coulisses, le plateau, mais qui fait le charme du film pour peu qu’on se laisse porter par la poésie qu’il exprime.
Le film n'est jamais banal. Il respire tout entier de son inspiration poétique et propose de multiples interprétations. Dans les blessures provoquées par la chute d'Ondine, ou par le couteau griffant la joue de Camille et d'où s'écoule une goutte de sang libératrice, ne peut-on pas voir des ouvertures sur le mystère des êtres et des cœurs insondables qui y palpitent ? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce film gagnera à être revu autant de fois qu'on le voudra. Semblable aux meilleurs recueils de poésies qu'on peut lire et relire tout au long de sa vie sans jamais en épuiser la substance, La Forêt de Quinconces fait partie de ces films qu'on n'a jamais fini de découvrir et qui ne cessent de surprendre parce qu'ils ne se donnent jamais tout entier au premier regard. Et ces films-là sont les meilleurs de tous.
Septembre 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
VOIX OFF (Voz en off)
Film de Cristian Jimenez – 2016
La famille est un jardin secret bien gardé : qu’il est difficile de communiquer avec les siens
 Sofia, végétarienne de 35 ans, a deux enfants. Depuis un certain temps, sa vie à Valdivia est chamboulée. En quête de tranquillité après sa récente séparation, elle jette son portable dans le fleuve Calle et ne regarde plus la télévision. Elle a aussi décidé de se priver d'Internet et de lecture pendant un an. C'est alors que son père décide de quitter sa mère après plus de trente ans de mariage. Sa grande sœur Ana, toujours aussi désagréable, revient vivre au Chili et ses enfants deviennent obsédés par l’idée de manger de la viande. Sans le vouloir, Sofia découvre un secret gênant sur son père. Elle le soupçonne bientôt d'avoir caché son homosexualité pendant des années...
Sofia, végétarienne de 35 ans, a deux enfants. Depuis un certain temps, sa vie à Valdivia est chamboulée. En quête de tranquillité après sa récente séparation, elle jette son portable dans le fleuve Calle et ne regarde plus la télévision. Elle a aussi décidé de se priver d'Internet et de lecture pendant un an. C'est alors que son père décide de quitter sa mère après plus de trente ans de mariage. Sa grande sœur Ana, toujours aussi désagréable, revient vivre au Chili et ses enfants deviennent obsédés par l’idée de manger de la viande. Sans le vouloir, Sofia découvre un secret gênant sur son père. Elle le soupçonne bientôt d'avoir caché son homosexualité pendant des années...
Cristian Jimenez explique que ‘’la notion de off est une manière de révéler la différence entre la vie qui s’écoule et l’expérience personnelle des gens, la manière dont la parole, le dialogue et la réalité des choses, semblent parfois ne pas être connectés…’’
A Valdivia, la ville chilienne où il est né, le réalisateur a mis en scène cette tragi-comédie familiale. On fait la connaissance de Sofia, récemment divorcée, de son père, qui a bien l'intention de l'imiter, de sa mère et sa grand-mère... Sans oublier la soeur de Sofia, Ana, son petit ami français et leur bébé, qui reviennent vivre dans la ville où elle va prendre un poste d’enseignante. En observant tendrement tout ce petit monde, le film assure une atmosphère animée et chaleureuse, traversée par des crises qui, au fond, ne parlent que d'affection et de tentatives de compréhension. Avec cette chronique du retour d’une sœur exilée en France, le réalisateur Cristian Jiménez signe une comédie, ironique et sans faux-fuyants, sur la difficulté à communiquer avec les siens.
Le film commence par un accouchement filmé au plus près, spectacle que le père ne supporte pas, ce qui ne manquera pas de lui être reproché. Des reproches, il en essuiera beaucoup d’autres, lorsque, après avoir quitté la mère de ses deux filles, seront révélés des comportements troublants, jusque-là inconnus des siens. A plusieurs reprises, Manuel a été accusé de harcèlement sexuel et sa carrière professionnelle en a été gravement affectée. Malgré l’éloignement géographique, les deux sœurs sont restées en lien. Même si Sofia s’est mise en « off » en réalisant un « vœu de déconnexion pour se purifier », elle fait appel à sa fille pour utiliser le téléphone et Skype afin de contourner l’interdit qu’elle s’est imposé à elle-même. Avec Voix off, le cinéaste renoue avec l’esprit de son premier long métrage Illusiones opticas (2009), choisissant le son de la voix et en plaçant au centre la question de l’incommunicabilité entre les membres d’une même famille. Le film suit un double mouvement : on attend la recomposition de la famille avec le retour d’Ana mais celle-ci est compromise par le départ inattendu du père, dont les deux filles tentent de comprendre la raison. Une tonalité nostalgique affleure, liée au fait que Cristian Jiménez filme sa ville et même le quartier où il a grandi. On retrouve la fantaisie un peu cruelle de son univers. Le père quitte la mère en expliquant à Sofia, tout juste divorcée, qu’il a suivi son exemple. Celle-ci arrive à s’entendre avec le père de ses enfants pour alterner leur garde ; mais c’est la garde du chien qui pose problème entre eux, tandis que leur fille communique avec sa grand-mère par internet. Au milieu de ce drame social, leur dialogue sur la toile donne lieu à quelques scènes émouvantes.
Si les scènes réunissant et opposant les quatre générations concernées sont bien dessinées et filmées avec habileté, Voix off souffre peut-être d’un manque de tension dramatique pour soutenir l’attention. Les deux sœurs, superbement interprétées, sont comme ‘’le noyau dur’’ du film ; pas si dur, cependant, au vu des doutes et des hésitations qui marquent la vie de chacun des personnages. Mais leurs relations, complexes, rendent Voix off très humain et très attachant, même si l’enchaînement des séquences ne manque pas souvent de déconcerter.
Cristián Jiménez, dont les précédents films (Illusiones opticas en 2009 et Bonsái en 2011) ont déjà été remarqués, s’en remet essentiellement aux dialogues et aux acteurs, tous excellents, pour composer le tableau d’une famille menacée d’éclatement. Oui, la famille est un jardin secret bien gardé. Heureusement !
Août 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
CRACHE CŒUR
Film de Julia KOWALSKI – 2016
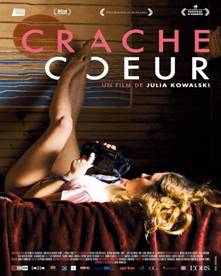 Rose, jeune fille au désir trouble, s’immisce dans la vie d’un ouvrier polonais venu en France rechercher son fils. Une relation triangulaire s’installe entre les trois personnages et déclenche, peu à peu, des bouleversements dans la vie de chacun.
Rose, jeune fille au désir trouble, s’immisce dans la vie d’un ouvrier polonais venu en France rechercher son fils. Une relation triangulaire s’installe entre les trois personnages et déclenche, peu à peu, des bouleversements dans la vie de chacun.
Crache Cœur est le premier long métrage réalisé par Julia Kowalski. Dans ce drame, la réalisatrice a introduit un certain nombre de réalités et de souvenirs de sa propre adolescence. Ce film a été nominé en 2015 aux ACID -Cannes. Il faut signaler qu’avec son court-métrage Musique de chambre, cette jeune réalisatrice a été multi-nominée au Festival International du court métrage de Clermond-Ferrand en 2012.
Dès les premières séquences de Crache Cœur et l’entrée en scène de Rose, mine renfrognée et regard dédaigneux, on comprend que la cinéaste a choisi de détourner la figure iconique de l’adolescente, pin-up passive objet de tous les désirs ou apprentie femme fatale. En dépit d’un prénom évocateur, Rose est très loin de l’éternelle jeune fille en fleur. Julia Kowalski en fait une véritable héroïne, un personnage complexe pour lequel on n’éprouve pas d’emblée de la sympathie. Agaçante autant qu’attachante, incarnée par la talentueuse Liv Henneguier, Rose étonne, et son insolence devient extrêmement réjouissante lorsque nous comprenons que nous avons affaire ici à un personnage fort, désirant et moteur de l’action. C’est son désir qui gouverne le récit, entraînant les personnages masculins dans son sillage, comme un pied de nez aux représentations d’adolescentes lisses et passives que l’on voit souvent apparaître sur les écrans.
Composée par Daniel Kowalski, frère de la cinéaste, la musique accompagne avec douceur la trajectoire des personnages, tout particulièrement celle de la jeune héroïne. Imaginée dès la phase du scénario, élaborée ensuite entre la salle de montage et la salle de répétition, la partition s’est construite peu à peu, avec comme désir premier celui de créer une atmosphère lyrique capable d’accompagner les protagonistes dans leur parcours émotionnel.
La guitare saturée et les synthétiseurs analogiques semblables à un chœur font écho au bouillonnement intérieur de Rose et annoncent les bouleversements à venir. Le thème qui se redéployée aux moments clefs du film, évoque la part mélancolique des personnages mais aussi leur cheminement intérieur au fil du récit. Alors naît, en résonance avec le tempérament énigmatique de la jeune fille, un sentiment d’étrangeté qui émane de ces accords.
Je souscris volontiers à ce qu’a écrit Antonia Naïm, animatrice du Studio d’Aubervilliers où est passé le film, en avant-première : ‘’Croche Cœur fut pour moi une belle rencontre de cinéma : une fiction à la frontière poétique du réel, un égarement dans le territoire du désir, de la violence latente. A Cannes, puis en salle, la réalisatrice est venue transmettre avec générosité son aventure filmique. Le long plan fixe qui ouvre le film annonce déjà l’audace de Julia Kowalski, qui braque sa caméra sur Rose, une adolescente au visage grave, buté, sur fond de bruits de chantier vite relayés par une bande-son électro. C’est le début d’une histoire presque documentaire où s’entrelacent deux univers culturels : France et Pologne, musique folk et rock électro, fille et père, troubles de l’adolescence et cruauté des rapports de classes, premiers amours et sexe maladroit. La dimension sociale est très présente, jamais lourde, comme une prise de conscience du réel, magnifiquement représenté par la jeune actrice Liv Henneguier, aussi tourmentée et péremptoire qu’attachante. « C’est dégueulasse d’acheter le silence des gens », dit-elle à son père, petit patron polonais… Crache Cœur est un film que je soutiens et j’invite à la découverte de ce bijou structuré comme une partition musicale, entre psychologie et sociologie, mais s’échappant de toute démonstration, maîtrisé mais imparfait et donc réussi. Chaque plan séquence apporte du sens, grâce au travail de cette jeune et talentueuse cinéaste qu’est Julia Kowalski’’.
Un très beau film, qui nous touche par les errances sentimentales et sexuelles de la jeune héroïne, un récit où on parle rarement d'une façon aussi vraie de l'adolescence féminine. Rose n'a rien d'un ange, elle est pourtant très attachante. Elle est menteuse, mauvaise, au bord de l'explosion sexuelle, séductrice sans pour autant être aguicheuse (par manque d'expérience sans doute, peut-être aussi par caractère), parfois dépassée par les événements et pourtant toujours aux commandes de sa vie avec acharnement. Elle apprend à se connaître, sans peur de se blesser, ni des dommages collatéraux qu’elle risque de subir.
Merci à la réalisatrice de nous avoir évité les clichés sur les jeunes filles pour nous ouvrir au mystère des personnes, qu’on ne comprend pas d’emblée mais qui se cherchent dans un contact quelque fois rugueux avec les autres.
Août 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
ACID : Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, a été créée en 1992 par des cinéastes afin de promouvoir les films d’autres cinéastes, français ou étrangers, et se soutenir en salle des films indépendants. Voir : www.lacid.org
SPARROWS
(LES MOINEAUX)
Film de Runar RUNARSSON – 2015
 Âgé de 16 ans, Ari (Atli Oscar Fjalarsson) chante comme un rossignol dans une chorale presque céleste et sa maman le gâte comme un enfant, à Reykjavik où ils vivent. Quand elle part en vacances avec son nouveau petit ami, Ari est envoyé chez son père Gunnar (Ingvar Eggert Sigurosson), dans la région des fjords au nord du pays où il a passé son enfance. Les retrouvailles sont douloureuses car Ari, qui ne trouve pas sa place, reproche à son père d’avoir tout raté dans sa vie. Quand il commencera à se faire des amis, commencera aussi son éveil sentimental…
Âgé de 16 ans, Ari (Atli Oscar Fjalarsson) chante comme un rossignol dans une chorale presque céleste et sa maman le gâte comme un enfant, à Reykjavik où ils vivent. Quand elle part en vacances avec son nouveau petit ami, Ari est envoyé chez son père Gunnar (Ingvar Eggert Sigurosson), dans la région des fjords au nord du pays où il a passé son enfance. Les retrouvailles sont douloureuses car Ari, qui ne trouve pas sa place, reproche à son père d’avoir tout raté dans sa vie. Quand il commencera à se faire des amis, commencera aussi son éveil sentimental…
Runar Runarsson aborde différents thèmes dans Sparrows, notamment les relations père-fils, l’amour et le pardon. Il voulait montrer que ‘’la vie est grise avec des nuances de gris’’. Présenté au festival de Toronto en septembre 2015, le film a, depuis, remporté plusieurs prix dans des évènements prestigieux à Sao Paulo, San Sébastian, Chicago, Varsovie et Göteborg notamment.
Ainsi décrit, Sparrows semble n’être qu’une chronique adolescente mélancolique de plus. C’est en réalité tout l’inverse. Le cinéma de Rúnar Rúnarsson est tout en nuance et ne se laisse pas classer facilement dans un genre précis. La mise en scène est toujours délicate, précise, trouvant toujours les bons cadres, la bonne distance, le bon tempo (...) Entre paysages glaciaires et personnages volcaniques, Sparrows trouve son bel équilibre.
Ce film appartient à ces œuvres douces-amères qui plongent avec pudeur dans le désarroi adolescent. Le retour chez le père, Islandais du bout du monde, alcoolique, héritier d’un village où certaines traditions peut paraître barbares (la chasse aux phoques ou les soûleries organisées), accentue la douleur d’une séparation de la figure maternelle, d’autant que le père, bourru et mal à l’aise, ne sait pas manifester son amour filial.
Un espoir viendra de la grand-mère qui, malheureusement, ne pourra pas veiller sur le jeune homme bien longtemps. La séparation, comme chemin d’initiation et d’émancipation, plane sur cette œuvre, belle et astrale, où la lumière baigne cette magnifique région d’une douceur mélancolique.
Le réalisateur, passionné par les relations filiales, comme en témoigne sa filmographie, évite une approche trop touristique pour donner un vrai sens au cadre naturel, à la fois protecteur, écrasant et mystérieux. La vie promet beaucoup, mais reste longtemps indéchiffrable pour le jeune homme en proie aux émotions et aux remises en question de son âge. Alors que les sentiments amoureux s’éveillent, relayant les amitiés d’enfance, la première expérience sexuelle sera une épreuve. Sparrows dévoile un beau portrait adolescent, sur une musique magnifique de Kjartan Sveinsson, connu surtout pour sa participation au légendaire groupe autochtone Sigur Ros.
Le titre Sparrows (Les moineaux) traduit à la fois la légèreté des relations entre tous ces personnages, mais aussi la fragilité de ces êtres, en proie à un climat d’hostilité, d’abord environnemental vu la dureté de la nature islandaise, mais surtout psychologique par les antagonismes qui se créent à cause des préjugés et des jugements hâtifs. Ari sera-t-il le catalyseur, le fédérateur de la résolution de tous ces conflits ?
Au-delà de ces sombres perspectives, Sparrows développe un discours éminemment positif, dans le parcours initiatique d’Ari, son refus de la violence, sa gentillesse envers les autres, sa patience. Rúnar Rúnarsson ne fait pas pour autant un discours moralisateur : par une mise en scène en retrait, par une observation fine de la psychologie des personnages, il est au service du jeu des acteurs et à l’expression de leur sensibilité. "Sparrows" fut à ce titre récompensé dans plusieurs festivals internationaux, avec raison. C’est dire si l’on se retrouve dans ce film juste et grave, imprégné d’humanité.
Oui, c’est presque aussi beau et poignant qu’un vidéo-clip de cette formation lyrique mythique. Les fans devraient faire le déplacement. Les cinéphiles aussi.
Août 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
MOI OLGA…
Film de Petr KAZDA – 2016
…homosexuelle, anéantie par l’incompréhension de ma famille et de mes proches.
 Olga est une jeune fille têtue et taciturne qui vit à Prague, dans la Tchécoslovaquie des années 1970. Les épaules voûtées, le regard bas et la cigarette au coin des lèvres, elle a le sentiment d’être rejetée partout, en famille, au travail, par ses amantes; elle est profondément blessée par le rejet de son homosexualité par la société. Elle en veut à la terre entière et échafaude, peu à peu, un plan terrible pour se venger de ses souffrances…
Olga est une jeune fille têtue et taciturne qui vit à Prague, dans la Tchécoslovaquie des années 1970. Les épaules voûtées, le regard bas et la cigarette au coin des lèvres, elle a le sentiment d’être rejetée partout, en famille, au travail, par ses amantes; elle est profondément blessée par le rejet de son homosexualité par la société. Elle en veut à la terre entière et échafaude, peu à peu, un plan terrible pour se venger de ses souffrances…
Moi Olga raconte l’histoire vraie d’Olga Hepnarova (Michalina Olszanska), dernière femme à avoir été exécutée en Tchécoslovaquie le 10 juillet 1973, peu après le ‘’Printemps de Prague’’ , par pendaison courte, pour meurtre de masse prémédité. Bien qu’inspiré d’évènements réels, le film Moi, Olga se refuse à toute exploitation de ce triste évènement pour s’interroger sur ce qui a pu pousser cette « fille en bonne santé et à la peau blanche » à commettre en toute lucidité un acte dont la République Tchèque se souvient encore plus de 40 ans après les faits. Même si Pietr Kazda et Tomas Weinreb n’ont aucun parti pris dans l’histoire qu’ils racontent, ils ont mis du temps à trouver des financements pour faire ce film. Ils disent eux-mêmes : ‘’En République Tchèque, le sujet était délicat. Peu de personnes comprenaient pas qu’on puisse filmer un tel drame cru et existentiel ; on pensait plutôt que nous voulions défendre une meurtrière en série…’’ C’est finalement grâce à la Pologne et à la France qu’ils ont pu terminer leur film. Porté par la performance de son actrice Olga Hepnarova, le film lève le voile sur les coulisses d’un fait divers qui a profondément marqué le pays.
Olga a délibérément tué ; elle avait même prévenu en envoyant, quelques jours auparavant, des courriers annonçant son geste. La jeune femme y voyait une réparation, celle d’une vie incomprise depuis longtemps. A 13 ans, sa mère l’a fait interner en hôpital psychiatrique après plusieurs tentatives de suicide et de nombreuses fugues. Olga en nourrira une haine profonde envers le monde. Devenue asociale, elle sera virée de ses lieux de travail. Rebelle à toute hiérarchie, à tout ordre moral, elle vivra en quasi-ermite dans un cabanon, n’ouvrant sa porte qu’aux femmes dont elle tombera amoureuse. Mais elle replongera dans la colère quand celles-ci la rejetteront, inquiètes de son comportement imprévisible. A son procès, elle refusera que son avocat plaide la folie pour tenter de la disculper. Elle tiendra à être condamnée, à mort, pour devenir un martyr, celle qui aura été anéantie par l’incompréhension de sa famille et de ses proches…
Michalina Olszanska, Olga, s’est jointe au projet très peu de temps avant le début du tournage. Elle s’est fondue dans son personnage et elle est devenue Olga. Pietr Kazda dit : ‘’Sa concentration était extraordinaire, elle ne parlait à personne et, pendant les pauses, elle se préparait pour la scène suivante. Après le tournage, elle repartait pour l’hôtel où elle restait seule, comme Olga. J’ai vraiment aimé travailler avec Michalina : c’est un avantage considérable quand on n’a pas tout à expliquer à une actrice. On en ressortait le meilleur, juste avec quelques mots et quelques regards’’.
L’homosexualité d’Olga est intégrée dans le récit, sans que le personnage soit défini uniquement par son orientation sexuelle. Pietr Kazda explique : ‘’C’était une question complexe. D’un côté son orientation sexuelle était si évidente à nos yeux que nous n’avions nul besoin de la mettre en exergue. Elle faisait partie d’une minorité sexuelle et cela faisait partie de sa vie. Mais Olga avait bien d’autres problèmes : elle recherchait la solitude, sans pouvoir rester complètement seule.
En fait notre film parle du manque de compréhension ; c’est pour cela que nous l’appelons un « drame existentiel ». Une grande partie du film se concentre intimement sur Olga, sa vision du monde nihiliste et furieuse. Mais, après son crime, on la perçoit de façon plus détachée, distante, objective, comme si nous l’observions de l’extérieur. Nous avons toujours essayé d’être et de ne pas être avec Olga Hepnarova. Nous avons tenté de trouver un équilibre entre notre vision et les faits que nous connaissions. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur elle. Pour nous, son crime vient de l’irrationnel’’.
Pietr Kazda et Tomas Weinreb retracent le parcours d’une enragée et de son enfer personnel. A l’époque, Olga fut perçue comme une folle par l’opinion publique. Les cinéastes reconstruisent le puzzle autour d’une hypothèse plus brutale, celle d’une victime suffoquant sous des souffrances telles qu’elle n’a pas trouvé d’autre d’échappatoire qu’une vengeance transgressive. Olga, lectrice de Kafka et de Camus, aurait pu être l’héroïne d’un de leurs romans, répondant à la violence sociale par un crime, ultime cri d’alarme. Qu’elle ait été ou non psychotique, qu’elle ait agi par douleur d’une rupture amoureuse, n’a guère d’importance. Moi Olga la considère avant tout comme une âme torturée, ruminant ses névroses jusqu’à l’implosion autodestructrice, comme un électron libre ne supportant plus la ‘’normalisation’’ du Printemps de Prague. Comme De Niro dans Taxi Driver, Michalina Olszanska est impressionnante de malaise dans la peau de cette fille, tout à tour attachante et inquiétante, jusqu’à rendre bouleversante la scène finale de libération tragique de cette jeune femme, inadaptée à son époque. Avec son regard d’animal sauvage et apeuré, elle se donne corps et âme à son personnage. Le plan serré sur un visage hermétique à l’extérieur, son mutisme et son énergie au bord de l’anesthésie, révèlent son isolement, voire son exclusion pure et simple, lorsqu’elle quitte l’espace visuel.
Pour les cinéastes, la véritable victime est aussi la coupable. Moi, Olga est le récit d’un désespoir, engendrant marginalisation et passage à l’acte. Il en découle un portait préférant le questionnement intime au jugement moral, à la fois déstabilisant et bouleversant. Le point de vue adopté permet l’empathie vis-à-vis d’un personnage blessé, buté, incapable de communiquer et inadapté à « un monde abstrait qui ne la concerne pas ». Moi, Olga nous laisse avec ses mots d’une violence déchirante, nous enserrent dans une souffrance intérieure qu’on finit par éprouver, tout en incitant graduellement à la distance : est-elle vraiment l’une de ces « prügelknabe » (souffre-douleur) dont elle veut défendre la cause ou une pauvre jeune femme dont la dépression suscite une haine viscérale du monde jusqu’à la folie ? Et d’ailleurs, où commence la folie, à partir de quelle frontière franchie peut-on la nommer ? « Je suis folle mais ma folie est clairvoyante. Vous paierez pour vos rires et pour mes larmes ! ». Cette seule condamnation désigne le tourbillon où Olga sombre, à jamais insaisissable.
Août 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Cette tentative de libération du joug communiste s’est achevée le 28 août 1968 par l’invasion du pays par les troupes du Pacte de Varsovie.
MASCULIN – FEMININ
Film de Jean-Luc GODARD
Ce film tourné en 1966 raconte les tourments de la jeunesse (notamment l’avortement et la sexualité, sujet encore tabous à l’époque) et de la société (ses mutations, ses utopies, ses illusions, l’élections présidentielle...).

 Paul (Jean-Pierre Léaud), 21 ans et tout juste démobilisé du service militaire, est à la recherche d’un travail et milite contre la guerre au Vietnam. Dans un café, il retrouve son ami Robert (Michel Débord), militant de gauche. A côté d’eux, à la table voisine, se trouvent Madeleine (Chantal Goya), Élisabeth (Marlène Jobert) et Catherine (Catherine-Isabelle Duport). Madeleine veut devenir chanteuse et s’apprête à enregistrer un disque. Elle fait entrer Paul au journal ‘’Salut les copains’’. Paul s’éprend d’elle mais la jeune chanteuse se préoccupe plus de sa réussite dans le métier que des manifestations sentimentales de son ami. Élisabeth se consume d’un amour muet pour lui. Paul finit par trouver un emploi dans un institut de sondage (IFOP) où il est chargé de faire une enquête sur les principales préoccupations des français. Il se laisse emporter par l’action politique, mais son insatisfaction reste entière et épuisante. Il habite provisoirement chez deux de ses amies…
Paul (Jean-Pierre Léaud), 21 ans et tout juste démobilisé du service militaire, est à la recherche d’un travail et milite contre la guerre au Vietnam. Dans un café, il retrouve son ami Robert (Michel Débord), militant de gauche. A côté d’eux, à la table voisine, se trouvent Madeleine (Chantal Goya), Élisabeth (Marlène Jobert) et Catherine (Catherine-Isabelle Duport). Madeleine veut devenir chanteuse et s’apprête à enregistrer un disque. Elle fait entrer Paul au journal ‘’Salut les copains’’. Paul s’éprend d’elle mais la jeune chanteuse se préoccupe plus de sa réussite dans le métier que des manifestations sentimentales de son ami. Élisabeth se consume d’un amour muet pour lui. Paul finit par trouver un emploi dans un institut de sondage (IFOP) où il est chargé de faire une enquête sur les principales préoccupations des français. Il se laisse emporter par l’action politique, mais son insatisfaction reste entière et épuisante. Il habite provisoirement chez deux de ses amies…
A sa sortie en 1966, le film a été interdit aux moins de 18 ans en raison des thèmes abordés par JL. Godard, notamment l’avortement et la sexualité, sujet encore tabous à l’époque. Pour son interprétation de Paul, JP. Léaud remportera l’Ours d’Argent lors de la 16e Berlinade. L’acteur collaborera à nouveau avec Godard à neuf reprises…
JL. Godard filme la dépression de la jeunesse française, en pleine période d’élections présidentielles. Après Pierrot le fou, tout en couleurs, le réalisateur applique à son long-métrage, en noir et blanc, une méthode inspirée des sondages : un questionnement incessant dont le résultat est bien éloigné d’une extériorisation clarificatrice, voire même d’une expression personnelle.
Pour Masculin, féminin, il choisit ainsi deux nouvelles de Maupassant, La Femme de Paul et Le Signe, dont il conserve surtout, outre le dénouement tragique, l’« infranchissable abîme » entre les deux protagonistes, Madeleine et Paul. Chantal Goya, alors l’une des chanteuses yéyé les plus vues, et Jean-Pierre Léaud, acteur prometteur et déjà courtisé, sont choisis par Godard : ce que cherche le cinéaste, ce sont déjà des représentations culturelles de la jeunesse. De même qu’il avait investi la Maison de la Radio pour Alphaville, Godard s’empare cette fois de la rédaction du tout récent magazine Mademoiselle Âge Tendre qui s’adresse à cette même génération. Le couple de Paul, syndicaliste et militant anti-américain, mais employé à l’IFOP, et de Madeleine, jeune chanteuse et pur produit de consommation, est condamné à ne pas s’entendre.
Dans Masculin, féminin, les flirts s’apparentent à des interrogatoires, où les personnages sont isolés dans un cadre imperturbable qui masque le questionneur. Ce dispositif de dialogue unilatéral réapparaîtra dans La Chinoise, mais Godard l’utilise déjà dans Masculin, féminin : les questions seront posées aux acteurs directement par le réalisateur, grâce à une oreillette, tandis que le script ne sera dévoilé qu’en quelques phrases. Il n’y a pas de bande de jeunes, juste des individus à part, incapables de partager plus que quelques blagues salaces : ce tiraillement produit un désespoir, comme celui de Paul, coincé entre Madeleine, charmante jeune femme vouée aux pires manœuvres de la société de consommation, et ses idéaux révolutionnaires. En suivant ce dilemme amoureux somme toute plutôt classique, JL. Godard fait aborder à ses personnages tous les sujets brûlants de l’époque : contraception, sexualité, Vietnam, le tout subtilement baigné par la possibilité du suicide, qui revient régulièrement dans Masculin, féminin. Avoir 21 ans en 1965, c’est vivre les élections présidentielles qui opposent Charles de Gaulle à François Mitterrand comme un événement dont la jeunesse est d’emblée exclue. Elle se rappellera au bon souvenir de la société peu après…
Très librement inspiré de Maupassant, Masculin féminin est l’une des œuvres de transition dans la carrière de Godard entre sa période créative faste (clôturée par Pierrot le Fou) et une série de films militants radicaux dans leur forme, qui le couperont d’une partie de son public. Deux ans après Une femme mariée : Suite de fragments d’un film tourné en 1964, Godard propose une autre radioscopie des femmes de son époque, même si l’enquête sociologique qui sert de prétexte au synopsis se focalise particulièrement sur la jeunesse. Tourné en pleine campagne présidentielle, le film se veut le témoin d’une période charnière qui annonce Mai 68 et sa contestation de l’ordre moral et politique. Les jeunes gens dépeints par Godard sont ces « enfants de Marx et de Coca-Cola », profitant des richesses matérielles d’une société de consommation, écartelés entre l’attrait pour le bien-être petit bourgeois véhiculé par l’American way of life et une remise en cause des modes de vie. Le film est à cet égard, avant La Chinoise, un document passionnant sur le milieu des années soixante, sa vague yéyé, ses doutes, et les valeurs ambiguës de la nouvelle génération de l’époque.
Un film très actuel : c'est peut-être cela qui frappe le plus quand on revoit aujourd'hui Masculin-Féminin, quarante ans après sa sortie. Un film sur la jeunesse principalement et la société (ses mutations, ses utopies, ses illusions...). Un Jean-Pierre Léaud formidable comme à son habitude et une Chantale Goya parfaite (dans son rôle...). Des scènes d'une ironie et une causticité délicieuses (comme le dialogue avec une jeune mannequin, si affligeant mais malheureusement si actuel). En bref, un grand Godard !
Août 2016 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Men & Chicken
Réalisateur : Anders Thomas Jensen
Sortie : 25 mai 2016

A la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu’ils ont été adoptés et que leur père biologique, Evelio Thanatos, est un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur l’île mystérieuse d’Ork. Malgré leur relation houleuse, ils décident de partir ensemble à sa rencontre. Arrivés sur cette île éloignée de la civilisation, ils vont découvrir une fratrie étrange et des origines inquiétantes. Il devient évident que, décidément, on ne choisit pas sa famille.
Des frères assez bizarres donc. Surtout Elias (Mads Mikkelsen) et Gabriel (David Dencik) qui a, lui, l'air un peu mieux ‘’fini’’. On les trouve surtout étranges parce qu'on ne connaît pas encore les autres frères. Trois autres spécimens qui vivent sur l’île, loin de tout, physiquement et psychologiquement assez atteints.
Les deux premiers ne connaissent pas les trois suivants, mais la mort de leur père adoptif va les amener à se rencontrer. Et les voilà partis à la rencontre de cette famille inconnue, dont le papa est un généticien pour le moins créatif… Les retrouvailles vont être à la hauteur, avec bombardement de marmites en fonte, attaques à l'aide d'animaux empaillés. Et ça ne fait que commencer.
En insistant sur les dégénérescences physiques de ses personnages (becs de lièvres, nez explosés, doigts de pieds interminables…), Anders Thomas Jensen ne s'est pas fait que des amis lors de la sortie de son film au Danemark. Il s'est défendu de toute discrimination, insistant sur sa volonté de "créer un lien
C’est, pour le cinéaste, l’occasion d’examiner au scanner la bestialité qui so
physique" entre des personnages issus de la même famille. Un peu comme les O'Hara et les O'Timmins de la BD de Lucky Luke, grandes oreilles contre gros nez rouges.
Anders Thomas Jensen joue les apprentis sorciers en mélangeant dans son chaudron une fratrie dégénérée, de l'humour noir qui voit rouge, de la violence burlesque, des décors à la déliquescence surréaliste, du fantastique, de l'onanisme et, surtout, une poésie visuelle existentielle, émouvante et assénée avec amour.
A travers ces frères à bec de lièvre, tour à tour aussi frustes que des hommes des cavernes et aussi élégants que des lords, c'est tout le mystère de la génétique, du déterminisme et de notre part animale qui défile à travers cette parade de monstres. Si ces Laurel et Hardy surmultipliés nous font rire, c'est surtout leur détresse ineffable qui nous touche au plus profond.
Ces deux-là semblent prendre plaisir à faire des films ensemble. L’acteur Mads Mikkelsen et le réalisateur Anders Thomas Jensen collaborent pour la 4° fois dans le film Men and Chicken. Fan de "Breaking Bad", le cinéaste danois s’est inspiré de l’humour noir de la série pour mettre en scène une comédie grinçante. En grand fan de Breaking Bad, le cinéaste a tenu à insuffler de l’humour noir à ce récit animé par la nécessité de vivre-ensemble. Lequel, au-delà de ses fantaisies extrêmes, s’inspire partiellement de sa propre smala. Chez les Thanatos, comme souvent dans son œuvre, les personnages détonnent par une naïveté et une trivialité manifestes.
Anders Thomas Jensen nous offre ici un scénario unique, incomparable et totalement décalé. Mads Mikkelsen, David Dencik ou encore Nikolaj Lie Kaas sont métamorphosés. Leurs costumes, mais surtout leurs visages et coiffures sont d’un glauque presque risible et toujours justifiés dans l’histoire. Les échangent de coups d’animaux empaillés pourraient faire pâlir les taxidermistes et ceux qui n’aiment pas la lourdeur des films de Bruno Dumont. Mais ici, les situations grotesques ne sont pas sans intelligence. Men & Chicken ne suit aucun code et à vraiment de quoi nous dérouter. Il s'agit d'une fable féroce et déjantée qui mérite qu'on s'y arrête car on voit rarement des films aussi originaux et audacieux autant dans le fond que dans la forme.
Claude D’Arcier - Juillet 201
