Visionnaire de l'invisible
Le Cinéma
A voir absolument
COLD WAR
Film Polonais de Pawel PAWLIKOWSKI - 2018
 Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, Wiktor un musicien charismatique, et deux autres Polonais spécialistes en musicologie, son mandatés par le Parti pour débaucher des artistes dans la campagne polonaise afin d’alimenter un spectacle de propagande. Wiktor tombe rapidement sous le charme de Zula, une jeune chanteuse pudique et attachée à son pays natal. Épris de liberté, Wiktor voudrait qu’ils s’enfuient vers un Occident qu’il idéalise. Il finit par partir pour Paris, bientôt rejoint par la jeune chanteuse passionnée. Ils découvrent en fait un Paris mondain à la place du Paris Bohème qu’ils espéraient. En 10 ans de vie commune, le couple s’aime et se déchire. Ils vivent un amour impossible dans une époque impossible… Considéré comme un des meilleurs films de l’année avant même sa sortie, Cold War était présenté en compétition lors du dernier Festival de Cannes, où Pawel Pawlikowski a remporté le prix de la mise en scène.
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, Wiktor un musicien charismatique, et deux autres Polonais spécialistes en musicologie, son mandatés par le Parti pour débaucher des artistes dans la campagne polonaise afin d’alimenter un spectacle de propagande. Wiktor tombe rapidement sous le charme de Zula, une jeune chanteuse pudique et attachée à son pays natal. Épris de liberté, Wiktor voudrait qu’ils s’enfuient vers un Occident qu’il idéalise. Il finit par partir pour Paris, bientôt rejoint par la jeune chanteuse passionnée. Ils découvrent en fait un Paris mondain à la place du Paris Bohème qu’ils espéraient. En 10 ans de vie commune, le couple s’aime et se déchire. Ils vivent un amour impossible dans une époque impossible… Considéré comme un des meilleurs films de l’année avant même sa sortie, Cold War était présenté en compétition lors du dernier Festival de Cannes, où Pawel Pawlikowski a remporté le prix de la mise en scène.
Après un retour à ses origines polonaises avec le triomphe de son film Ida, qui a reçu l’Oscar du meilleur film en lange étrangère en 2015, Pawel Pawlikowski dessine un nouveau portrait en noir et blanc, de la Pologne des décennies passées. Il chante les étapes d’un amour intense et malmené, qui traverse les années et les frontières, de Varsovie à Paris, de Berlin à la Yougoslavie. En filigrane, c’est l’histoire de ses propres parents qu’il célèbre. Un homme et une femme puissamment reliés dans l’amour, mais déchirés par l’impossibilité de vivre ensemble. Le long-métrage leur est dédié, et les protagonistes portent leurs prénoms.
Construit par étapes temporelles et ellipses assumées, ce récit ciselé d’une passion séduit, caresse, ravit. La virtuosité narrative et formelle règne. La sensualité aussi. La caméra aime les visages, les voix et les corps de Joanna Kulig et Tomasz Kot, renversants de séduction. Leur incarnation est totale, organique, charnelle, fusionnelle avec leurs personnages, de leurs baisers aux vibrations de leurs cordes vocales. Le cinéaste les enveloppe avec une bienveillance profonde, et leur colle à la peau. Le résultat est bouleversant.
Zula et Wiktor, la chanteuse et le musicien, vivent leurs élans au son d’une musique jazz entêtante, qui fait battre le cœur des images denses de Lukasz Zal. La précision du grain et la profondeur des plans magnétisent l’écran presque carré du format 1.33. Pawlikowski raconte un monde totalitaire qui veut empêcher l’individu de vivre sa liberté. La Guerre froide qui retient, qui sépare, qui écrase, qui mutile. Avec sa délicatesse assumée et son art de la séquence, considérée comme un tableau, ce cinéma crée un espace-temps unique. Cet art a été récompensé du Prix de la mise en scène à Cannes en mai dernier. Une expérience à vivre les yeux grands ouverts.
Furieusement romantique, Cold War rend le spectateur très vite captif par une espèce d’autorité immédiate auquel il se soumet, à l’image du régime qu’il décrit en toile de fond. Mais surtout, le film est littéralement habité par son duo d’acteurs principaux et notamment Joanna Kulig, consciente du déclin qui l’attend, et qui est bouleversante de grâce jusque dans sa descente aux enfers dans les vapeurs d’alcool. L’actrice, qui est aussi chanteuse dans la vraie vie, a flirté jusqu’au dernier jour avec un possible Prix d’interprétation pour ce personnage entier, dont elle déploie toutes les nuances, tous les éclats, toutes les brûlures et les blessures de sa tragédie amoureuse, laquelle n’a rien perdu de son attrait à notre époque. La preuve en est faite, avec ce film remarquable qui laissera, comme Ida, sa mystérieuse beauté toucher nos cœurs.
Le réalisateur n’a pourtant pas pris la grosse tête. ‘’Je suis détesté par le gouvernement d’extrême droite au pouvoir dans mon pays, ce qui est paradoxal car cette récompense est une magnifique vitrine pour la Pologne’’, explique-t-il. Pour autant, le cinéaste ne se voit pas partir travailler ailleurs. ‘’Je ne suis pas menacé physiquement, précise-t-il. Le pays est comme divisé en deux. Et les vrais Polonais, ceux que j’aime, ceux qui sont ouverts et généreux, me soutiennent.’’ C’est à ces derniers qu’il rend hommage en chanson avec cette rencontre d’un musicien et d’une chanteuse dans les années 1950.
‘’Ce qui plairait au gouvernement serait que je fasse un film patriotique avec Mel Gibson en héros’’, plaisante-t-il. Résolu à continuer à défendre son pays dans ce qu’il a de plus beau, Pawel Pawlikowski est fier de le représenter à Cannes avec cette romance en noir et blanc. ‘’Même si le gouvernement se fiche de la culture, il aime bien les chansons patriotiques que chante l’héroïne et il a même financé le groupe folklorique de mon film après le tournage’’, explique-il. Bien qu’il se refuse à l’imaginer, une Palme d’or aurait fait très bien sur sa cheminée à côté de l’Oscar qu’il a reçu pour Ida.
S’il nous parle des années de plomb, Pawel Pawlikowski en fait surtout un décor, une toile de fond sur laquelle se pose l’histoire émouvante et romantique de deux êtres qui pensaient pouvoir s’aimer dans la patrie de Victor Hugo. Zula et Wiktor se sont unis secrètement derrière le rideau de fer, à l’abri des interdictions avant de franchir l’impossible frontière et de se retrouver pleinement libre et malgré tout contraints par une culture à laquelle Zula n’arrive pas à s’adapter. C’est le déracinement plus que le désamour que filme, dans un noir et blanc à l’esthétique irréprochable, un cinéaste peu enclin à reprendre l’Histoire là où le mur s’est arrêté. Un choix narratif qui édulcore un peu la puissance de sa mise en scène. L’interprétation de Joanna Kulig et Tomasz Kot est sans reproche. Ils nous évitent le mélodrame. Comme Ida, ce film est un chef d'œuvre : magnifique noir et blanc, intrigue poignante. L'amour d'une femme et d'un homme, dans des conditions impossibles, des notations d'une extraordinaire finesse. L’importance de la musique est à souligner où elle fait ici office de troisième personnage. Avec sa photographie très soignée et sa réalisation maitrisée, Cold War aurait pu remporter le prix que beaucoup attendaient. A voir absolument.
Novembre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Un exceptionnel réquisitoire contre toutes les lois
qui séparent les êtres humains et les empêchent de vivre ensemble.
LE PROCES CONTRE MANDELA ET LES AUTRES
Film Français de Nicolas CHAMPEAUX et Gilles PORTE – 2018
 Le procès de Rivonia, qui s’est tenu en Afrique du Sud entre octobre 1963 et juin 1964, a envoyé Nelson Mandela, alors membre de l’ANC (African National Congress), en prison pendant 27 ans, avec Walter Sisulu, Govan Mbeki, Elias Motsoaledi, Andrew Mlangeni, Raymond Mhlaba, Ahmed Kathrada et Denis Goldberg, les compagnons de lutte de Madiba, qui ont également été arrêtés. Les militants anti-apartheid sont accusés par le gouvernement sud-africain de sabotage. Ce crime est passible de la peine de mort. Un bras de fer s’engage entre le procureur et les accusés. Finalement, ils n’écoperont ‘’que’’ de la prison à vie. Le procès, dont aucune image n’est disponible, est reconstitué à travers des entretiens, de l’animation par l’artiste Oerd van Cuijlenborg et des archives sonores des audiences.
Le procès de Rivonia, qui s’est tenu en Afrique du Sud entre octobre 1963 et juin 1964, a envoyé Nelson Mandela, alors membre de l’ANC (African National Congress), en prison pendant 27 ans, avec Walter Sisulu, Govan Mbeki, Elias Motsoaledi, Andrew Mlangeni, Raymond Mhlaba, Ahmed Kathrada et Denis Goldberg, les compagnons de lutte de Madiba, qui ont également été arrêtés. Les militants anti-apartheid sont accusés par le gouvernement sud-africain de sabotage. Ce crime est passible de la peine de mort. Un bras de fer s’engage entre le procureur et les accusés. Finalement, ils n’écoperont ‘’que’’ de la prison à vie. Le procès, dont aucune image n’est disponible, est reconstitué à travers des entretiens, de l’animation par l’artiste Oerd van Cuijlenborg et des archives sonores des audiences.
La numérisation de ces archives sonores n’a été rendue possible que par l’invention récente, par Henri Chamoux, de ‘’l’archéophone’’, une machine qui permet de lire les disques de vinyle souple sur lesquels elles étaient gravées. Chamoux a écouté l’intégralité des 256 heures du procès et il a été frappé par la bravoure de certains des accusés, comme Ahmed Kathrada. Le cinéaste l’a contacté pour écouter ces fichiers : ‘’J’ai été bouleversé par ce que j’entendais – la qualité sonore et l’émotion qui s’en dégageait. J’ai voulu que ces voix résonnent, que tout le monde puisse entendre leur histoire. Je pensais : Qui aujourd’hui prend ce type de risque au nom d’une cause ? Et j’ai décidé d’en faire un film…’’ En 2016, Champeaux contacte Gilles Porte et ils entrent en rapport avec les trois derniers survivants de cette affaire, ainsi que l’avocat de Nelson Mandela. Ils sollicitent un graphiste Nicolas Oerd : ‘’Il devait dessiner quelque chose à l’écran sans jamais entrer en rivalité avec le son. Les politiques de l’Apartheid, qui consistent à séparer les gens en fonction de leur couleur de peau, se prêtaient bien au dessin en noir et blanc, avec un trait entre les deux. Il a su s’en inspirer’’. Mais en mettant sur le même banc d’accusation des Noirs, des Blancs et un Indien, le gouvernement entérinait le caractère multiracial du mouvement anti-aparthied. Très vite la ligne de défense des accusés va faire de ce procès un procès politique, en plaidant non coupables et en accusant le gouvernement d’être le seul responsable de la situation.
En écoutant ces témoignages, le rôle de Mandela semble moins déterminant que ce que la grande histoire a retenu. ‘’Comme le dit l’avocat Georges Bizos, Sisulu était l’éminence grise de l’ANC. Il connaissait l’histoire du mouvement et était proche du Township de Soweto. Mandela a été mis en avant par le collectif parce qu’il était un orateur brillant, un avocat, mais aussi parce qu’il était d’une lignée royale. Il a su guider des générations dans un monde où il ne sera jamais bon d’accepter l’intolérable. Avec ses compagnons, ils se sont engagés sur une route où leurs vies personnelles étaient secondaires par rapport à la cause qu’ils défendaient…’’
Nelson Mandela, mort en 2013, aurait eu cent ans en 2018. Sa vie restera dans l’histoire comme celle d’un homme qui s’est levé contre l’apartheid. Ce combat a déjà fait l’objet de plusieurs films, d’Invictus de Clint Eastwood (2009), à Mandela : un long chemin vers la liberté, de Justin Chadwick (2013). La plupart ont pourtant oublié un évènement fondateur : le célèbre procès de Rivonia, qui le condamne avec ses compagnons à la prison à perpétuité, le 12 juin 1964.
Ce film formidable tient du miracle quand on sait qu’il ne restait que des mots du procès. Mais quels mots ! Ils dégagent aujourd’hui la même puissance qu’en 1963, imposent leur présence et s’écoutent avec le souffle retenu pour ne pas en perdre un seul. Ce ne sont pas seulement deux réalisateurs talentueux qui nous restituent un pan essentiel de l’histoire du monde. C’est aussi toute une équipe de chercheurs virtuoses qui mettent leurs compétences au service d’un même engagement : porter la voix de ces hommes, de ces femmes, de ces familles hors du commun. Les dessins d’Oerd, qu’on croirait tracés au fusain, tantôt narratifs, tantôt abstraits, cernent l’atmosphère d’un noir d’encre intemporel, sans se départir d’une note d’humour salutaire, pendant que la musique d’Aurélien Chouzenaux nous plonge dans une ambiance sonore, très suggestive et juste. Un vrai travail de symbiose, grâce au travail de la monteuse Alexandra Strauss (celle de I’m not your negro, de Raoul Peck, en 2016), qui jongle avec bonheur entre images d’archives, dessins d’animation, interviews récentes des avocats, des épouses, des enfants, des trois accusé toujours vivants. Ensemble, ils construisent un pont entre les époques, donnent chair aux personnages qui nous deviennent vite familiers. Avec eux, on s’indigne, on subit l’humiliation…
Le film se révèle être un exceptionnel réquisitoire, totalement valide dans le monde actuel, contre toutes les lois qui séparent les êtres humains et les empêchent de vivre ensemble. Nous aurons bien besoin de la force qu’éveillent de tels films dans la période agitée qui s’annonce dans notre monde.
Novembre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Cinq femmes pour qui la survie de la famille est devenue une obsession.
FEMMES DU CHAOS VENEZUELIEN
Film Vénézuélien de Margarita CADENAS -2017
 Cinq femmes de classes sociales et de générations différentes dressent le portrait d’une société en perdition et nous permettent de prendre le pouls d’une population en détresse, de représenter une sorte de baromètre de la situation du Venezuela. Filmées dans leur quotidien, elles témoignent de leur détresse face à une situation intenable : celle de la pénurie alimentaire, du manque de moyens médicaux et sociaux, de la violence et de la criminalité grimpante d’un pays qui fut un eldorado économique et qu’elles ne reconnaissent plus. Au Venezuela, la crise économique s’est installée durablement. Malgré les dénégations des autorités, le pays manque de tout. Les magasins sont vides et, faire la queue pendant des heures ne garantit même pas de pouvoir obtenir quelque chose. Par manque de médicaments, les hôpitaux n’ont plus les moyens de soigner convenablement les patients. La liberté d’expression est également sur la sellette : on enferme les gens pour leurs opinions politiques. Ce documentaire suit le destin de cinq femmes d’horizons différents, qui se battent quotidiennement pour garder la tête haute et hors de l’eau …
Cinq femmes de classes sociales et de générations différentes dressent le portrait d’une société en perdition et nous permettent de prendre le pouls d’une population en détresse, de représenter une sorte de baromètre de la situation du Venezuela. Filmées dans leur quotidien, elles témoignent de leur détresse face à une situation intenable : celle de la pénurie alimentaire, du manque de moyens médicaux et sociaux, de la violence et de la criminalité grimpante d’un pays qui fut un eldorado économique et qu’elles ne reconnaissent plus. Au Venezuela, la crise économique s’est installée durablement. Malgré les dénégations des autorités, le pays manque de tout. Les magasins sont vides et, faire la queue pendant des heures ne garantit même pas de pouvoir obtenir quelque chose. Par manque de médicaments, les hôpitaux n’ont plus les moyens de soigner convenablement les patients. La liberté d’expression est également sur la sellette : on enferme les gens pour leurs opinions politiques. Ce documentaire suit le destin de cinq femmes d’horizons différents, qui se battent quotidiennement pour garder la tête haute et hors de l’eau …
Femmes du chaos vénézuélien, ou comment survivre sous Maduro ? Ce documentaire de Margarita Cadenas décrit l'effondrement du pays à travers les vies de cinq femmes, cinq mères qui luttent pour la survie de leur famille. Tenter de comprendre le Venezuela en 2018 revient à interviewer des gens qui pleurent. Aussi variées soient les situations, aussi différentes les histoires et les vies, il y a toujours un moment où la voix de l'interlocuteur s'étrangle, où s'installe le silence, avant que parfois, les larmes brisent la barrière de la pudeur. La misère a nivelé les classes sociales. Margarita Cadenas, Vénézuélienne vivant en France, a choisi pour incarner les multiples aspects de la descente aux enfers de ce ‘’pauvre pays riche (de son pétrole)’’, comme elle l'appelle, cinq trajectoires de femmes. Sur place, elle a travaillé avec une équipe, mais aucun nom n'apparaît. Telle est la peur des conséquences de la critique dans une République bolivarienne qui exerce une censure de plus en plus étouffante.
Margarita Cadenas, Vénézuélienne vivant en France : "Ce film, je l’ai fait pour que le monde entier connaisse notre situation". Pourquoi cinq femmes ? Parce que ce sont celles pour qui la survie de la famille est devenue une obsession. Elles sont une métaphore du naufrage de l'ancien eldorado pétrolier, de sa lutte pour survivre, aussi.
Kim, infirmière, est imperturbable à l'hôpital, alors que tout manque, draps, seringues, sérum, antibiotiques. Un jour, faute de matériel, il a fallu choisir entre opérer un blessé par balle et un jeune souffrant d'une appendicite : ‘’On a choisi celui qui avait le plus de chances de survie, celui avec l'appendicite.’’ Les problèmes d'approvisionnement en médicaments ont entraîné une crise sanitaire majeure, qui a vu la résurgence de maladies oubliées, comme la diphtérie et le paludisme. La dernière ministre de la Santé, qui a osé communiquer sur la mortalité infantile et maternelle, a été remerciée aussitôt. Mais ce qui brise Kim, c'est l'exil programmé avec son mari et ses deux enfants, et l’abandon de ses vieux parents. ‘’Nous brisons une vie pour en commencer une autre’’, souffle-t-elle. Depuis 2014, le gouvernement avait cessé de communiquer des chiffres sur la santé. Puis le 11 mai dernier, la ministre Antonieta Caporales a publié des statistiques inquiétantes. Elles révèlent un bond de 30 % de la mortalité infantile depuis 2015, de 65 % des décès maternels (liés à la grossesse et à l'accouchement) et de 76 % des cas de paludisme. La suite ne s'est pas fait attendre : quatre mois après avoir pris son poste, Antonieta Caporales a été limogée. Pour les médecins, ces chiffres n'avaient rien d'étonnant. ‘’Sans aide, on ne peut pas nourrir les patients. Il y a deux mois, les restaurants du quartier de Las Mercedes nous ont donné de la nourriture, révèle le Dr Ferrer. Quand il n'y a pas de médicaments, on nous en envoie de l'extérieur parce qu'on est un hôpital connu.’’ Se faire opérer, au Venezuela, signifie la plupart du temps apporter soi-même les traitements nécessaires.
‘’On demande à Dieu, mais Dieu est sourd, il ne se passe rien’’. María José, community manager, accumule frénétiquement les couches achetées au marché noir pour son bébé et a pris l'habitude de stocker l'eau dans des bidons, parce qu'elle n'arrive que les ‘’jeudis, vendredis et samedis’’. ‘’Le reste du temps, on utilise des seaux. On s'habitue’’, assure-t-elle. Mais, ce à quoi elle ne s'habitue pas, ce qui la fait pleurer à la caméra, c'est l'insécurité. ‘’J'ai peur. Pas pour moi, mais pour mes enfants. Chaque fois que j'ai été agressée, mon fils était sur la banquette arrière de la voiture…’’
María José, community manager : elle dit qu'elle s'est habituée aux pénuries, pas à la peur...
Caracas est devenue la capitale la plus dangereuse du monde, avec 111,19 morts pour 100 000 habitants, selon le Conseil citoyen pour la sécurité publique et la justice pénale (CCSPJP), institut mexicain qui fait autorité en la matière. La délinquance, échec majeur de sa politique, a toujours embarrassé Hugo Chávez. Nicolás Maduro, son successeur, a résolu le problème : les chiffres ne sont plus publiés.
Eva, au chômage, dort sur des cartons dans les files d'attente pour les aliments subventionnés par l'État. Elle craque, elle, quand elle comprend que sa présence, avec son bébé, est devenue un poids économique trop lourd pour sa mère et qu'elle va devoir partir pour la Colombie afin que tous puissent manger.
Luisa, commissaire de police à la retraite, a élevé son petit fils, Rosmit Mantilla ; leader étudiant d'opposition, il a été emmené dans la prison des services de renseignements, l'Hélicoïde. ‘’Des perquisitions, j'en ai fait dans ma carrière, on ouvre tout, on renverse les tiroirs. Eux, ils n'ont rien ouvert et, comme par miracle, l'inspectrice a trouvé une enveloppe pleine d'argent dans sa chambre.’’ Elle sanglote, elle, à la pensée qu'elle ne le reverra jamais, lui dont l'audience au tribunal a déjà été repoussée 24 fois. ‘’On demande à Dieu, mais Dieu est sourd, il ne se passe rien.’’
Luisa, commissaire de police à la retraite. Son petit-fils, un leader étudiant de l'opposition a été arrêté.
Apparaît enfin Olga, témoignage le plus rare, dont le fils a été tué lors d'une des mal-nommées ‘’Opérations de libération du peuple’’ (OLP). Un commando est entré par effraction et a abattu son fils de 16 ans, dans le noir : « J'ai vu son corps se soulever 4 fois quand ils lui tiraient dessus. Et quand la lumière s'est rallumée, celui qui avait tiré m'a dit : Ce n'est pas le jeune qu'on cherchait.’’ Olga se bat pour faire reconnaître cette horreur, qu'on ne peut même pas qualifier d'erreur puisque le commando était là pour tuer de toute façon, comme toujours lors de ces opérations soi-disant ciblées contre les délinquants. D'après un rapport de l'ONU, entre juillet 2015 et mars 2017, 505 personnes ont été tuées lors de ces ‘’OLP’’, dans la plus totale impunité. Le rapport souligne qu'elles ne parlent presque jamais de blessés : que des morts et des arrestations.
Le film serre le cœur, parce que le cynisme absolu du pouvoir y est finement montré, grâce à des interventions de ministres ou de Maduro lui-même à la radio, qui serinent que tout va bien. Ensuite, parce qu'il est filmé avec un amour évident. Avant les premières images, le micro a capté les grillons, orchestre imperturbable de la nuit de Caracas. Une oreille attentive reconnaîtra plus tard la musique entêtante des petits vendeurs mobiles de glace.
Lorsqu'Eva dévale les rues en pente du bidonville de Petare à l'arrière d'un taxi-moto, les bicoques de brique colorée défilent, grappes de guirlandes lumineuses à la nuit tombée. La caméra s'attarde sur la verdure des collines de Caracas, décor luxuriant qui a survécu aux Espagnols, à l'indépendance, aux tonnes de balles et aux litres de gaz lacrymogènes tirés dans la ville. Elles démentent la mégalomanie de Simón Bolívar, dont la phrase légendaire est peinte sur le mur d'une place du centre-ville, devenu un coupe-gorge : ’’Si la nature nous résiste, nous la combattrons et nous ferons en sorte qu'elle nous obéisse.’’ L'image s'abreuve enfin des vagues, sur la côte, dans lesquelles Olga, mère éplorée à la peau cuivrée, puise la force de se battre, à défaut d'y trouver la paix.
Olga. Son fils a été tué sous ses yeux. Une "erreur"...
Mais ce qui émeut le plus, c'est la certitude que la situation du pays, filmé en 2106, a dramatiquement empiré depuis. « On essaie d'aider nos enfants à se développer au mieux, malgré les circonstances », explique bravement María José, et il n'est pas interdit de penser qu'elle ne dirait plus cela aujourd'hui, où l'inflation a atteint 18 000 % selon le FMI. L'espoir d'une vie décente a déserté le pays, la réélection de Maduro, non reconnue par la communauté internationale, le 20 mai, a été vécue comme un non-événement par une population dont la seule préoccupation est de manger et qui a massivement refusé de se déplacer pour voter.
« La population vénézuélienne est en dépression », assène Margarita Cadenas, très émue, après la projection de son film, à l'issue d'un après-midi sur le Venezuela à l'Assemblée nationale, à Paris. Pour quelque 4 millions de personnes depuis 2015, sur 30 millions d'habitants, l'exil est devenu la seule solution, leurs familles dépendent de leurs transferts d'argent. ‘’On a besoin de l'aide internationale ; ce film, je l'ai fait pour que le monde entier connaisse notre situation’’, supplie-t-elle. Elle rejoint en cela tous ses compatriotes persuadés que leur pays ne s'en sortira pas seul.
‘’La convocation de élections anticipées a été faite par intérêt politique’’, a déclaré la Conférence épiscopale du Venezuela (CEV) le 15 mai dans un communiqué signé par Mgr Jose Luis Azuaje Ayala, évêque de Barinas et président de la CEV. ‘’L’élection est illégitime pour l’institution qui l’a convoquée’’, écrivaient les évêques qui dénoncent la situation dramatique dans leur pays : ‘’Jour après jour, nous entrons dans une spirale de conflits qui trouvent leur propre racine dans les pénuries généralisées de nourriture, de médicaments, d’eau, d’électricité, de transports, dans l’insécurité et l’inflation en augmentations.’’
Dans un entretien à un journal italien, Mgr Jaime José Villarroel Rodriguez, évêque de Carúpano (État de Sucre, nord-est), et Mgr Enrique Pérez Lavado, évêque de Maturin (État de Monagas, au nord-est), avaient rappelé que la mission de l’Église est d’accompagner le peuple. « L’Église est la seule institution à être encore crédible parce qu’elle est proche des gens et parle avec clarté », avait déclaré Mgr Villarroel. C’est pour cela que le cardinal Jorge Liberato Urosa Savino, archevêque de Caracas, dans son homélie du dimanche 20 mai dernier, a supplié les prêtres et diacres de « ne pas descendre de la croix », en fuyant le pays. Selon un prêtre de la capitale, ‘’depuis septembre dernier, quatre jeunes prêtres et au moins quatre diacres » du diocèse de Caracas sont partis vers l’Espagne ou l’Amérique du Nord. De leur côté, les évêques vénézuéliens se sont dressés fermement en juillet contre le gouvernement, qu’ils ont décrit comme une ‘’dictature’’. Le gouvernement redouble d’efforts pour faire taire cette voix dissonante. L’épiscopat fait désormais bloc contre le gouvernement, au risque d’être parfois assimilé à l’opposition politique. Une accusation que l’Église récuse fermement.
Au contact de jeunes gens téméraires et généreux en formation
DE CHAQUE INSTANT
Documentaire Français de Nicolas PHILIBERT – 2018
 Au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers de La Croix Saint-Simon à Montreuil (93), on suit le quotidien des étudiants : les cours où ils apprennent la théorie, les travaux pratiques où ils simulent les soins sur des mannequins ou sur leurs collègues de formation, et les stages où ils font face à la réalité de vrais patients ; et enfin, le retour de stage et les échanges avec les formateurs qui permettent de mettre en valeur tous les aspects de la relation soignant/soigné. Certains en reviennent convaincus d’avoir choisi la bonne voie alors que d’autres se mettent à douter de leur orientation…
Au sein de l’Institut de formation en soins infirmiers de La Croix Saint-Simon à Montreuil (93), on suit le quotidien des étudiants : les cours où ils apprennent la théorie, les travaux pratiques où ils simulent les soins sur des mannequins ou sur leurs collègues de formation, et les stages où ils font face à la réalité de vrais patients ; et enfin, le retour de stage et les échanges avec les formateurs qui permettent de mettre en valeur tous les aspects de la relation soignant/soigné. Certains en reviennent convaincus d’avoir choisi la bonne voie alors que d’autres se mettent à douter de leur orientation…
Le documentariste Nicolas Philibert suit dans De chaque instant des élèves infirmiers qui assimilent, tâtonnent, échouent et surmontent de dures épreuves. Avec tact et finesse, il met la douceur de son regard au service d’une idée du soin altruiste et basée sur le respect et la tolérance. Alors que neuf de ses films ressortaient en salles à la fin de l’été (La Ville Louvre 1990, Être et Avoir 2002, Nénette 2009…), le cinéaste a livré, dans ce film, ce qu’il a découvert et appris au contact de ces jeunes gens téméraires et généreux.
Qui n’a pas vécu l’angoisse de l’hôpital ? Qui ne s’est pas raccroché un instant à la douce assurance de la présence d’une infirmière ? Nicolas Philibert a d’abord vécu dans sa chair les aléas du métier : une embolie l’a envoyé aux urgences puis aux soins intensifs. De cette expérience éprouvante, il a voulu tirer un long-métrage documentaire. Comment apprend-on le métier en 2018 ? Un an de tournage au milieu de la presque centaine d’élèves de l’Institut de Formation en soins infirmiers de la Croix Saint Simon à Montreuil et de leurs profs, tous ex-infirmières et infirmiers.
Le film est d’une incroyable vitalité. Pour la première fois, on se met dans la tête de ces soignants toujours présents qui s’efforcent de soulager et répondre quand le toubib est déjà passé à autre chose. Ils font de leur mieux, s’inquiètent, se sentent malmenés… Ce sont des jeunes gens de 18-20 ans, et quelques autres dans la cinquantaine, en reconversion, qui, pendant trois ans, suivent les cours, approchent les malades et se racontent. Ce dernier aspect est le plus poignant. A leur formateur référent, ils confient leurs doutes, leurs chocs, leurs difficultés, leurs enthousiasmes…
Pas d’intervention du cinéaste. Juste une observation attentive. On lit la vulnérabilité, l’empathie, le chagrin, le soulagement… Les stages auprès des vrais patients sont aussi pleins d’enseignements. Une chaleur, une spontanéité, une vérité dure transparaissent à tout moment. Impossible de ne pas se projeter dans ces jeunes en blouses blanches.
Le cinéaste capte avec sa rare sensibilité les premiers pas des jeunes élèves infirmières et infirmiers. Le primat de la parole sur la description brute ouvre à une réalité complexe et riche.
‘’En civil, c’est différent. Il y a moins le sentiment de domination’’, dit à un moment un jeune homme. La parole est flottante, en construction. Cette remarque, qui pèse subitement de son poids de réel, est faite au fil d’un dialogue avec une responsable de formation, à l’issue d’un stage. Nous les suivons sur le même mode, au long du film articulé en trois parties, chacune introduite silencieusement par un cartouche portant un chiffre et un ou deux vers: «1. Que saisir sinon qui s’échappe ?»; «2. Que voir sinon qui s’obscurcit ?»; «3. Que désirer sinon qui meurt ?/Sinon qui parle et se déchire?».
Le chapitre inaugural pose la première pierre d’une découverte initiatique. Un groupe de jeunes filles et de quelques jeunes garçons accomplit ses premiers gestes, entre fous rires et maladresses, prise de tension, exercices cardiaques et entraînements à la piqûre sur des mannequins… la distribution de vêtements se fait sur le même ton léger et recueilli. Les cours insistent sur la déontologie, le respect du malade, le refus du mercantilisme et des logiques de rendement. Les gestes, la tenue, la règle: il sourd de cette ouverture, dans une ambiance encore collective et scolaire, quelque chose de l’ordre du sacré, que rendent les vers d’Yves Bonnefoy (Extraits de son poème Aux arbres).
Comme le jeune poète, ces élèves d’aujourd’hui ont à regarder en face la maladie, la vie ou la mort, entre lesquelles ils vont avoir à jouer leur rôle. La seconde partie va les voir partir se confronter à ce réel-là, dans des services, avec de vrais malades et des professionnels de santé qui les accompagnent. Premiers pas, premières erreurs. Le dernier chapitre, ou la dernière strophe, comme on voudra, tient le pari d’emmener le spectateur jusque là où s’affrontent les effets délétères d’une logique comptable face au dévouement et à la richesse humaine qui se révèlent à chaque plan.
Les restitutions de stages se succèdent entre quatre murs. L’exiguïté n’est pas la seule cause de l’utilisation de deux caméras pour les champs/contre-champs. Il n’y a pas de deuxième prise possible face à ce qui dit et se joue là. La transmission, enjeu sensible ici, met aux prises deux partenaires. Le cinéaste a un art unique pour capter l’authenticité la plus nue des êtres et permettre au spectateur d’accéder sans effraction à cette intime vérité. La caméra se fait oublier – ce qui suppose une confiance gagnée bien en amont avec les acteurs. Le montage joue d’une dialectique buissonnière, avec ses moments d’échappée, de poésie et d’émotion qui refusent de se laisser prendre en otage par le pathos.
Au-delà de la réalité d’un métier dont les enjeux économiques font peser sur les aides-soignants de nombreuses pressions, Nicolas Philibert a souhaité ‘’donner à entendre la parole de ces futurs soignants voués à rester dans l’ombre’’, et, confrontés très tôt à la fragilité humaine.
Dans la dernière partie du film on assiste aux entretiens privés des reprises de stages avec leurs ‘’référents’’. Un espace sans témoin où la parole se libère : désir, fatigue, injustice, … loin des tensions, les vannes s’ouvrent, et même quelques pleurs apaisent. L’émotion est profonde et nous renvoie comme par un effet miroir à notre propre vulnérabilité.
Presque tous les étudiants ont acceptés d’être filmés, même dans des situations qui ne sont pas à leur avantage. Ils savent que pour faire ce portrait collectif, tout se joue là, au plus près de la parole, de chaque instant. Merci à eux tous et merci à Nicolas Philibert pour ce beau moment de cinéma.
Novembre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
L’univers des ouvriers de l’ancienne Allemagne de l’Est
UNE VALSE DANS LES ALLEES
Film Allemand de Thomas STUBER - 2018
 Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu un membre de la grande famille du supermarché. Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer…
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu un membre de la grande famille du supermarché. Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer…
Second long-métrage de Thomas Stuber, Une valse dans les allées est l’adaptation d’une nouvelle de Clemens Meyer, In the Aisles. L’auteur et le réalisateur ont travaillé ensemble à l’élaboration du scénario, afin de tirer, d’un récit aussi court, un film de deux heures. Sandra Hüller tenait le rôle principal de Toni Erdmann (2016) et Franz Rogowski incarnait le fils perturbé d’Isabelle Huppert dans Happy End (2017).
Ce drame social, aux effluves profondément mélancoliques et poétiques, décrit avec grâce et pudeur, à travers les yeux de son héros principal, toujours à la limite du basculement, l’univers des ouvriers de l’ancienne Allemagne de l’Est. La nuit, il n’y a plus de clients et les supermarchés se transforment. Les employés chargés d’approvisionner les rayons s’emparent de ces lieux gigantesques, propices à une poésie de l’espace et à la romance. On le comprend dès la scène d’ouverture, avec les chariots élévateurs qui s’élancent comme des ballerines robotisées sur l’air de la célèbre valse viennoise de Johann Strauss, le Beau Danube bleu. Dans un tournoiement gracieux, chacun s’affaire à sa tâche. C’est le cas de Christian, jeune homme timide et discret (interprété par Franz Rogowski) qui découvre, jour après jour, les allées qu’il parcourt. Il fait profil bas, jusqu’à rabattre ses manches sur ses tatouages, pour que personne ne vienne surprendre son passé. Bruno, le chef de rayon en charge de sa formation, a lui aussi quelques secrets. Avec lui, le courant passe bien. Christian éprouve un coup de foudre en découvrant Marion, la charmante responsable du rayon confiserie. Le cœur de Christian bat la chamade quand la belle surgit parmi les boîtes de conserve et de lait concentré.
L’hypermarché discount où se déroule le film évoque aussi les univers acidulés de Jacques Demy. Qui aurait cru que le cinéma parviendrait un jour à enchanter ces temples de la consommation ordinaire et à les transformer en romance exotique ? Et surtout, à mettre tant d’humour entre les étals ? Car le film se change en véritable comédie humaine quand les caristes s’affrontent entre eux, comme si chaque rayon était une terre à conquérir, avec sa culture propre, ses codes et ses conflits géopolitiques, ses alliés et ses ennemis, ses secrets d’Etat… Ainsi, les employés des conserves ne fréquentent pas ceux des surgelés (surnommés les Sibériens), ni ceux des boissons… Et, si Christian se met à fréquenter Marion, c’est comme si Roméo fréquentait Juliette… Mais que raconte, au fond, cette guerre larvée ? Probablement, que pour se sentir vivre dans un lieu si déshumanisé, où règnent la solitude et le chacun pour soi, il faut déployer son humanité, faire exploser les tempéraments, présenter son caractère et ses humeurs comme autant de spécificités qui l’emportent sur les marques de fabrique. Car, c’est un état des lieux des effets du capitalisme et de la société de consommation à l’allemande que Thomas Stuber dresse devant nos yeux éblouis. Ce supermarché n’est qu’un laboratoire in vivo et la comédie romantique qui s’installe sur le devant de la scène est un parfait appât pour nous conduire vers une conclusion bien plus grinçante. A force de s’attacher à Christian, Marion et Bruno, on en oubliait de regarder les ombres inquiétantes qui rôdent entre les tas de marchandises colorées. Enivrés par les ballets chorégraphiés comme dans une comédie musicale, la dimension claustrophobe des allées ne nous sautait pas aux yeux. C’est discrètement que cette adorable love story s’est déportée vers un cinéma plus amer, par un revirement qui rapproche Une valse dans les allées de Toni Erdmann (2016). La passerelle entre les deux films étant ouverte par la présence de la géniale Sandra Hüller et la même complexité psychologique des personnages, attacants parce qu’ils nous ressemblent.
La quiétude apparente du film recèle une profonde mélancolie sur la vie. Le spectateur apprend que derrière la propagande européenne qui a voulu faire de la réunification allemande l’exemple même de l’accouchement de la modernité, des myriades de vie, celles qui n’ont pas la parole, ont perdu le sel de ce qui faisait leur bonheur de vivre. Il faut assurément appuyer le courage d’un réalisateur qui prend la tangente inverse des discours officiels en regardant au plus près, en quoi les décisions publiques bouleversent des existences entières. En ce sens, Une valse dans les allées fait presque figure de film politique. Derrière cette apparente sobriété de la mise en scène, se cache une réflexion dense et aboutie sur l’état des ouvriers, à la façon d’une œuvre de Kaurismäki, qui préfère, à la violence des images et à la rugosité d’une dénonciation, la douceur d’un poème.
Novembre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Quand les relations humaines sont empreintes de mystère et d’ambiguïté
BURNING
Film sud-coréen de Lee CHANG-DONG – 2018
 Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. S’instaure alors un triangle amoureux des plus troublants. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps…
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. S’instaure alors un triangle amoureux des plus troublants. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps…
Huit ans après son dernier film (le très beau Poetry qui gagna le Prix du meilleur scénario en 2010), le Coréen Lee Chang-Dong est de retour sur la Croisette avec une fiction qui exploite son sujet de prédilection : le parcours rédempteur de personnages de laissés-pour-compte. En adaptant la nouvelle Les Granges brûlées, du Japonais Haruki Murakami, le cinéaste propose un film qui mêle la description d’une vie quotidienne déprimante et un thriller à l’inverse exaltant. A travers les yeux du personnage de Jongsu, on partage un discours social alarmant montrant que Lee Chang-Dong cherche à emmener son cinéma vers une réalité qui dépasse le seul naturalisme attendrissant.
C’est plus précisément la passivité de Jongsu face aux évènements qui nous permet de nous identifier à lui, bridés que nous sommes dans notre impuissance de spectateurs. Le fait de partager son point de vue a pour conséquence de mieux faire ressentir sa frustration devant l’idylle qui naît entre Haemi, cette jeune fille dont il est discrètement amoureux, et Ben, un beau gosse fortuné dont il ne sait rien. On accompagne ainsi ce garçon, dont la vie est déjà si peu glorieuse, et qui se retrouve obligé de tenir la chandelle dans ce classique triangle amoureux.
Après tout, n’est-il pas courant que les relations humaines soient empreintes de mystère et d’ambiguïté ? Mais plus le récit avance, plus il devient évident que ce triangle amoureux comporte plus d’angles que prévu, rendant sa nature véritable difficilement identifiable. Jongsu va s’y heurter. L’espoir alimente la combustion de son cœur et l’incite à ne pas se résigner : Haemi lui reviendra-t-elle ?
Le cinéaste n’hésite pas à prendre son temps pour nous offrir quelques scènes intimistes d’une grande beauté lyrique et nous permettre de mieux approfondir son personnage principal. Par exemple, en le montrant présent au procès de son père, ou essayant vainement d’écrire un roman dans l’esprit de son modèle littéraire William Faulkner, il nous permet de mieux comprendre le caractère indécis de ce jeune homme, qui n’arrive pas à trouver une direction à donner à sa vie. On pourrait penser qu’il représente en réalité Lee Chang-Dong lui-même, qui ne sait pas où mener son film, mais ce n’est pas le cas.
Contre toute attente, c’est finalement Ben qui va le libérer de cet état léthargique. A mi-parcours du récit, c’est par la force d’une étonnante révélation, suivie de la disparition de Haemi, que le personnage de Jongsu, mais aussi par extension le rythme du film, va sortir de sa torpeur. La peur et la méfiance que lui inspirent Ben, cet homme issu d’une classe sociale supérieure à la sienne deviennent alors le moteur de Jongsu, qui se met à courir stérilement après ses propres phobies, à défaut d’avoir su agir au moment où il l’aurait pu pour regagner le cœur de son amie.
Burning est d’autant plus fascinant qu’il nous plonge dans une Corée du sud authentique, avec des allusions à la situation politique en arrière-fond (les voix lointaines qui surgissent de la radio ou de la télé font un écho inquiétant à la politique de Donald Trump aux USA et dévoilent l’importante hausse du chômage en Corée du sud). On découvre aussi que la ferme des parents de Jongsu se situe juste à la frontière avec la Corée du nord. On sent que la rivalité entre Jongsu et Ben s’intensifie ; autour d’eux, le monde bouillonne et semble leur échapper. L’arrogance de Ben, qui pontifie en faut de ses immeubles, montre qu’il se considère comme au-dessus des lois. Quant à Jongsu, il est clairement perdu ; il dit lui-même que ‘’le monde reste un mystère’’ à ses yeux. Même quand le film vire au thriller psychologique, le cinéaste poursuit son étude des conflits de classe en Corée du sud, où les disparités sociales sont la source d’un affrontement inévitable. Le film évolue dans une ambiance de plus en plus étouffante et Jongsu, à bout de souffle, évolue entre imaginaire et réalité. Que sortira-t-il de son enquête ? La résolution du mystère de la disparition de Haemi ou simplement l’exploitation de ce récit pour les besoins de son roman. Passant des dernières chaleurs de l’été, avec une magnifique séance de danse sur fond de soleil couchant sur une musique de Miles Davis, aux premiers froids de l’hiver, Burning ne laisse pas de doute sur l’issue fatale du récit, dont le développement agit comme une brûlure lente et incurable.
Burning » ne raconte rien d’extraordinaire. Il ne prend pas fait et cause pour la querelle du moment. Il ne cherche pas à prendre en otage nos sentiments ou nos émotions. Non, Burning est un film humble. Il s’intéresse à une chose simple et qui nous touche tous. Son histoire est banale, mais elle nous est ouverte. On ne nous impose rien. On nous laisse y respirer et y ressentir. Pas de leçon. Pas de message. Juste un partage. Ce film est tellement… coréen. Et je crois qu’au fond c’est ça qui différencie tant le cinéma coréen naturaliste du cinéma français naturaliste.
Le film brasse les genres, joue sur les ruptures de tons, passant du film d'amour au drame existentiel en passant par le thriller. Il suit le parcours d'un jeune coréen et son incapacité à agir sur les évènements et sur ses proches. A la faveur d'un évènement, le film va basculer dans l'interrogation et montrer du doigt la fragilité de ce que l'on construit. Le mystère est la sensation que semble rechercher le réalisateur en construisant son film en réverbération et en poussant le spectateur à s'interroger sur ce qu'il a vu. C'est un film étrange, fascinant, très sombre sur le devenir de la jeunesse coréenne.
Octobre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Film sur l’écologie
qui décrit combien l’homme a besoin d’amour et d’eau fraîche pour vivre
WOMAN AT WAR
Film Islandais de Benedikt ERLINGSSON – 2018
 Qui commet des actes de vandalisme contre les pylônes électriques islandais ? La mystérieuse ‘’femme des montagnes’’ n’est autre qu’Halla, chef de chorale en semaine et militante écolo à ses heures. Elle veut éviter que sa belle île, convoitée par des multinationales comme le leader mondial de l’aluminium, Rio Tinto, ne soit défigurée. Jusqu’au jour où son combat se retrouve chamboulé par l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie …
Qui commet des actes de vandalisme contre les pylônes électriques islandais ? La mystérieuse ‘’femme des montagnes’’ n’est autre qu’Halla, chef de chorale en semaine et militante écolo à ses heures. Elle veut éviter que sa belle île, convoitée par des multinationales comme le leader mondial de l’aluminium, Rio Tinto, ne soit défigurée. Jusqu’au jour où son combat se retrouve chamboulé par l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie …
En Islande, la guérilla environnementaliste est prise très au sérieux pour les autorités et les personnalités du pays, comme la chanteuse Björk qui est ouvertement contre les projets de constructions hydro-électriques ; ceux-ci représentent une brèche par laquelle des groupes étrangers peuvent s’infiltrer. Halla, l’héroïne, n’est pas prête à l’accepter. Quand elle ne chante pas avec les élèves de sa chorale, elle part saboter méthodiquement des pylônes électriques.
C’est une activiste joyeuse et sympathique, autant capable de pratiquer le taï-chi dans son appartement que de faire capoter un marché en cours entre l’industrie locale de l’aluminium et une firme chinoise. Le contrat est tellement intéressant que les autorités considèrent le vandalisme des installations comme un acte de terrorisme, faisant de la ‘’femme des montagnes’’ l’ennemi public n° 1. Il faut savoir que 85% de la production hydro-électrique islandaise est destinée à des entreprises étrangères qui ne paient pas d’impôts localement …
Le programme d’Halla se complique le jour où elle reçoit un courrier des services sociaux l’autorisant, après de longues années d’attente, à adopter une petite fille, orpheline ukrainienne. Elle doit donc choisir entre son engagement politique et son désir d’être mère. A moins que le fait d’être responsable d’une enfant ne l’amène à veiller d’autant plus sur l’état du monde et la défense de la nature …
Comme son héroïne, la réalisatrice Benedikt Erlingsson est une force de la nature. Pour présenter son personnage, Halldora Geirhardsdottir déploie une énergie sidérante, qui rappelle celle de Bruce Lee dans ses films d’aventure ; elle échappe aux hélicoptères, courre des heures sur des terrains accidentés, se cache dans les glaciers et abat un drone à l’arc !
Woman at war est un film qui échappe à tous les clichés et qui colle à son époque, ce qui le rend si attachant. D’autant plus que la question de la reconnaissance des femmes est vigoureusement posée par des mouvements comme ‘’Me Too’’ : en abattant le drone, c’est la société matriarcale qu’Halla cible. Erlingsson ne pouvait pas imaginer rendre un plus bel hommage à sa mère, pionnière de grandes causes comme l’égalité des salaires entre hommes et femmes, dans les années 1930.
Mais le sujet de fond du film reste l’écologie et, par extension, l’écologie de l’espoir et de l’amour. Quand Halla affirme travailler pour l’avenir de la planète et celui de sa fille adoptive (elle dira : ‘’Je ne suis pas une criminelle. Au contraire !’’), c’est parce qu’elle sait que l’homme a besoin d’amour et d’eau fraîche pour vivre. Et ce ne sont pas les barrages hydro-électriques qui provoquent les plus beaux coups de foudre.
Cette comédie fougueuse et pleine d’allant est aussi un excellent plaidoyer pour les causes féministes et écologistes. Ce film audacieux se déploie dans d’immenses cieux, à travers des paysages époustouflants, ses couleurs sont chaudes. Aussi poétique que politique, sans manichéisme. Un grand bol d’air, un vrai coup de cœur à partager.
C’est ainsi qu’au milieu de décors de toute beauté, le film prend des allures d’intrigue policière. Bénéficiant d’une mise en scène alerte, le récit nous entraîne à la poursuite de celle qui fait figure de terroriste aux yeux des autorités. Poursuivie par des drones ou des hélicoptères, elle escalade les collines, se cache dans des fossés, se revêt de peaux de bêtes afin de nous plonger dans une ambiance poétique du plus bel effet, propre à nous ramener sans violence ni drame vers le cœur du sujet, qui n’est autre que la défense de ces contrées vierges. Ni les gags exagérément répétitifs de l’arrestation d’un jeune touriste étranger transformé en bouc émissaire, ni les apparitions récurrentes d’un groupe de musiciens surgissant à l’improviste à l’arrivée d’un moment significatif, ne parviennent à voiler l’humour décalé de ce film écologiquement drôle, bien servi par la prestation impressionnante de son actrice principale : elle incarne à merveille ce personnage vengeur, dont la détermination calme rallie immédiatement le spectateur à sa cause, ce qui fait tout l’intérêt de ce film d’action poétique.
Aborder un sujet aussi crucial avec autant de légèreté a été le pari de Benedikt Erlingsson : le résultat est excellent.
Octobre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Chef d’œuvre sur le harcèlement scolaire
d’une bouleversante profondeur et d’une grande créativité visuelle
SILENT VOICE
Film d’animation de Naoko YAMADA – 2016
 Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille… Silent Voice est adapté du manga du même nom, écrit par Yoshitoki Oima et paru en 2015. Sorti en 2016 au Japon, le film est le premier long-métrage réalisé par Naoko Yamada. Il a reçu de nombreux prix, dont un Mainichi Film Award et le Prix du Meilleur film d’animation de l’année par l’Académie du Japon. Silent Voice aborde un sujet sensible, mis en lumière depuis en France : le harcèlement scolaire. Un chef d’œuvre de l’animation japonaise, d’une bouleversante profondeur et d’une grande créativité visuelle.
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille… Silent Voice est adapté du manga du même nom, écrit par Yoshitoki Oima et paru en 2015. Sorti en 2016 au Japon, le film est le premier long-métrage réalisé par Naoko Yamada. Il a reçu de nombreux prix, dont un Mainichi Film Award et le Prix du Meilleur film d’animation de l’année par l’Académie du Japon. Silent Voice aborde un sujet sensible, mis en lumière depuis en France : le harcèlement scolaire. Un chef d’œuvre de l’animation japonaise, d’une bouleversante profondeur et d’une grande créativité visuelle.
Silent Voice est donc le premier long-métrage d’une jeune réalisatrice japonaise très prometteuse : Naoko Yamada. À seulement 33 ans, la cinéaste n’a rien à envier aux grands de l’animation japonaise. En témoigne ce récit brutal racontant l’histoire d’amour tragique entre Ishida, un jeune homme impulsif et violent, et Nishimiya, une adolescente sourde et muette qui rêve d’amour et d’amitié.
Le récit est construit sur deux temps : le premier, qui ne dure pas plus d’une demi-heure (sur plus de deux heures de projection), se déroule à l’école primaire : Nishimiya est une nouvelle élève. Elle connaît la langue des signes, mais pas ses camarades. Alors, pour communiquer avec eux, elle leur demande de lui écrire dans un cahier de conversations. Mais si Nishimiya essaye de s’intégrer, de parler à voix haute comme les gens ‘’normaux’’, sa différence effraie ses camarades, et particulièrement Ishida, qui l’humilie à longueur de journée, jusqu’à passer en conseil de discipline.
La second temps est celui des remords et de la rédemption : Ishida a décidé d’apprendre la langue des signes et de retrouver Nishimiya dans l’espoir de se faire pardonner. Mais toujours le passé plane au-dessus de leurs têtes comme une ombre, comme un nuage noir près de se déchirer en orage. Les enfants sont devenus des adolescents. Séparés pendant cinq ans, ils se retrouvent mais se déchirent encore, alors que Ishida peine à adresser la parole à celle qu’il avait persécutée. Beaucoup lui reprochent de vouloir à tout prix soulager sa conscience. Pourtant, tout comme Nishimiya que son handicap met à l’écart de la société malgré le soutien de sa sœur et de sa mère, Ishida va mal. Si mal qu’il fait plusieurs tentatives de suicide ; si mal qu’il ne parvient plus à vivre avec les autres, et à les regarder en face : leurs visages existent sans exister, dissimulés par une croix violette.
C’est ce parcours sur le chemin de la guérison psychologique et du pardon que Yamada dessine pendant deux heures qui, bien qu’un peu longues parfois, sont très riches visuellement : si les personnages évoluent dans un cadre réaliste, l’onirisme ne manque pas. Des lumières vives en gros plans ralentis sur les visages qui se reconnaissent, de souvenirs douloureux en moments d’apaisement sous les arbres fleuris, le rêve et la réalité se confondent à tel point que parfois l’on peine à les distinguer. Mais il y a surtout l’espoir d’un amour sincère et inavoué entre Nishimiya et Ishida, entravé par le poids du passé, de l’isolement et de la culpabilité.
Le harcèlement scolaire est un sujet d’actualité qui reste cependant tabou, que l’audiovisuel a pourtant pris à bras le corps depuis longtemps déjà. On se souvient du Carrie (La vengeance, 1976) de De Palma, et plus récemment, de la série 13 Reasons Why (Série TV de Brian Yorkey, 2017), qui a largement contribué à un nouvel éveil des consciences ces deux dernières années. Dans la même lignée, Silent Voice est un film éprouvant, sans complaisance avec ses personnages, tous mal dans leur peau, cependant que la beauté fantastique de l’animation, revigorante et apaisante, rappelle sans cesse que tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.
Cette vérité de l’échange, Ishida finit par la comprendre le jour où il retrouve Nishimiya : sa manière d’entretenir le bruit autour de lui, de la persécuter en railleries lorsqu’ils étaient enfants, reflétait la peur du vide, l’angoisse profonde de ne pas être à sa place. En revanche, obtenir l’assentiment du groupe des élèves de sa classe, avait de quoi le rassurer… même s’il fallait se montrer cruel pour l’obtenir. Silent Voice est une œuvre émouvante, qui marque par la richesse de ses thèmes, que ce soit le handicap, le harcèlement ou, plus généralement, l’intégration dans la société. Avec une grande justesse, où le silence est d’or, il décortique le processus qui amène un groupe à désigner ce qui le gène. Mais il dévoile aussi le chemin qui conduit, peu à peu, à s’ouvrir au monde et à y trouver sa place, en même temps qu’on reconnaît celle des autres. Les personnages, pleins de contradictions et de sentiments mêlés, ont une envergure que l’on retrouve rarement dans les films d’animation, ce qui nous conduit à suivre, avec une tendresse décuplée, leur chemin de vie dans toute sa complexité. Et, finalement, dans cette coquetterie qu’a Nishimiya de relever ses cheveux, en laissant apparaître son appareil auditif, elle domine son handicap : Ishida a fait le pas de l’écouter, elle fera celui de s’assumer
Octobre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Film sur l’intrusion de la criminalité dans le quotidien des Italiens.
DOGMAN
Film italien de Matteo GARRONE – 2018
 Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens, discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce…
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens, discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce…
Désormais grand habitué du Festival de Cannes où ses trois précédents films ont été présentés et même souvent récompensés (Gomorra, Prix du jury en 2008, Reality, Grand Prix en 2012 et Tale of Tales, bredouille et injustement décrié), Matteo Garrone revient à la thématique de son excellent Gomorra, à savoir l’intrusion de la criminalité dans le quotidien des Italiens. Cette fois-ci ce n’est plus la mafia, telle une entité abstraite et omnisciente, qui représente cette menace, mais un individu seul, tout aussi effrayant. Peut-être même plus encore…
Le récit s’inspire d’une histoire vraie survenue dans les années 80. C’est celui d’un toiletteur pour chiens, qui dirige un chenil dans un quartier populaire, que l’on qualifiera aimablement de lugubre, bien loin de l’image éclatante de Rome qu’en donne Paolo Sorrentino (Dans L’ami de la famille – 2007, où Geremia de'Geremei, 70 ans, se présente en usurier, monstrueusement laid, sale, riche et radin, cynique et ironique. Il a un rapport morbide et obsessionnel avec l’argent. Tout le rend malade, sa mère, l'argent, les femmes, en somme toute la vie... C'est pour cette raison qu'il a l'impression d'être seul. Et pourtant il ne l'est pas. Tout le monde est avec lui. Nous sommes tous avec lui). Marcello, cet homme tranquille, sombre progressivement dans une spirale infernale sous l’influence d’un voyou qui terrorise tout le voisinage, par la seule force de ses poings et de ses coups de boule, distribués à foison.
Le schéma faustien, consistant à développer comment ce rapport de force s’est installé, semble tout tracé à la lecture du récit. Pourtant, Garrone préfère consacrer du temps à l’observation du quotidien peu reluisant de Marcello, sur un style qui renvoie à ses illustres modèles néoréalistes.
Ce quadragénaire, père d’une fille d’une dizaine d’années, sans que l’on n’en sache plus sur la mère, compense sa solitude au contact des chiens. Marcello Fonte lui prête un physique à part, des traits rabougris, comme à l’âge d’or de la comédie noire (Affreux, Sales et Méchants, d’Ettore Scola vient immédiatement à l’esprit), mais une fois de plus, on pense également à L’ami de la famille de son homologue Paolo Sorrentino.
Dans ce quotidien à l’écart du monde, décrivant une situation sociale sinistre, le récit vire littéralement à l’horreur dès que survient le personnage de Simoncino, brute épaisse dans un monde pathétiquement réel. Amateur d’ultra violence, ce que lui permet aisément sa carrure de lutteur, ce cocaïnomane conduit Marcello sur une voie qui n’est pas la sienne, celle d’une dégénérescence brutale. Le scénario pèche un peu sur la justification de leur soi-disant amitié, car la relation de dominant-dominé apparaît comme déjà actée dès la première apparition.
Les faiblesses de scénario de cette première partie introductive sont cependant vite atténuées par la finesse du cinéaste quand il s’agit de décrire les effets du forcené dans cet environnement. A la fois monstre de terreur pour tout le monde, il exerce un pouvoir de fascination sur Marcello qui n’arrive pas à exister aux yeux des autres. C’est donc moins le carcan de la violence qui se referme sur cet homme pathologiquement timide que le jeu des regards qui intéresse Garrone : le regard que porte la société sur Marcello, celui de Marcello sur le monde, et ceux portés sur le terrifiant Simoncino.
A partir de là, Matteo Garrone réussit à mettre au point une effrayante image des rapports humains, bâtie autour de l’éternelle loi du plus fort, à l’image des chiens dans la cage qui passent leur temps à aboyer les uns sur les autres, avec agressivité. De ce tableau désenchanté, l’élément le plus perturbant est évidemment le jeu de Marcello Fonte qui, tel un chien battu, dissimule ses émotions derrière son sourire nigaud. L’absence d’enjeux psychologiques dans la relation entre ces deux personnages, semblables à David et Goliath, la rend un peu trop mécanique, ce qui est, à mon avis, la plus grosse limite de cette première moitié du scénario.
L’évolution de Marcello le conduit néanmoins vers une prise de conscience, après un séjour en prison qu’il subit pour avoir couvert Simoncino, qu’il croyait être son ami et dont il attend toujours un minimum de reconnaissance. Dès lors, le film se referme davantage sur un engrenage de violence, pourtant dénoncée par le réalisateur, qui va jusqu’à mettre en scène un meurtre graphique relevant du torture-porn . Un passage qui en amusera certains mais qui révulsera les autres, une séquence qui est néanmoins indispensable pour capter l’ampleur de l’avilissement subi et la volonté de finalement renverser le rapport de force.
Dogman peut alors être vu comme le constat accablant que la sauvagerie la plus désabusée se traite par une brutalité identique et déshumanisante. Le film explore la métaphore animale jusqu’au bout, jusque dans un plan final signifiant, chargé de nihilisme. Mais c’est surtout dans l’interprétation politique que cette oeuvre choc prend tout son sens, puisque Matteo Garrone nous offre surtout à voir le peu d’alternative dont jouit le peuple italien aujourd’hui pour se libérer de l’asservissement d’un pouvoir fasciste. Est-ce la réponse du cinéaste aux récentes élections italiennes et à l’émergence au plus haut niveau du populisme ? C’est assurément grâce à ce message politique à peine dissimulé que Dogman était en lice pour la Palme d’Or. Avec ce conte macabre, le réalisateur italien Matteo Garrone explore brillamment les recoins les plus obscurs de notre humanité et offre à son acteur, Marcello Fonte, le prix d'interprétation masculine. L'acteur est époustouflant de talent dans ce film où il incarne avec subtilité et fragilité ce Charlot transalpin qui lui a valu ce Prix. L’autre star du film, c’est le brutal Simoncino, joué par Edordo Pesce : une masse de violence en survêtement jaune, qui ravage tout sur son passage. Sa présence est inoubliable à l’écran. La caméra de Garrone enferme le drame dans une banlieue de Naples, qui ressemble aux débris d’un théâtre antique et qui donne à son film une apparence démente de tragédie grecque. Malgré son titre canin, Dogman ne laisse aucun doute. Il ne fait que parler des hommes et des tourments qui les obsèdent.
Septembre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Il s'agit d'histoires dramatiques, souvent désespérées et rarement avec un « happy end », où des individus vont se retrouver à la merci de sadiques pervers agissant en solo mais aussi quelquefois en groupe. Les victimes seront soumises à toutes sortes de brutalités, de tortures et autres atrocités qui les mèneront généralement à une issue fatale. Ces éléments font donc de ces films un exemple-type du cinéma d'exploitation.
Portrait de la condition faite aux femmes iraniennes,
doublé d’une réflexion sur le pouvoir
TROIS VISAGES
Film Iranien de Jafar PANAHI – 2018
 Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice, avant de se suicider... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice, avant de se suicider... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.
Bravant la justice de son pays, Jafar Panahi est allé imaginer une fiction qui lui permet d’interroger les responsabilités de son statut d’homme célèbre. Et même si sa réalisation bricolée n’a rien de novatrice, le cinéaste n’a visiblement rien perdu, ni de son envie de modernité, ni de son talent.
Malgré son interdiction de quitter le territoire iranien et de tourner des films, Jafar Panahi résiste à travers son cinéma. Après Taxi Téhéran (2015), il tourne Trois visages présenté en compétition au 71e Festival de Cannes, qui lui a offert le Prix du scénario, ex-æquo avec Lazaro Felice d’Alice Rohrwacher. Beaucoup de citoyens iraniens cherchent réellement à établir un contact avec des personnages du cinéma ; c’est un phénomène qui a explosé, en Iran, avec le développement des réseaux sociaux. Jafar Panahi signe ici son quatrième film en huit ans. Aux côtés de l’actrice Behnaz Jafari, il joue son propre rôle dans une histoire truffée de plans en hommage à Abbas Kiarostami, son mentor disparu. On repère ainsi des clins d’œil à ses films : Le goût de la cerise (1997), Où est la maison de mon ami (1987), Ten (2002) …A travers trois figures d’actrices, le cinéaste propose un portrait en coupe de la condition faite aux femmes par la société iranienne, doublé d’une réflexion sur le pouvoir et les ambiguïtés des images.
Le nouveau film de Jafar Panahi commence par une vidéo tournée avec un téléphone, que la célèbre actrice iranienne Behnaz Jafari reçoit un soir sur son portable. Ce petit film au format réduit montre une jeune actrice débutante qui se filme, se confie et annonce qu’elle va se suicider parce que tout le monde, dans sa famille et sa belle-famille, s’oppose à sa vocation artistique.
La vidéo provoque une crise d’angoisse chez la grande comédienne Behnaz Jafari (qui joue son propre rôle), à qui ce message était vraisemblablement adressé. A la place du conducteur se trouve J.Panahi (également dans son propre rôle), bonhomme et sage, consulté pour juger de la ‘’véracité’’ technique des images et des propos tenus. La conversation qui s’ensuit emprunte le vocabulaire de la critique de cinéma, qualité du montage, vraisemblance, alors que la voiture roule en direction du village pour tenter de retrouver la jeune femme, Marziyeh, et tirer cette histoire au clair.
Les conditions de réalisation de Trois Visages sont imprécises, et à son propos, l’actrice Behnaz Jafari expliquait, lors de sa venue à Cannes, au journaliste de Télérama que le tournage s’était fait «presque à la sauvette, pour pouvoir terminer le travail et rentrer sains et saufs», alors que le dossier de presse signale «un changement d’attitude» du gouvernement. Jafar Panahi insiste «sur le fait qu’on l’autorise désormais à filmer comme il l’entend dans son pays». Quoi qu’il en soit, son statut de ‘’cinéaste empêché’’ colore chacun des films qu’il a pu tourner depuis 2010.
De fait, le film semble se poser la question de l’après : comment tourner après l’interdiction de filmer dans son pays ? Comment poursuivre après la mort de Kiarostami, en juillet 2016 ? En réponse, J. Panahi ébauche les contours d’un certain cinéma iranien, qu’on pourrait appeler ‘’kiarostamien’’, fait de jeux autour des notions de réalité et fiction, de conditions de tournage empêchées, de questionnements sur le rôle du cinéma, les assemblant dans un dispositif complexe et subtil.
Arrivées à destination dans le village de la jeune fille, les deux artistes sont reconnus par les villageois qui leur adressent tout un tas de demandes contradictoires, déçus que le cinéma ne puisse pas faire pour eux ce que le pays ne peut pas non plus leur donner (par exemple, fournir une alimentation en électricité correcte). Tout en admirant la star de la télé qu’est Jafari, qu’ils sollicitent pour divers prétextes, ils ont par ailleurs rejeté Shahrzad et Mirzayeh avec un machisme des plus rétrogrades. Mais un taureau blessé, couché en travers de la route, empêchera les artistes de repartir chez eux et ils décideront de retourner au village pour aider la jeune fille. Tout ce qui advient à partir de ce moment est une merveille, le mystère et l’indécision se dissipant pour le mieux ; mais Panahi semble moins à l’aise dans cette ambiguïté que ne l’était son mentor.
Coincées dans ce lieu, comme les habitants le sont dans leurs traditions et la peur du regard des autres, les deux stars vont arpenter le village, allant chez l’un puis chez l’autre, provoquant un enchaînement de courtes aventures où tout le monde joue un rôle, illustrant les rapports ambigus que le pays entretient avec son cinéma. A mesure que la nuit tombe, le village se transforme en un petit théâtre : son dédale de murs et de courettes fournit autant de scènes à Behnaz Jafari pour jouer son apparition : devant un café, dans la cour d’une maison… Behnaz Jafari passera la nuit devant la maison de Shahrzad qui est avec Mirzayeh, et c’est l’occasion d’une belle séquence du film : les trois femmes, vues en ombres chinoises, en train de danser en ondoyant derrière un grand rideau.
A ses côtés, Behnaz Jafari joue aussi son propre rôle, celle d’une actrice populaire. Elle vient demander l’aide de son aîné pour démêler le vrai du faux dans cette vidéo qu’elle a reçue. Ils se dirigent vers le village de la supposée défunte (l’est-elle vraiment ou est-ce un canular pour attirer la star et pourquoi ?) au volant d’un véhicule qui sert de studio à Jafar : c’est le décor préféré du réalisateur, ce qui représente à la fois le mouvement et l’enfermement.
Trois visages dessine subtilement un nouvel autoportrait de l’artiste, cette fois dans l’Iran profond, agité par les questions relatives à la condition de la femme. Les « trois visages » du titre sont en effet ceux de trois héroïnes, à différents stades de la vie : Marziyeh, l’adolescente empêchée, Behnaz, la citadine autocentrée, Shahrzad, la vieillarde recluse - une ancienne gloire du cinéma d’avant la Révolution, dont on ne verra jamais les traits. Leur malheur, nous dit Panahi en substance, est celui de l’Iran actuel, dont l’immobilisme en fait un mort en sursis. Et leur véhicule continue à progresser à travers des sentiers étroits, comme une métaphore exemplaire du chemin qui reste à parcourir.
Septembre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Histoire d’une jeune fille contrainte de prendre l’apparence d’un garçon
pour pouvoir vivre et travailler en Afghanistan
PARVANA,
UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN
Film Irlando-Canadien de Nora TWOMEY – 2017
 En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car, sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ni ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture…
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car, sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ni ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture…
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon, afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et sur l'imagination face à l'oppression.
Nora Twomey est cofondatrice et directrice de la création au studio Cartoon Saloon. Elle supervise le développement de l’ensemble des projets de la société. Elle a réalisé des courts métrages, plusieurs fois primés, et coréalisé le long métrage d’animation Brendan et le secret de Kells (2009). Elle a supervisé l’écriture du deuxième long métrage de la société, Le Chant de la mer (2014). Parvana, une enfance en Afghanistan est son premier long métrage réalisé en studio.
L’actrice Golshifteh Farahani est Parvana. Elle a été choisie pour être la voix française de Parvana. Ce choix n’est pas anodin. Elle a grandi en Iran pendant la guerre et à elle-même choisi de se raser la tête et de se déguiser en garçon pour pouvoir marcher librement dans les rues, ‘’être invisible’’. En 2008, elle devint la première actrice iranienne à tourner à Hollywood. Depuis, elle n’est plus la bienvenue dans son pays et elle a dû s’installer en Europe.
Ce film d’animation remarquable est une adaptation du best-seller jeunesse de Deborah Ellis, féministe et militante pour la paix. Elle a écrit Parvana et de nombreuses autres œuvres de fiction et documentaires pour les enfants à travers le monde. Son dernier livre, Sit, raconte les histoires de neuf enfants et les situations dans lesquelles ils se retrouvent. Deborah Ellis est une fervente porte-parole des plus démuni(e)s et consacre une importante partie des revenus de ses livres à des associations qui agissent pour les droits des femmes et des enfants dans le monde.
En partant des témoignages de réfugiés afghans, qu’elle a recueillis au cours de ses voyages au Pakistan à la fin des années 1990, elle a donné à son livre Parvana une matière précieuse : une dimension documentaire qui approche un sentiment d’immersion, qu’elle a su conserver. Bien loin des récits d’aventure de la littérature enfantine, qui pullulent dans le cinéma d’animation, Parvana apporte une grande authenticité. Et la réalisatrice, Nora Twomey, n’a pas pour autant fait l’impasse sur la part d’enchantement et d’onirisme nécessaire pour séduire son public. Parvana entremêle deux histoires. Celle d’une jeune fille contrainte de prendre l’apparence d’un garçon pour pouvoir vivre et travailler, et celle, féérique, que son père a inventé pour elle, autour d’un prince, Souleyman, qui doit combattre le méchant Roi Éléphant. Au fil du récit, Parvana suggérait des détails, des touches de magie, que son père incorporait à son histoire. A elle maintenant de trouver la fin du conte, maintenant que son père s’est fait arrêter et emprisonner.
Ces deux histoires conduisent à la même nécessité, celle de devoir prendre ses responsabilités. Tant pis si la vie n’est pas vraiment un conte de fées : elle vaut la peine qu’on y mène des batailles pour défendre sa dignité. Cette vérité est habitée par des personnages courageux et déterminés. Parvana ne cherche pas à l’édulcorer : si le film utilise un graphisme tout en douceur, le monde de ses héros n’échappe pas à l’emprise des Talibans qui se resserre et les étouffe. Il ne cherche pas à occulter la réalité, faite de crimes et de châtiments ignobles. Nora Twomey ramène toujours son propos à l’idée de privation. Devenue un garçon, Parvana découvre bien les privilèges de la partie masculine de l’humanité, mais elle n’en tire pas d’autre bénéfice que celui de tout tenter pour permettre à sa famille de survivre et à son père de sortir de prison. Cet Afghanistan-là, celui où la guerre gronde au loin, où le mariage arrangé peut devenir une monnaie d’échange, celui de la suspicion et de la surveillance continuelle, ne laisse pas de répit ni de temps libre à la jeunesse, que ce soit celle de Parvana ou celle de sa copine Shauzia qui utilise le même stratagème qu’elle. Toutes deux découvrent qu’elles ont franchi une frontière émancipatrice dans la révolution intime qu’elles ont osé vivre. Mais la source du plus grand émerveillement de Parvana se trouve dans son imagination et dans son courage, pour prolonger le conte commencé par son père et lui donner une existence réelle. Elle le raconte maintenant à son petit frère, en prenant pleinement sa place de référent masculin dans sa famille. Et c’est dans ces séquences où les rôles sont inversés que le film rappelle, qu’au-delà du contexte politique et social du pays, cette histoire d’héroïne raconte celle de la victoire de la condition féminine.
Tout juste récompensée du Prix du public et du Prix du jury au Festival du Film d’animation d’Annecy, lancée en séance spéciale à Toronto en septembre dernier, nommée à l’Oscar du meilleur film d’animation en mars 2018, cette pépite sort enfin en France. C’est une histoire forte et puissante. Mise en scène avec précision par Nora Twomey donc, d’après le roman de Deborah Ellis, dont celle-ci a elle-même livré une première adaptation, puis qu’Anita Doron a scénarisée et finalisée, tandis qu’Angelina Jolie a aidé à mener à bien le côté production du film. Elles se sont toutes unies pour mettre en lumière le parcours d’une fillette qui repousse les limites d’un régime répressif qui bannit les femmes. Avec comme fil rouge la résistance, ce conte des temps modernes épate. Il ose raconter au plus grand nombre, en particulier au public des enfants, le contexte afghan et les dangers de tout extrémisme, grâce à l’identification à Parvana qui, ses yeux magnifiques, en amandes et aux iris vert émeraude, posent un regard plein d’espérance sur l’existence.
Éloge de l'évasion par l'imaginaire et la ténacité, qui permettent à la lumière d’être plus vaillante que les ténèbres, Parvana nous emporte grâce à une héroïne attachante et au lien puissant qui l’unit à sa famille. Son courage n'est pas sans rappeler celui de la bien réelle Malala, cette adolescente pakistanaise, qui faillit bien mourir en 2012 sous les balles des talibans, pour avoir simplement milité en faveur de la scolarisation des femmes. Le rythme parfait du film, entre pauses oniriques, humour et action, n'élude ainsi guère une certaine gravité qui nous inciterait à conseiller ce dessin animé aux plus de 8 ans. À l'heure où l'Afghanistan semble bien loin encore d'être débarrassé de l'obscurantisme des fous d'Allah, cette belle histoire fait vibrer nos cœurs par son humanisme résistant. On vous le recommande chaudement.
Septembre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Ce documentaire retrace les étapes cruciales de la vie du leader non-violent,
KING De Montgomery à Memphis
Documentaire de Ely LANDAU,
filmé par Joseph L. Mankiewicz et de Sidney Lumet - 1970
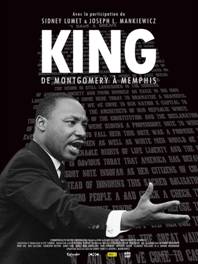 Depuis le boycott des bus de Montgomery en 1955 et l’une des premières actions inspirées par Martin Luther King, jusqu’à son assassinat, le 4 avril 1968 à Memphis, le chantre de la cause noire n’a jamais cessé d’œuvrer en faveur d’une reconnaissance de l’égalité des droits entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Ce documentaire retrace, de 1955 à 1968, les étapes cruciales de la vie du leader non-violent, prix Nobel de la Paix en 1964, qui prononça devant plus de 250.000 personnes un discours resté célèbre, commençant par ces mots : ‘’I have a Dream…’’. Réalisé par Ely Landau, deux ans après l’assassinat de Martin Luther King à Memphis, avec la collaboration de Sidney Lumet et Joseph L. Mankiewicz, King : de Montgomery à Memphis fut diffusé dans près de 500 salles aux États-Unis, le 20 Mars 1970. La restauration récente du film, réalisée par The Library of Congress en collaboration avec Richard Kaplan (producteur associé), permet aujourd’hui de découvrir cette œuvre pour la première fois au cinéma en France. Le travail de restauration a été réalisé grâce à des éléments fournis par le MOMA (New-York), d’après le négatif original.
Depuis le boycott des bus de Montgomery en 1955 et l’une des premières actions inspirées par Martin Luther King, jusqu’à son assassinat, le 4 avril 1968 à Memphis, le chantre de la cause noire n’a jamais cessé d’œuvrer en faveur d’une reconnaissance de l’égalité des droits entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Ce documentaire retrace, de 1955 à 1968, les étapes cruciales de la vie du leader non-violent, prix Nobel de la Paix en 1964, qui prononça devant plus de 250.000 personnes un discours resté célèbre, commençant par ces mots : ‘’I have a Dream…’’. Réalisé par Ely Landau, deux ans après l’assassinat de Martin Luther King à Memphis, avec la collaboration de Sidney Lumet et Joseph L. Mankiewicz, King : de Montgomery à Memphis fut diffusé dans près de 500 salles aux États-Unis, le 20 Mars 1970. La restauration récente du film, réalisée par The Library of Congress en collaboration avec Richard Kaplan (producteur associé), permet aujourd’hui de découvrir cette œuvre pour la première fois au cinéma en France. Le travail de restauration a été réalisé grâce à des éléments fournis par le MOMA (New-York), d’après le négatif original.
Ça commence par un geste banal, une révolte individuelle, un refus : Rosa Parks ne cède pas sa place à un Blanc dans un bus. On connaît ce début, on sait la suite, le lent combat du pasteur King pour l’égalité des droits. Peut-être s’imagine-t-on qu’on n’a plus rien à apprendre de cette lutte qui nous paraît lointaine, dans le temps et dans l’espace. C’est pourquoi il faut voir ce documentaire constitué presque exclusivement d’images d’archives brutes et sans commentaires, entrecoupées de textes récités par des acteurs, face à la caméra, filmées par Lumet et Mankiewicz. Le voir, c’est comprendre de l’intérieur ce qu’a été la ségrégation, ce racisme quotidien qui s’exprime par des entrées « Blancs » et des entrées « Noirs », des fontaines « Blancs » et des fontaines « Noirs », le mépris tranquille et le fait de ne pas appeler par leurs noms les Noirs.
Le film montre la singularité de Martin Luther King : non violent face à la haine et l’injustice, et l’on imagine à quel point ce fut difficile de lutter pacifiquement (quelques images montrent que l’action musclée et violente a aussi été préconisée par d’autres), contre tout communautarisme, il a organisé des boycotts et des marches parfois dangereuses (celle de Chicago est proprement effrayante) et toujours du côté de la loi. C’est impressionnant, mais plus impressionnante encore est sa maîtrise de la parole : ses discours utilisent la métaphore, s’appuient sur la réalité quotidienne et, s’ils n’échappent pas à l’emphase, s’ouvrent souvent sur un lyrisme captivant. Quelle langue ! On n’imagine plus aujourd’hui pareil orateur ni pareille vision. Bien sûr, tout le monde a en tête le fameux « je fais un rêve », mais on entendra aussi nombre de paroles fortes qui font du bien : des paroles d’amour, des antidotes efficaces à la peur et à la haine. Quant à son dernier sermon, diffusé à ses funérailles, on l’écoute avec la gorge nouée. Réalisé en 1970, soit deux ans après son assassinat, King : de Montgomery à Memphis n’est pas un film distrayant qu’on regarde sereinement : on y passe sans cesse de l’admiration à la révolte, de l’émotion à la colère. Voir des enfants blancs hurler leur haine et des jeunes nazillons parader n’est pas de tout repos. Lire des pancartes insultantes (« il y a de la place au zoo ») indigne durablement. Plus encore peut-être, cette image fugace d’une jeune femme bon chic bon genre portant un écriteau « L’Alabama aux Blancs » glace le sang.
Réalisé à chaud, le film parvient à retracer les treize ans de ce qu’on pourrait appeler le ‘’ministère public’’ de Martin Luther King. Du boycott des bus de Montgomery, en Alabama, en 1955 jusqu’à sa mort, le 4 avril 1968, l’itinéraire militant du leader noir nous est livré sans ornement. Après une émouvante introduction de Harry Belafonte, ami intime de King, le film se passera de tout commentaire. Restent des images et une voix. Si les premières sont souvent de qualité médiocre, c’est qu’elles ont été prises sur le vif, durant le long combat contre ‘’le racisme comme mode de vie’’, malgré les interdictions policières et les coups portés à la caméra. Leur impact est d’autant plus fort qu’elles ne sont pas apprêtées. Brutes, tremblotantes, ces images de manifestations et de meetings semblent vibrer, comme si elles étaient sous l’emprise de l’émotion des participants. Montées dans leur ordre chronologique, elles montrent la violence de la répression opposée à la force tranquille des manifestants. Malgré les canons à eau, les matraques et les chiens, King et ses partisans paraissent toujours maîtres de leurs nerfs, calmes et certains de leur bon droit.
Au milieu du tumulte, d’une arrestation à une autre, King ne renonce jamais à ses principes de non-violence, même et surtout face à ceux qui lui hurlent au visage leur haine du ‘’négro’’. Dans le combat contre le racisme ordinaire de l’Amérique blanche, qui prônait la ségrégation dans les lieux publics, sa seule arme est la force de son verbe. Le film n’a jamais recours au commentaire près coup et refuse la facilité de la voix off. Seule la voix de King vient rythmer les images
Elle leur donne leur force et leur signification. Orateur de génie, il jette dans la lutte toute son éloquence de pasteur baptiste. Plus de trente ans après, le discours prononcé lors de la grande marche sur Washington impressionne toujours autant. Et quand, deux jours avant sa mort, le Prix Nober de la Paix avoue sa lassitude, sa voix se fait encore plus émouvante. Ce beau film nous la restitue pleinement. Elle reste unique, intacte, vivante !
Face au déferlement de la haine et de la bêtise, les mots et les actes de la résistance passive semblent de peu de poids ; et pourtant, bien des luttes ont été gagnées, même si la fin tragique de King paraît les rendre vaines. Et si longtemps après, on se prend à penser que, dans notre époque où ressurgissent ça et là des viviers de haine, où le racisme a quasiment pignon sur rue et s’étale sur Internet, l’absence d’une figure aussi charismatique et noble se fait sentir. Il est urgent de voir et de méditer ce film dont les trois heures ne doivent pas effrayer, au contraire.
Horrifiés par l'assassinat du leader du mouvement des droits civiques, les cinéastes signent ainsi un puissant pamphlet contre les forces réactionnaires, et présente King comme un homme devenu un symbole. Tourné en noir et blanc, avec l'aide de multiples intervenants (Harry Belafonte, Paul Newman, Charlton Eston, Ben Gazera, Anthony Quinn, Marlon Brando), le film, jusqu'alors inédit en France, montre le charisme extraordinaire d'un guerrier non violent. Incontestablement, c'est l'un des plus grands films militants de l'époque, et, évidemment, il n'a jamais été aussi actuel et nécessaire qu'à l'ère de Donald Trump, pitoyablement et tristement régressive.
Septembre 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Ce film est une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble de la carrière
de Romy Schneider
3 JOURS A QUIBERON
Film Franco-Austro-Allemand de Emily ATEF – 2018
 1981. Pour faire une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michaël Jürgs, du magazine allemand « Stern », pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne, qui se livre sur ses souffrances de mère et d’actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une forme d’espoir et d’apaisement…
1981. Pour faire une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michaël Jürgs, du magazine allemand « Stern », pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne, qui se livre sur ses souffrances de mère et d’actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une forme d’espoir et d’apaisement…
Emily Atef est une réalisatrice franco-iranienne, née à Berlin. Avec sa famille, elle s’installe à Los Angeles à l’âge de 7 ans. A 13 ans, elle déménage en France dans le Jura et, plus tard, elle part à Londres pour travailler dans le théâtre. Puis, elle s’installe à Berlin, où elle vit toujours, pour y étudier la réalisation à l’école de cinéma berlinoise DFFB. Elle a réalisé 4 longs-métrages : Molly way (2005), L’étranger en moi (2008), Tue-moi (2012) et 3 jours à Quiberon (2018).
Robert Lebeck est né en 1929 à Berlin. Il est l’une des principales figures du photojournalisme allemand. Après des études en ethnologie, il décide de se lancer dans la photographie. Il travaille pour différentes agences, dont l’hebdomadaire Stern. Après un passage à Géo, il retourne au Stern pour ne plus le quitter. Il devient célèbre après son reportage intitulé Afrika Im Jahre Null (Afrique année zéro). La photo d’un jeune africain venant de voler l’épée du roi Baudouin de Belgique, lors des célébrations de l’indépendance du Congo, fait le tour du monde. Il se spécialise dans la photo de célébrités, dont Romy Schneider. En 1991, il reçoit le Prix Erich Salomon. En 2002, il reçoit le Prix Infinity pour sa publication KIOSK et aussi, en 2007, le Prix Henri Nannen pour l’ensemble de son œuvre. Il est mort en 2014 à Berlin, à l’âge de 85 ans.
Emily Atef tient l’idée de son film d’un producteur français, Denis Poncet, malheureusement disparu en 2014 : c’était un ami de Marie Bäumer. Celle-ci avait aimé le film d’Emily Atef L’étranger en moi. Sur les photos de Romy Schneider, prises par R. Lebeck, une chose l’a frappée : ce ne sont pas les photos d’une grande actrice impressionnante, mais les portraits sans filtre d’une femme à nu, sans maquillage, absolument pure dans sa détresse. Elle dit : ‘’Cela a fortement résonné avec mon cinéma. Tous les films parlent de ça : une femme, quel que soit son âge, qui traverse une crise existentielle, prise entre ses démons intérieurs et son envie de vivre. Ensuite j’ai lu son interview dans Stern ; elle en donnait très peu aux journalistes allemands, qui n’avaient pas pardonné à leur impératrice Sissie adorée d’être partie en France. J’ai été saisie par la crudité et la vérité de l’interview’’.
Puis la réalisatrice continue : ‘’A l’adolescence, je suis arrivée en pension dans le Jura. Je partageais ma chambre avec une fille qui était obsédée par Romy Schneider, qui était morte quelques années avant. Elle disait : « C’est ma mère, encore plus que ma vraie mère ». Il y avait des posters d’elle partout. Je m’endormais en voyant ces photos, cette femme qui me regardait. Bien sûr, ça me frappait d’autant plus qu’elle était allemande et que j’avais la nostalgie de Berlin. Ce qui est étonnant c’est que, en France mais aussi en Allemagne, elle faisait partie de la famille : tout le monde l’appelait Romy, alors qu’on n’appelle pas Deneuve « Catherine » ou Jeanne Moreau « Jeanne ». Contrairement aux grandes actrices de sa génération, elle n’avait pas d’espace personnel, intime, cet espace vital dont on a tous besoin. Elle se donnait toute entière au public.
Comme spectatrice, j’ai connu d’abord la Romy française. D’ailleurs, j’ai vu les « Sissi » pour la première fois, il y a quelques mois seulement. Parmi ses films, ceux de Sautet sont ceux qui m’ont le plus touchée ; je les ai vus dans mon adolescence. Une histoire simple (1978), c’est magnifique ! Même dans les « Sissi », ces films poussiéreux, conventionnels, elle atteint une profondeur incroyable dans la tristesse et elle exprime aussi une joie de vivre intense… Elle est toujours, toujours dans le vrai.
Romy Schneider a quitté l’école à 14 ans, enchaîné les films ; elle n’a jamais eu une expérience normale de la jeunesse, de l’insouciance. Elle n’avait pas de foyer, de havre de paix. Elle a toujours aspiré à ça : trouver une maison. Au moment où se passe le film, elle venait de divorcer de Daniel Biasini : David, son fils, ne voulait pas vivre avec elle et elle devait beaucoup d’argent au fisc. Elle était en détresse. C’était quelqu’un qui avait des hauts et des bas vertigineux mais ce n’était pas une victime. J’ai été attirée par ça, cette fragilité-là ; c’est un thème que l’on retrouve dans la plupart de mes films.
Pour l’écriture, j’ai rencontré plusieurs fois Robert Lebeck, avant sa mort en 2014. Il a été d’une aide précieuse. Sa femme et lui m’ont donné toutes les pellicules des photos prises à Quiberon. J’avais 600 photos que personne n’avait jamais vues, y compris des photos privées, des photos des autres personnages et des lieux, bien sûr… Un matériau extraordinaire !
Michael Jüges, le journaliste du Stern, s’est montré très disponible. Sa mémoire des évènements était excellente ; il était le plus jeune du groupe et, d’ailleurs, il travaille toujours. J’ai gardé certains passages de son interview, mais j’en ai aussi écrit d’autres. J’avais besoin de cette liberté-là par rapport aux évènements réels pour atteindre la vérité du personnage.
J’ai également rencontré l’amie de Romy Schneider, qui était présente à Quiberon. Elle ne voulait pas que son personnage apparaisse dans le film, elle refusait d’être nommée. Or, je tenais énormément à avoir en contrepoint cette féminité, cette présence issue d’un autre monde que celui du show-business. Je ne voulais pas que le film se résume à « Romy et les hommes », ou « Romy et la presse ». Alors j’ai demandé à cette femme si elle acceptait que j’invente complètement un personnage. Elle a dit oui et c’est devenu Hilde, une copine d’enfance avec qui Romy a une intimité profonde qui remonte à l’Autriche. J’ai écrit le rôle exprès pour Birgit Minichmayr, une actrice formidable. Hilde, c’est un peu moi. Je me reconnais dans son rapport à l’amitié, cette intimité très féminine où on peut prendre un bain ou dormir ensemble. Comme elle, j’aurai envie de dire à Romy d’arrêter de boire, d’arrêter de tout donner à un journaliste hostile, je souffre de voir son autodestruction… Elle a les pieds sur terre, elle est dans la normalité : tout ce que Romy n’a pas et dont elle aurait eu besoin.
Je voulais raconter ces quatre points de vue, monter la perspective de chacun. Et aussi toucher les gens plus jeunes, qui peut-être ne connaissaient pas encore Romy : les problèmes de cette femme qui cherche à tout concilier, sa vie privée, son rôle de mère, son travail. Tout ça est très moderne. C’est aussi un film sur l’éthique. Le journaliste est prêt à tout pour obtenir son interview, mais au bout du compte, ces trois jours changent complètement sa vision des choses : il ne fera plus jamais son métier de la même façon.
Je veux dire aussi un mot de la scène du bar qui est essentielle pour moi. J’ai beaucoup pensé à toutes ces scènes incroyables de bar ou de restaurant dans les films de Sautet. On a l’impression d’en être, on sent presque les odeurs de cuisine. Dans ce bar à Quiberon, j’avais envie qu’on sente la fumée, l’alcool, que le spectateur sorte lui aussi épuisé de cette soirée, qu’il plisse les yeux au soleil du petit matin… J’ai passé mon adolescence dans le Jura. Les bars, la musique, l’ambiance des années 1980, je connais et j’aime ces atmosphères. Nous avons beaucoup travaillé cette scène en amont, chacun de ses détails, tant dans l’écriture du scénario que durant les répétitions. Et puis, sur le tournage, on a laissé les choses se faire d’elles-mêmes, et le tempo s’est imposé, le mouvement s’est lancé. Je voulais aussi montrer une Romy sur le fil. Quand le personnage de Denis Lavant (le journal Stern a parlé de « pécheur dandy », mais c’était en fait Glenmor -1931-1996- un grand poète breton, qui était aussi un activiste indépendantiste) lui dit : « Vous êtes Madame Sissi », elle pourrait lui jeter son verre au visage… et puis non, elle a envie de s’amuser, de parler, de vivre, elle ne veut surtout pas rester seule avec ses démons, alors elle se jette dans la fête… La série des photos de Lebeck sur cette soirée est dingue : c’est la plus fournie de tout le week-end et, sur beaucoup d’entre elles, on voyait ces jeunes. Ce n’est bien sûr pas anodin qu’elle parle aussi franchement avec ce jeune garçon qui, pour moi, symbolise son fils (ce fils avec elle n’arrive plus à parler). Il a plus ou moins le même âge, alors elle veut tout lui donner.
Les personnages que je montre sont tous inspirés de la réalité. Et cette base factuelle très riche, les photos de Lebeck et l’interview du Stern, m’a permis de me sentir plus libre dans mon inspiration, d’aller plus loin encore dans la fiction et l’invention. A chaque fois que j’y retournais, de nouvelles idées, comme des pulsions de fiction, arrivaient.
Lors de mes premières rencontres avec Robert Lebeck, je lui ai dit : « Quand même, c’est terrible, elle est tellement en détresse et, en plus, elle se casse le pied lors de la séance de photos ! ». Il m’a répondu : « Pas du tout, c’est parfait pour elle ! ». Et il a jouté : « Le jour où je suis venu à Paris lui apporter l’interview, je ne l’avais jamais vue aussi en paix avec elle-même, si belle et si sereine ».
Je me suis dit que personne ne pouvait lui enlever ça. Quelle que soit la suite de l’histoire, personne ne peut lui prendre ce moment de grâce et de paix intérieure. Dans mes films, je vais souvent assez loin dans l’enfer intime, et j’ai à la fin toujours besoin de trouver une lueur d’espoir, même minuscule, un brin de lumière qui transperce les rideaux… Je voulais finir avec cet espoir, quitter Romy dans un moment de lumière …’’
Il faut dire qu’elle est attachante, cette femme qui se dévêt de ses oripeaux de star pour accueillir à sa table avec la même familiarité un poète, qui l’appelle pourtant « Madame Sissi » ou un jeune garçon venu s’entretenir avec elle, nous offrant par la même occasion la plus belle scène du film, qui révèle une Romy Schneider rayonnante et avide de croquer la vie. L’insatiabilité du journaliste à pousser l’actrice dans ses retranchements afin d’obtenir un article au goût de scandale fait patiner le scénario à mi-parcours. Fort heureusement l’intervention d’un quatuor composé de personnalités aux caractères affirmés et aux perspectives diversifiées lui permet de retrouver un semblant d’équilibre. Il n’empêche que l’on peut reconnaître à la jeune réalisatrice/scénariste le talent de restituer pleinement et sans excès la complexité d’un personnage touchant de grâce et de détresse. Ne se contentant pas de sa ressemblance physique troublante avec Romy Schneider, Marie Bäumer adopte avec une précision étonnante ses gestes et expressions. Nul doute que son jeu délicat est pour beaucoup dans la réussite de ces instants savoureux de cinéma.
Désireuse de respecter l’effet brut et sensuel des photos de Robert Lebeck (ami et confident de Romy Schneider) à l’initiative de ce projet, la réalisatrice entoure sa mise en scène d’une photographie en noir et blanc de toute beauté, qui renforce ainsi la sobriété de son œuvre. Si cette confession sidérante semble bien être le prélude à la fin tragique que l’on connaît, c’est dans un rayon de lumière que l’on quitte celle qui, au-delà de sa stature de star européenne, se définissait comme une femme malheureuse et alcoolique.
A partir de la vie des quatre amies ce film japonais
médite sur l’intimité de leurs sentiments
SENSES
Film japonais de Ryûsuke HAMAGUCHI – 2015
 A Kobe au Japon, quatre femmes trentenaires, Akari, Sakurajo, Fumi et Jun, sont d’inséparables amies. Elles se retrouvent souvent pour déjeuner, participer à des ateliers pendant leurs temps libres ou tout simplement pour se raconter leurs vies. Elles partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles… Quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles des autres…
A Kobe au Japon, quatre femmes trentenaires, Akari, Sakurajo, Fumi et Jun, sont d’inséparables amies. Elles se retrouvent souvent pour déjeuner, participer à des ateliers pendant leurs temps libres ou tout simplement pour se raconter leurs vies. Elles partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles… Quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles des autres…
Senses est un film fleuve de 5h 17 qui, pour sa présentation au public, est décliné en cinq épisodes, chacun représentant un des cinq sens. Avec cette œuvre Ryûsuke Hamaguchi s’inscrit dans une nouvelle génération de cinéastes japonais. A l’origine, le film devait s’appeler Happy Hour. Primé en 2015 au festival de Locarno, ce long film arrive en salles. En cinq épisodes, il médite sur l’intimité des sentiments, à partir de la vie des quatre amies, dont l’une va disparaître. Une révélation.
A quoi rêvent les femmes japonaises d’aujourd’hui ? A avoir plus de temps pour elles. Senses leur donne le temps nécessaire pour se rencontrer et se retrouver dans cette belle chronique d’émancipation.
Au Japon, 100.000 personnes disparaissent chaque année sans laisser de traces. On les appelle ‘’les évaporés’’. C’est ce que va devenir Jun après avoir prononcé son divorce, laissant ses trois amies dans un grand désarroi. Sa disparition va entraîner un séisme, en chacun d’elles, les amenant à questionner leur amitié et leurs vies respectives. Car Jun était le pilier du groupe, celle qui leur avait permis de se rencontrer toutes les quatre.
![]()
Le cinéaste donne une ouverture imprévue à la situation en libérant, de façon quelquefois violente, une parole qui avait été longtemps retenue. Sans actes violents, le chamboulement émotionnel n’en est pas moins intense. Il provoque des bouleversements intérieurs qui vont amener les personnages à se poser des questions essentielles, et même à changer la destinée de chacune, parce que les réponses qu’elles y apportent se libérent du carcan moral imposé par la société.
Comment aimer ? Peut-on avoir confiance en l’autre ? Doit-on tout se dire ? Ai-je la vie que je souhaite vraiment ?... Autant de questions qui reflètent bien la confusion affective dans laquelle baignent nos sociétés. Senses les remet au centre, tout en rappelant que ces interrogations personnelles ne peuvent se résoudre que dans le cadre d’une interaction sociale, quelle qu’en soit la forme. Pour éviter des réponses toutes faites, Hamaguchi prend le temps de faire une analyse collective, notamment par le biais du séminaire qu’organise un artiste activiste, sur un thème contemporain ; ‘’Écouter son centre’’, auquel les quatre amies décident de participer. Cet atelier va provoquer des effets cathartiques imprévus.
Le cinéaste suit avec grâce les déplacements, les émotions qui traversent un regard, le geste qui accompagne une attention, comme lors de cet atelier au milieu d’une résidence d’artiste où Jun, Akari, Fumi et Sakurako se retrouvent invitées à poser leur tête contre le ventre d’un(e) autre, ou à coller leur front contre celui d’un autre pour échanger - sans mot dire - une pensée. Sakurako dit :’’J’essayais d’écouter les autres et les autres m’écoutaient.’’ et Jun : ‘’Simplement toucher les autres, ça m’a fait du bien.’’ Et la caméra, par un subtil changement de focale, comme une transmission de pensée, quadrille les corps comme un chorégraphe attentionné envers les danseuses qu’il fait évoluer. Deux têtes se poussent, d’autres s’effacent dans un nuage de flou. Plus loin dans le film, à contre-jour, une silhouette noire se détache du ciel, pareille à un découpage contre le bleu du ciel, où il ferait bon de s’installer nous aussi pour y goûter nos émotions. Car, dans Senses, la capacité d’écoute de l’un s’accompagne souvent d’une faculté d’entendre de l’autre et de se comprendre mutuellement. Parfois, cette même caméra fait face, frontalement, aux visages de deux êtres qui s’affrontent par un aveu ou un regard. ‘’Ne me regarde pas comme ça’’, dit Sakurako. Le demande-t-elle vraiment à son mari ou bien à nous ?
Chaque personnage va laisser éclore ses traits de caractère et quelques secrets enfouis, dans une série d’actes qui ne seront pas anodins, faisant apparaître les faux-semblants, mettant à jour un système de défense basé sur le mensonge et la dissimulation, liés au statut des femmes dans ce monde qui cherche à les contraindre dans des codes et des schémas patriarcaux.
Hamaguchi semble ici attiré par un cinéma de fiction qui ne se détache pas de la force de captation du documentaire. Il s’est orienté vers ce genre à partir d’un des ses films précédents Voices in the Waves (2013), qui mettait en scène des personnages qui avaient éprouvé le séisme à l’origine de l’accident nucléaire de Fukushima. Il s’attendait à trouver des personnes pétrifiées dans leur individualité à cause de ce qu’elles venaient de vivre, mais il a découvert par ses interviews qu’elles formaient une espèce de voix unique, un chœur libérateur. Cette découverte a été un tel choc pour lui qu’il a eu l’idée de créer une fiction qui dégagerait une même puissance. Il a organisé un atelier, basé sur l’échange et l’expression corporelle, afin de faire émerger ces vérités profondes et collectives en chacun.
Hamaguchi va trouver, dans ces exercices en atelier, les bases de son scénario et les actrices de son film. Ce sont leurs récits qui vont nourrir la vision de la condition féminine qu’il déploie dans Senses, en prenant pour base le quotidien dans ce qu’il a de plus banal et routinier pour explorer ses influences sur les relations, celles du couple en particulier.
La disparition de Jun va agir comme un déclencheur sur Sakurako, Akari et Fumi, en les amenant à se poser la question de leur émancipation. A partir de là, commence un apprentissage qui va retentir sur leurs proches : celui d’écouter, de parler, de ressentir, d’interroger et de suivre son instinct.
Une aventure en cinq épisodes, qui ne sont pas de trop pour explorer le cheminement intérieur de ces quatre femmes et leur rendre une parole qui a été trop longtemps empêchée. Vivre ainsi au plus près des émotions des personnages est un privilège rare. Les formats calibrés des films (en particulier leur durée moyenne) ne le permettent que d’une façon occasionnelle.
A la fin de Senses, on a l’impression de quitter quatre amies proches, avec leurs qualités et leurs défauts. On espère presque une suite à ce roman-fleuve, galvanisant et passionnant.
Senses est bien plus qu’une histoire de femmes qui s’aiment, se lient ou se séparent. C’est aussi un récit qui, par sa construction, sa temporalité et sa finesse, nous invite à respirer au rythme de ces existences qu’il porte à bout de bras. On grandit dans le mouvement de recherche de ces femmes, on respire l’air qu’elles expulsent. On sent les odeurs de peau qui changent, on comprend la difficulté d’endosser son corps, l’envie d’être remarqué, compris. Alors on comprend qu’il ne suffit pas de s’engouffrer dans le premier train venu et d’attendre tranquillement qu’il atteigne sa vitesse maximale pour se rendre compte, le front collé à la vitre et les pupilles rivées aux paysages qui défilent, que le monde cavale, sans forcément nous attendre. Il file avec le temps qui passe (qui nous surpasse), en une seconde comme un grain de sable tombant des doigts, ne nous offrant pas la possibilité de pouvoir tout saisir des innombrables nuances de l’existence, avec ses artères parcourues par le flux de la vie, ses pulsations fugaces, ses possibilités innombrables, ses chemins ouverts. ‘’Les choses ne font que passer devant nos yeux’’, entend-on de la bouche d’une poétesse, avant de conclure : ‘’Nos yeux n’essaient pas assez de saisir ces événements fugitifs’’. Hamaguchi lui y parvient, en apprivoisant le temps et en laissant le temps libre à ces femmes qui en ont besoin, pour mieux se voir, s’aimer, se comprendre et ainsi mieux être vues par les spectateurs qui les ont contemplées longuement.
La révolution canine évuquée dans ce film vise les retrouvailles avec l’homme.
L’ÎLE AUX CHIENS
Film d’animation américain de Wes ANDERSON – 2018
 En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville…
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville…
L’île aux chiens est le second film d’animation de Wes Anderson, après Fantastic M. Fox (2009). Véritable hommage à la culture nippone, le film bénéficie d’un casting vocal de haute volée, tant dans sa version originale que dans sa version française. L’île aux chiens a fait l’ouverture du Festival du Film de Berlin en février 2018, où Wes Anderson a reçu l’Ours d’Argent du meilleur réalisateur.
Wes Anderson a cessé d’être un auteur prolifique pour se faire rare depuis les années 2010. La succession de ses petits films indépendants dans les années 90, avec une famille de cinéma qui s’est imposée d’elle-même, a donné naissance à deux métrages cultes, avec un succès qui a largement dépassé celui des circuits indépendants : A bord du Darjeeling limited (2007) et surtout The Grand Budapest Hotel, son avant-dernier long métrage qui remonte à 2014.
Devenu célèbre, ce cinéaste cannois, mais aussi berlinois, n’a pas oublié la force poétique de ses récits qu’il cultive aussi dans l’animation. Fantastic Mr. Fox a donné naissance à ce que le genre pouvait offrir de plus intelligent, de décalé et d’irrésistible dans le 7e art américain, loin des standards animés d’Hollywood. Un délice que le cinéaste tente aujourd’hui de réitérer, avec cette nouvelle fable pleine d’animaux charmants, mus par la même technique d’animation et avec le même succès.
L’arrière-plan de cette île aux chiens n’a rien d’aussi bucolique que l’aventure de Fox. Dans un environnement de grisailles, le conteur Wes Anderson se met à rêver d’un Japon de songe. Le point de départ est une menace sanitaire de grande envergure, qui menace la civilisation qui se trouve mise en scène à travers une quarantaine de chiens, infectés par un virus qui fait du meilleur ami de l’homme un paria destiné à finir son existence sur une île déserte et couverte d’ordures noirâtres. Il faut imaginer un plan d’évasion !
L’animation et le rapport cruel et magnifique entre l’homme et les animaux domestiques, traités au premier degré et dans des images métaphoriques, donnent lieu à ce qu’Anderson manie le mieux : l’art du détail, des gags insolites, des répliques bien ajustées, dans un univers cotonneux plein de rebondissements surprenants. Les chiens, errants ou domestiques, cruellement abandonnés à leur triste sort, évoquent bien des situations réelles tragiques. Pour ceux qui ont partagé ou qui partagent encore leurs vies avec ces quatre pattes, l’émotion est totale. L’inventivité générale de l’art d’Anderson séduira le public, bien au-delà des amoureux des toutous, avec des références multiples au cinéma nippon notamment, qui sert de décor original à cette œuvre atypique.
La langue est trompeuse chez les humains adultes, où elle est pourtant souvent traduite par une interprète ou sous-titrée. La pureté des sentiments domine dans le rapport d’Atari aux chiens, avec lesquels se noue une forme de compréhension mutuelle. Anderson fait confiance à la seule image et au langage corporel pour traduire ses idées au spectateur qui n’est jamais dérangé par le japonais. Ce sera d’autant plus frappant dans l’amitié qui va se nouer entre Atari et Chief, le chien errant, plus réfractaire à l’homme que ses compagnons. Tout le processus d’apprivoisement mutuel semble faussement reproduire un schéma dominant/dominé entre le chien et l’enfant, mais traduit surtout leur solitude mutuelle et leur besoin d’affection.
Atari lance ainsi un objet que Chief doit rapporter mais ce dernier, peu au fait de ces pratiques, s’y refuse et laissera plus tard l’enfant à son sort. Le geste de l’enfant relevait plus d’une volonté de rapprochement avec l’animal plutôt que d’une volonté de le soumettre ; le retour de Chief amènera à une vraie démonstration d’amour quand Atari lui donnera le bain. L’île aux chiens est un lieu d’exil et de cauchemar, mais aussi un espace dépourvu de l’hypocrisie de la civilisation.
Cette émotion à fleur de peau exprime donc une liberté où l’abandon relève d’un décalage amusé (le nuage que forment les bagarres selon une pure convention de dessin animé) et d’écarts surprenants. Toute la dichotomie d’Anderson entre maîtrise et anarchie se trouve là, notamment dans l’inspiration du cinéma japonais. L’élargissement progressif de l’espace évoque la tradition des estampes naturelles de paysage, notamment dans un magnifique plan d’ensemble où Atari monte sur Chief pour scruter l’horizon dans un soleil couchant. Tout cela vient se rencontrer avec une influence plus occidentale où les décors modernes rappellent la folie de certaines créations de Ken Adam pour les James Bond ou de Kubrick, mais également un sens très fort de la montée du suspense, comme dans la scène où Atari et ses acolytes sont encerclés par l’armée et les chiens robots menaçants.
Wes Anderson livre donc un récit étonnamment engagé, la métaphore entre les humains migrants et les chiens étant évidente, mais sans en rester à cette seule interprétation puisque les maltraitances scientifiques faites aux animaux sont évoquées. L’anarchie et la maîtrise forment un tout dans la personnalité de Wes Anderson, qui évite au final un regard unidimensionnel dans l’univers qu’il dépeint. Une sorte de naïveté lui permet d’entrevoir la possibilité de surmonter la haine lors du final, mais également de retrouver ce lien affectif et domestique qui lie le chien à son maître, enfin réunis. La révolution canine évoquée dans ce film ne vise pas la vengeance mais les retrouvailles avec l’homme. Une fable foisonnante, touchante et ludique pour cette nouvelle réussite de Wes Anderson.
Juin 2018 J.-C. d’Arcier
La grande intrigue de ce polar est celle de l’humanité dans sa quête éternelle.
EVERYBODY KNOWS
Film Franco-Italo-Espagnol d’Asghar FARHADI – 2018
 A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui…
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui…
Everybody Knows est le 8e long-métrage d’Asghar Farhadi, et le second qui se situe hors de l’Iran, son pays natal. Depuis quelques années, le réalisateur croule sous les récompenses : Ours d’Or à Berlin et Oscar du Meilleur film étranger pour Une séparation, Prix d’interprétation féminine pour Bérénice Bejo dans Le Passé (2013), Pris du scénario et Prix d’interprétation masculine pour Le client. Everybody Knows était présenté en ouverture du festival de Cannes 2018 et figurait dans la compétition officielle – un doublet rarement réalisé. Il faut dire que Farhadi se montre particulièrement brillant dans l’horlogerie de son scénario, démontant les jeux d’apparence comme autant de rouages d’une pendule à remettre à l’heure. Après une incursion en France avec Le Passé, c’est maintenant en Espagne que le cinéaste iranien déploie son histoire à suspense, en nous rappelant que le cinéma est un outil riche et malléable, qui permet de s’émanciper des frontières pour mieux réunir les cultures. Le réalisateur, fidèle à ses obsessions, met en place une mécanique implacable qui dévoile peu à peu le poison des liens familiaux et des apparences. Tout se joue dans l’empreinte que laisse l’absence ; celle-ci pèse de plus en plus lourd car elle n’est jamais résolue. Contrairement à une disparition brutale et définitive, l’absence introduit dans l’esprit des fantômes qui réapparaissent par moments : on pense à l’absence de l’amour, qui renvoie Laura et Paco à la fragilité des faux-semblants qu’ils ont présenté jusque là. Et puis, il y a Irène, victime malgré elle de ce que tout le monde savait (c’est le titre du film), de l’absence de résolution d’une histoire dont elle est le cœur, et que le surgissement d’un évènement inattendu va révéler.
Nul manichéisme chez Farhadi, qui révèle toujours les failles d’hommes et femmes que l’on pense irréprochables, tout en trouvant une excuse à ceux qui semblent en apparence malveillants. On retrouve ces constantes dans Everybody knows : une adolescente est subitement enlevée le soir d’un mariage, le rapt entraînant la douleur et le désarroi d’une mère rattrapée par un passé de rancœurs familiales et amoureuses. Car plusieurs membres de l’entourage ont pu avoir intérêt à effectuer l’enlèvement et à demander une rançon, à commencer par le père, resté en Argentine, et dont on apprend qu’il a de graves problèmes financiers. Mais une vengeance sentimentale, ou l’aigreur d’un clan, pourraient tout aussi bien être à l’origine du drame. Avec cette trame policière, Farhadi a préféré emprunter la voie de la tragédie pour analyser les effets de l’enlèvement sur des protagonistes qui ont du mal à cicatriser leurs plaies : ils se dévoilent sous un autre angle, sans que le spectateur ne cesse de les trouver attachants. « Je ne compte pas transmettre nécessairement un message à travers mes films. Si des spectateurs de n’importe quels lieux du monde, de n’importe quelle culture et langue, aux caractères très divers, parviennent à éprouver de la sympathie pour mes personnages sans pour autant les connaître, s’ils peuvent s’imaginer à la place de l’un d’entre eux, j’aurai atteint mon objectif », a déclaré Asghar Farhadi dans le dossier de presse.
Cette aptitude à créer un lien entre le public et des personnages contrastés est toujours réelle chez le réalisateur, qui manie en outre les ruptures de ton avec subtilité : on citera le contraste entre la fausse harmonie communautaire du début du film (la fête de mariage) et la tournure que prend le récit lorsque l’aigreur et la méfiance se substituent à la solidarité. Mais le scénario n’est pas exempt d’invraisemblance, à l’image de ce personnage d’ancien policier, ami de la famille, qui vient apporter son aide face à la nécessité de ne pas alerter la gendarmerie.
Asghar Farhadi propose une œuvre captivante par sa capacité à tenir en haleine et à faire douter son public jusqu’au bout. Il donne ici un portrait détaillé des mœurs espagnoles, à travers des scènes de groupes remarquables ; des gens ordinaires se retrouvent dans une situation extraordinaire. Tourné en Espagne et en langue espagnole, le film Everybody knows met en scène Pénélope Cruz (Laura) et Javier Bardem (Paco), Ricardo Darin (Alejandro), Elvira Menguez (Mariana), dans un thriller rural et familial. Leurs jeux, très physiques et intériorisés, nous amènent à nous demander si, finalement, la grande intrigue, dans laquelle nous entraîne ce polar, ne serait pas tout simplement celle de l’humanité dans sa quête éternelle.
Juin 2018 J.C. Faivre d’Arcier
Ce film d'illustre les déchirements de l'Allemagne d'après guerre
et la révolution menée par des jeunes en 1956.
LA REVOLUTION SILENCIEUSE
Film allemand de Lars KRAUME – 2018
 Allemagne de l'Est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.
Allemagne de l'Est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.
Le titre peut paraître un peu pompeux mais Passe ton bac d'abord ! n'aurait pas fait très sérieux. Le nouveau film de Lars Kraume n'est pas une comédie. Il met en scène une histoire vraie que Dietrich Gartska a relatée dans un livre autobiographique (Das Schweigender Klasszimmer - La Classe silencieuse) : ‘’J'ai vraiment commencé à m'intéresser au livre de Gartska lorsque j'écrivais le scénario de Fritz Bauer, un héros allemand, explique le cinéaste. Je m'interrogeais déjà sur ce qu'avait dû être la vie en Allemagne après le IIIe Reich. Au fond, les deux films se demandent comment l'Allemagne a pu aller de l'avant après un tel cataclysme, comment le pays a pu se frayer un chemin, de cette terrible histoire vers un avenir nouveau.’’ La plupart des acteurs du film sont nés et ont grandi en Allemagne de l’Est, et se sont inspirés de leurs propres souvenirs pour nourrir leur jeu.
Fritz Bauer, un héros allemand retraçait la traque du SS Adolf Eichmann, exilé en Argentine, par le procureur juif dans une Allemagne qui voulait tourner la page du nazisme. En 1957, faute de pouvoir faire extrader le criminel dans son pays, Bauer le livrera au Mossad et le procès aura lieu à Jérusalem. L'histoire de La Révolution silencieuse est moins retentissante mais tout aussi intéressante dans sa manière d'illustrer les déchirements de l'Allemagne d'après guerre. En 1956, le mur n'a pas encore été érigé mais le rideau de fer est déjà une réalité dans les esprits. En Allemagne de l'Est, Kurt, Theo et Lena s'apprêtent à passer le bac. Le tir au fusil semble une matière obligatoire. Les lycéens entendent sur la RIAS, la radio de Berlin-Ouest, que l'armée soviétique a réprimé violemment l'insurrection hongroise. Ferenc Puskas, le capitaine de l'équipe nationale hongroise de football est l'idole de ces jeunes gens. Il ferait partie des victimes. Cela achève de convaincre les indécis. Ils observent une minute de silence en classe. Ce signe de protestation devient une affaire d'État. La directrice du conseil scolaire mène l'enquête pour connaître le nom du ou des meneurs. Elle les divise et les menace : s'ils ne parlent pas, ils seront renvoyés du lycée et interdits de baccalauréat en RDA. Le camarade ministre de l'Éducation populaire en personne fait le déplacement à Stalinstadt pour punir les responsables et mater ces contre-révolutionnaires en herbe.
Ce défi à l’autorité est assumé par une jeunesse tiraillée entre la douleur d’un passé récent trop lourd à porter et la soif d’un avenir scindé en deux par un mur à la fois physique et mental. Malgré une mise en scène un peu pauvre, citant allègrement Le cercle des poètes disparus de Peter Weir, La révolution silencieuse, aidé d’un casting de jeunes têtes germaniques particulièrement enthousiasmant, vient interroger notre part d’humanité dans l’espace politique. Kraume fait d’abord le portrait d’une société soviétique dont les mécanismes d’oppression font écho à ceux d’un autre régime totalitaire, le nazisme, dont la population allemande venait à peine de se défaire. Et à travers cette jeunesse en ébullition, il observe à la fois les traumatismes causés par ces dictatures successives mais aussi la renaissance de l’espoir à travers la découverte du libre arbitre par ces jeunes héros.
Lars Kraume dépeint très finement un microcosme qui symbolise tout un pays. Servi par une excellente distribution, il évite tout manichéisme en dessinant chaque personnage avec beaucoup de minutie, les adolescents comme leurs parents, écartelés entre l'amour filial et la soif de liberté. Le dénouement, très beau, rappelle que la fuite est toujours une douleur.
La Révolution silencieuse est un film qui mérite d’être vu par qui veut comprendre la mécanique totalitaire d’un régime comme celui de l’ex-RDA. Comprendre intellectuellement, mais aussi éprouver le souffle glacial qui balaie les éventuels opposants. En 1956, un vent de liberté commence à se lever en Hongrie, qui entend s’émanciper de la tutelle du grand frère soviétique. Les deux longues minutes que les dix-neuf élèves décident d’observer vont mettre en branle l’appareil policier de l’Etat, bien décidé à punir les coupables. On oubliera la forme un peu convenue du film. Reste une page d’histoire assez captivante, avec en toile de fond, le portrait de deux générations qui se confrontent, celle des pères, hier parfois opposés au nazisme et qui soutiennent le régime communiste, et celle de leurs enfants qui se révoltent contre l’injustice, avec idéalisme et courage.
Samuel Maoz raconte une société malade, cernée par une violence
FOXTROT
Film Franco-Germano-israélien de Samuel MAOZ – 2017
 Michaël et Dafna, parents israéliens, apprennent la mort de Jonathan, leur fils qui sert sous les drapeaux. Alors que sa femme s’effondre, Michaël garde sa colère rentrée et réveille en lui un secret de son service militaire. Le choc de l’annonce va rouvrir en lui une blessure profonde, enfouie depuis toujours…
Michaël et Dafna, parents israéliens, apprennent la mort de Jonathan, leur fils qui sert sous les drapeaux. Alors que sa femme s’effondre, Michaël garde sa colère rentrée et réveille en lui un secret de son service militaire. Le choc de l’annonce va rouvrir en lui une blessure profonde, enfouie depuis toujours…
Après Lebanon (2010), le cinéaste israélien Samuel Maoz revient, avec Foxtrot dont l’idée de départ est venue d’un épisode traumatisant de sa vie : en 1994, pendant plus d’une heure, il a cru avoir perdu sa fille dans un attentat : ‘’C’est cette histoire terrible où hasard et destin se sont mêlés, qui m’a inspiré le scénario’’, explique Maoz. Foxtrot a reçu le Grand Prix du jury lors de la Mostra de Venise en 2017.
Dix ans après Lebanon, le cinéaste israélien reprend une tragédie vécue, avec un film captivant sur le fond comme sur la forme. Une œuvre récompensée de huit Ophirs, l’équivalent israélien du César. On frappe à la porte. La femme qui va ouvrir s’écroule. La signification de la scène apparaît tout entière dans le vestibule. La tragédie en trois actes que raconte Samuel Maoz commence par un direct au cœur. La présence des silhouettes en uniforme qui franchissent le seuil annonce une terrible nouvelle. Michael et sa femme Dafna (Lior Ashkenazi et Sarah Adler) apprennent la mort de leur fils, qui effectuait son service militaire à un check-point perdu dans le désert. Les soldats qui annoncent la nouvelle à Michaël ne sont pas dépourvus de compassion, mais la procédure qu’ils appliquent semble absurde en regard de la douleur : un verre d’eau à prendre toutes les heures, des proches à prévenir. Michael est en état de choc. On avait parcouru ce bel appartement d’architecte, la géométrie de ses carrelages. Samuel Maoz procédera à des plongées verticales pour dire la fracturation, le chagrin et la colère. L’énonciation du rituel des funérailles, le silence sur les lieux et la pathétique promotion à titre posthume du jeune homme de 19 ans, ne peuvent pas s’ajuster aux murs de sa chambre où le père s’est assis, abasourdi. Au mur derrière lui, l’écarlate d’une grande éclaboussure décorative a bousculé les perspectives de sa vie, de fond en comble, irrémédiablement.
Le cinéaste s’attaque aux tabous fondateurs de la société dans laquelle il vit. Samuel Maoz a élaboré chacun de ses choix formels avec un savoir-faire accompli. Il assemble, dans une première partie très réaliste, les éléments de son allégorie. Jusqu’à la fin du film, pas un plan qui ne soit un concentré de sens. La métaphore du titre, ce foxtrot qui se danse en revenant sans cesse sur ses pas, englobe et décline l’ensemble de l’oeuvre. Malgré son impression de dynamisme, cette danse vous maintient sur place, indéfiniment. C’est la métaphore filée par Samuel Maoz dans ce film étonnant, qui est une réflexion sur les traumatismes d’Israël (le poids de la mémoire de la Shoah, le destin guerrier auxquels chaque nouvelle génération condamne ses enfants…), mélangeant un drame familial pathétique, une farce absurde et un film de guerre. Les impacts émotionnels se conjuguent aux champs réflexifs. Michaël contemple en coulisses de vieux couples qui répètent inlassablement les pas des danses de leur jeunesse. Sa mère, rescapée des camps d’extermination, lui parle comme à un enfant. Selon Michael, la vieille dame à l’esprit égaré «a tout saisi, mais rien compris» de la mort de son petit-fils. Le drame d’une guerre se joue sous nos yeux. Un pays, Israël, décide d’occuper et de soumettre par la violence. Dans Lebanon, Samuel Maoz contenait, dans l’habitacle d’un char, ses traumatismes de combattant lors de la première guerre du Liban en 1982. Valse avec Bachir, d’Ari Folman (2008), ou encore Beaufort (2007) réalisé par Joseph Cedar, puisaient aux mêmes sources. Ils encouraient des reproches similaires : de la part de l’État d’Israël, celui de ‘’salir l’armée’’ qui incarne la nation. La ministre de la Culture Miri Regev a conspué le film, qui connaît pourtant, depuis sa sortie, une notoriété croissante. Des polémiques vivaces l’entourent. Pas plus que les cinéastes mentionnés, Samuel Maoz ne cherche à présenter les soldats israéliens comme ‘’les premières victimes’’ d’une guerre d’occupation qui ne dit pas son nom. Elle ne peut se poursuivre que par l’aliénation du corps social tout entier. Pour lui, combattre le déni, c’est déjà agir. L’œuvre cinématographique à laquelle il donne le jour s’attaque aux tabous fondateurs. Les cheminements du premier acte seront étirés jusqu’au point de rupture. Le second acte entraîne dans un monde irréel. Au sein d’une immensité désertique, quatre jeunes soldats surveillent la barrière frontalière que seul franchit un chameau errant. Tout n’est que ruines et rouille, carcasses et objets en délitement organique. Jonathan est là, dans ce lieu du crime où sera rappelée la faute originelle. Sous forme de fables et de fantasmagories, les filiations s’opèrent. Selon le récit familial, un livre saint aurait été bradé en échange d’un magazine porno. Par le truchement tragi-comique du dessin animé, la culpabilité des descendants des survivants de la Shoah va être dénoncée. Son instrumentalisation à des fins belliqueuses dévoie corps et âmes. Les ressources de la science-fiction dirigent un faisceau aveuglant sur les passagers arabes de trois véhicules qui se succèdent à la frontière. Les contrôles successifs monteront en intensité agressive contre eux. Un bulldozer aux dents rougies recouvrira l’histoire de cendres et de terre. Le retour chez le couple de parents enchaînera des moments poignants. Derrière l’humour à froid, le mélange des styles et des tonalités, le goût pour les embardées poétiques ou musicales, l’inclusion de séquences animées (autant d’éléments qui témoignent de l’influence du génial Valse avec Bachir), Samuel Maoz raconte une société malade, cernée par une violence qu’elle semble d’abord s’infliger à elle-même. Une scène – métaphorique, encore une fois- où des militaires camouflent une bavure en enterrant des cadavres d’innocents à la nuit tombée, a fait grincer des dents en Israël, la Ministre de la Culture, qui a été jusqu’à déplorer que Foxtrot représente le pays dans la course aux Oscars. Ce qui n’a pas empêché le film d’être un beau succès en salles. Les personnages de Maoz tournent peut-être en rond dans ce foxtrot si réaliste, mais son film, lui, a l’air d’avoir fait avancer le débat sur l’absurdité de cette guerre.
Avec ce film , vous irez à la rencontre de femmes,
mémoires vivantes du village colombien.
JERICO
L’ENVOL INFINI DES JOURS
Film franco-colombien de Catalina MESA – 2016
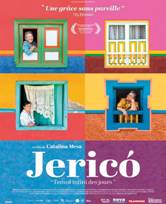 À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes, d’âges et de conditions sociales différentes, évoquent les joies et les peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité… En Colombie, la petite ville de Jericó n’a pas toujours été le berceau de la paix. Elle a vécu de plein fouet le conflit armé qui a ravagé le pays. Le lieu est coloré, les fenêtres sont grandes ouvertes, les murs sont peints aux couleurs de l’arc-en –ciel, tout est redevenu doux et harmonieux et les femmes du village partagent, le plus naturellement du monde, leurs joies et leurs peines, leur sagesse, leurs petits arrangements avec les saints et le temps qui passe…
À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes, d’âges et de conditions sociales différentes, évoquent les joies et les peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité… En Colombie, la petite ville de Jericó n’a pas toujours été le berceau de la paix. Elle a vécu de plein fouet le conflit armé qui a ravagé le pays. Le lieu est coloré, les fenêtres sont grandes ouvertes, les murs sont peints aux couleurs de l’arc-en –ciel, tout est redevenu doux et harmonieux et les femmes du village partagent, le plus naturellement du monde, leurs joies et leurs peines, leur sagesse, leurs petits arrangements avec les saints et le temps qui passe…
A quelques heures de Medellin, Jericó est un doux village aux maisons bigarrées, niché à deux mille mètres d’altitude. La caméra de ce superbe documentaire l’a filmé amoureusement, transfigurant chaque plan en une sorte de tableau de Matisse. Les femmes y sont reines et les hommes les regardent, jeunes ou vieilles, tantôt drôles, tantôt émouvantes, parfois les deux. Il ne s’agit pas ici de naturaliser une forme de sensibilité féminine, mais de proposer un ensemble cohérent à travers différents portraits. Ils esquissent en creux l’image d’une Colombie profondément croyante : ainsi, une vieille autochtone, qui collectionne les chapelets et bénit le Seigneur de la faire vivre à Jericó ; une autre, en quête d’amour, exhorte Sœur Marie de Jésus, religieuse colombienne canonisée en 2013 : elle évoque ses souffrances physiques, avec des larmes dans les yeux, avant de s’autoriser un écart, en la traitant de "coquine" et de "grassouillette". Peu après, cette dévote sincère recueille la parole d’une femme plus jeune, qui lui raconte son histoire d’amour ratée, avec un homme qui est devenu prêtre, comme s’il fallait que la foi prenne la totalité de son existence.
Cette ferveur n’empêche pas l’humour, qui forme un contrepoint tout à fait lumineux, fait écho au soleil, dont les rayons nimbent les tissus, les façades des maisons et les beaux visages, saisis en gros plans lorsque des mains s’affairent pour apprêter un chignon, ourler les yeux d’un maquillage ou broder un tissu chatoyant. Mais certaines mains sont assignées au ménage ou à la cuisine, selon un déterminisme social qui rappelle le poids des traditions et condamne les désirs individuels à une profonde déception. Parce que plusieurs de ces habitantes n’ont pas suivi une longue scolarité, leur horizon s’est borné à un environnement domestique qu’elles se sont attachées à soigner au mieux, certaines se résignant à leurs rêves avortés, ou les vivant par procuration, à travers leurs enfants. Autre fait notable : si l’on excepte la dernière femme dépeinte, toutes ces personnes sont seules et cette solitude induit une lecture double la vie, confirmée par des témoignages où il est question, à la fois, de désirs d’émancipation et d’amours douloureuses. Lorsque quelques-unes d’entre elles abordent leurs relations sentimentales, le lexique s’infléchit, les mots deviennent plus crus, portant en eux le trouble et l’amertume de ce qui n’a pas duré. Parfois, c’est le destin lui-même, dans toute sa cruauté, qui vient frapper à la porte de leur existence : une institutrice raconte comment elle perdit son mari, victime d’une chute accidentelle, et sut surmonter sa douleur en s’occupant de ses neuf enfants et en ouvrant une école maternelle au village.
Parfois, les petites histoires rejoignent la grande : une mère bouleversée explique comment son fils fut enlevé sous les yeux de son père par l’Armée de libération nationale et dit son espoir de le retrouver vivant, un jour, malgré les années passées.
Le dernier mot est laissé à une étonnante centenaire, d’une vitalité à toute épreuve, qui a passé un contrat avec la Vierge Marie pour son passage vers l’au-delà : elle s’engage à égrener quotidiennement ses trois rosaires, à charge pour Marie d’être la première à l’accueillir !
On pourra reprocher aux premières minutes du film la multiplication de plans décoratifs épousant le principe d’un programme touristique ou d’une carte postale – une forme rectangulaire renforcée par les contours des portes et des fenêtres colorées, si typique de l’architecture coloniale colombienne. Pourtant, loin d’être gratuites, ces images proposent d’emblée une géométrie spatiale qui s’impose aux individus qui la composent et qui la nourrissent. Ainsi quadrillée, la ville devient un lieu d’allers et retours, de trajectoires affirmées parfaitement anticipées et régulées – comme en témoigne le recours majoritaire aux plans fixes que les personnages traversent (et non des travellings s’adaptant à leur itinéraire). L’enjeu n’est donc pas, pour la cinéaste, d’errer dans Jericó, mais au contraire de fixer des récits de vie, avec toutefois le souci de respecter les témoignages des femmes.
Le récit est ainsi éclaté en huit pôles : huit portraits de femmes, dont la plupart vivent encore d’activités manuelles (élevage, artisanat, préparation d’arepas – galettes de maïs colombiennes – au feu de bois) et dans une tradition catholique très rigoureuse, prétexte pour la cinéaste d’y confronter, avec une sympathique bienveillance, les souvenirs amoureux et naïvement épicés de ses protagonistes. Malgré cette fragmentation, les portraits convergent vers une thématique commune : la question de l’héritage et de la transmission, dont est investie Catalina Mesa : son film Jericó peut s’apparenter à un projet de sauvegarde d’un patrimoine immatériel, c’est-à-dire tout ce qui constitue le mode de vie traditionnel de la ville, au-delà de la simple question architecturale.
Perdue au milieu des vallées et des montagnes de Jericó, Catalina Mesa part à la rencontre de ces femmes, mémoires vivantes du village. Pomponnées en permanence et casse-cou malgré leurs âges (l’une d’entre elles, à 80 ans passés, part faire de la moto sans casque dans les montagnes), elles sont belles et éternelles. Tout leur vie est évoquée, partagée avec beaucoup d’émotion : de la religion à leurs enfants, en passant par leurs relations amoureuses et intimes, ces femmes parlent de tout et sans tabou. Au rythme des musiques latino-américaines et de la préparation des fameuses tortillas de maïs, on rit, on pleure, mais on s’émerveille surtout. Ces femmes qui ont tout vécu et tout traversé ont pour point commun d’être profondément humaines. Un documentaire magnifique, beau et touchant.
On ne peut juger mécaniquement
des agissements humains, par nature complexes et particuliers
THE THIRD MURDER
Film japonais de Hirokazu KORE-EDA – 2017
 Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est condamné. Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client…
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est condamné. Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client…
En décortiquant une affaire de meurtre, Kore-Eda aborde des questions complexes avec la même limpidité que dans les drames familiaux, abordés dans ses films précédents.
Les premières images ne laissent aucun doute : en pleine nuit, un homme défonce le crâne d'un autre avant de l'asperger d'essence et d'y mettre le feu. Misumi (Koji Yakusho) vient de tuer son patron et de lui voler son porte feuille. En tant que récidiviste (il avait déjà tué deux bookmakers dans des conditions similaires), il risque la peine capitale, toujours en vigueur au Japon. Lorsque l'avocat Shigemori (Masaharu Fukuyama) s'empare de l'affaire, le film semble se diriger vers un drame de tribunal, qui opposerait normalement l'accusation, partisane de l'application de la loi, à la défense, désireuse de requalifier les faits pour plaider la perpétuité plutôt que la mort. Mais les choses se compliquent lorsque l'avocat se rend compte que tous les témoins interrogés mentent, à commencer par l'accusé, qui change sans arrêt de version. Au fil d'une enquête passionnante, les demi-mensonges et les silences éloquents finissent par révéler des parcelles de vérité dont la somme remet en question la culpabilité de l'accusé, le droit de vie ou de mort, la fatalité, la vérité elle-même: à l'évidence, elle n'intéresse pas la justice qui a mis au point une procédure mécanique pour simplifier, généraliser et finalement juger des agissements humains, par nature complexes et particuliers. Avec son écriture toujours claire, sa mise en scène simple et directe, et une direction d'acteurs très juste, Kore-Eda est fidèle à lui-même, tout en abordant un registre nouveau qu'il enrichit d'une profondeur humaine exceptionnelle.
Kore-Eda, que certains comparent à Ozu, s’est fait le peintre des relations familiales difficiles, dans Nobody Knows (2003), Après la tempête (2016), et le poignant Tel père, tel fils (2013). Son dernier film n’échappe pas à la règle, même si ce thème n’apparaît qu’en filigrane. Car le récit met ici en avant divers personnages, tourmentés dans leurs rapports de conjugalité ou de filiation, qui vont être amenés à se croiser à l’occasion d’une affaire criminelle. Misumi, l’accusé, outre son passé d’assassin, a toujours essayé de reconquérir l’amour de son enfant, tout en se trouvant une fille de substitution qui semble avoir des liens douloureux avec ses parents. Quant à l’avocat qui mène l’enquête, il néglige sa fille adolescente qui ne le contacte que lorsqu’elle est surprise en flagrant délit de vol et il montre de graves manques dans son rôle paternel.
Les préoccupations de Kore-Eda, dont l’œuvre a souvent eu une connotation autobiographique, sont ici greffées sur une trame principale, à savoir la résolution d’un suspense judiciaire, ou bien elles constituent une digression qui éclaire la personnalité des protagonistes. Car, pour la première fois dans sa filmographie, le cinéaste explore le genre policier, assumant de se mouler dans ses conventions. Meurtre violent en ouverture du film, scènes de parloirs, coups de théâtre pendant le procès, démonstrations du procureur ou discussions autour de la peine de mort, pourraient laisser croire que le réalisateur a perdu son âme en actionnant les grosses ficelles du polar et du film à thèse. Or, il n’en est rien : non seulement le récit n’évacue pas la touche particulière de Kore-Eda, mais son film policier brille par sa subtilité et son efficacité narrative.
Le côté le plus réussi du film réside dans la description trouble des échanges entre l’avocat et le suspect, comme un lointain écho à d’antérieures réussites du même genre, dont Garde à vue (1981) de Claude Miller. Et le travail plastique de Kore-Eda est toujours essentiel : « J’ai opté cette fois pour une esthétique de polar. J’ai accentué le contraste entre la lumière et les ombres, rompant avec l’éclairage naturaliste que je privilégie habituellement », a déclaré le réalisateur dans les notes d’intention. Il est bien épaulé par Mikya Takimoto, son directeur de la photo, qui a utilisé avec art le Cinémascope. Le casting est par ailleurs remarquable, avec une mention pour Kôji Yakusho (13 assassins - 2010) et la jeune Suzu Hirose, que Kore-Eda avait déjà dirigée dans Notre petite soeur (2014).
Comme les autres films de Kore-Eda, The Third Murder invite le spectateur à une recherche de vérité. Intime et existentielle dans ses précédents films, cette quête se fait ici plus tangible mais, en se parant d’intrigue, elle ne perd ni en force ni en profondeur. Car derrière le polar se cachent les mécanismes habituels du cinéma de Kore-Eda. On ne s’étonne donc pas de voir le réalisateur se désintéresser des détails de la procédure, pour privilégier l’humain et de longs face-à-face au parloir entre ses deux protagonistes. Des scènes fascinantes, mises en scène avec une grande précision (Ces reflets, cette paroi qui s’efface en un mouvement de caméra …) et hantées par le spectre de la conclusion du film Entre le ciel et l’enfer (1963) d’Akira Kurosawa. Par l’utilisation du Cinémascope (une première dans sa filmographie) pour raconter les rapports entre ses personnages, Kore-Eda insuffle de l’ampleur à la moindre réplique, au moindre regard, alors que peu à peu, Shigemori se trouve ébranlé par la tournure que prend l’affaire. Kore-Ed explore avec finesse les relations complexes entre les générations et parvient, par le prisme familial et individuel, à questionner plus globalement le rapport de toute une société à la violence et à la mort. Un faux film mineur, dont la mélancolie s’imprime longtemps dans la tête, à l’instar du tout dernier plan, superbe croisée des chemins.
Mai 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
La biopic de Callahan
Créateur des dessins à l’humour noir, satirique et insolent,
DON’T WORRY, HE WON’T GET ON FOOT
(Ne t’inquiète pas, il n’ira pas loin à pied)
Film américain de Gus Van Sant – 2018
 Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne Annu et un mentor charismatique Donnny. C’est alors qu’il se découvre un don inattendu. Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès international, dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie…
Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne Annu et un mentor charismatique Donnny. C’est alors qu’il se découvre un don inattendu. Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès international, dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie…
‘Don’t worry, he won’t get far on foot’. Ce titre peut sembler indigeste dans le cadre de l’histoire d’un quadriplégique. Porter ce jugement serait méconnaître l’humour très particulier de John Callahan, grand dessinateur satirique, dont cette phrase est justement tirée d’un dessin qui fait référence à son état de santé. C’est toute la difficulté que risque de rencontrer ce film au moment où il arrive en France, où son personnage principal est parfaitement inconnu.
Il est vrai que Gus Van Sant avait déjà fait le même pari avec son film consacré à Harvey Milk, lui aussi méconnu de ce côté-ci de l’Atlantique, mais dont l’universalité de son combat pour les droits des homosexuels avait permis de faire connaître son film.
Deux thématiques se croisent au cœur de son nouveau film, qui sont potentiellement plus universelles encore, puisqu’elles décrivent le double statut d’handicapé et d’ancien alcoolique de John Callahan, ainsi que la réception difficile de certains de ses dessins polémiques.
Ce qu’il faut savoir, à propos de Gus Van Sant, c’est que son film Harvey Milk (2008), qui avait connu un grand succès, remonte à dix ans. Depuis, ses réalisations ont subi un certain déclin qualitatif, qui estompent les succès qu’avaient rencontré ses films plus audacieux et plus originaux de la période précédente. Son adaptation de l’autobiographie de John Callahan n’emporte pas l’enthousiasme, même si l’acteur Joaquin Phoenix illumine cette histoire vraie de son charisme.
L’action du film commence au début des années 70, au moment de l’accident qui a coûté sa mobilité à Callahan, mais la période n’est pas du tout contextualisée, annonçant la sobriété avec lequel Gus Van Sant a élaboré son scénario. Le parcours de son personnage principal lui-même reste flou. On n’apprend que peu de choses de son passé. Son histoire d’amour avec Annu, qui apparaît pourtant comme l’élément principal qui lui redonna goût à la vie, n’est évoquée que de façon purement anecdotique, à point tel qu’on en vient à se demander pourquoi Rooney Mara a accepté ce rôle accessoire.
A défaut d’en savoir beaucoup plus sur Callahan, il faut revenir aux sujets évoqués dans le film pour retrouver un peu le Gus Van Sant que l’on aime. La façon avec laquelle il a abordé la question de la sexualité, difficile pour cet homme ayant perdu le contrôle de ses membres inférieurs, montre que le réalisateur conserve toujours l’esprit transgressif qui a fait sa réputation. Et il apparaît d’ailleurs évident que c’est le fait de partager cet esprit frondeur avec Callahan qui l’a conduit à s’intéresser à lui, tant il s’amuse à évoquer les scandales que ses dessins les plus grinçants éveillaient dans une Amérique puritaine.
A l’heure où la liberté d’expression est plus que jamais au cœur des débats aux États-Unis, on comprend aisément le discours contestataire porté par le cinéaste. On regrette d’autant plus alors qu’il n’ait pas daigné offrir à ce biopic une mise en scène plus originale et qu’il ait choisi de tout miser sur la présence de Joaquin Phoenix et le cabotinage de Jonah Hill. Le film risque donc de passer un peu inaperçu. C’est dommage car John Callahan aurait mérité un film qui rende hommage à son talent, à cet improbable mélange de cynisme, de trivialité et de naïveté d’où naissait son pouvoir de subversion.
Mai 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Le cinéma, un art spirituel

Avec l’accord exceptionnel de la rédaction du journal La Vie, je reproduis ici un des articles du dossier ‘’Filmer la foi’’ de Frédéric Théobald, dans le numéro 3785 de la revue La Vie du 15 au 21 mars.
‘’Faut-il voir dans les sorties qui se succèdent une appétence nouvelle des cinéastes, notamment français, pour les sujets religieux ? Ce serait faire injure aux réalisateurs d’y voir une simple mode. ‘’Réaliser un film découle toujours d’un chemin très personnel. Après, il peut rencontrer son époque, mais cela relève du hasard. C’est un temps long, le cinéma, au minimum deux ou trois ans.’’, note Cédric Kahn, l’auteur de La prière. Son film, tout comme L’Apparition de Xavier Giannoli, se situe sur le terrain de l’intime et non du débat de société.
Si on ne peut pas avancer le mot de ‘’tendance’’ peut-être peut-on parler d’un ‘’retour de la spiritualité’’ ? C’est le sentiment de Nicolas Boukhrief qui, après des thrillers comme Le Convoyeur ou Made in France, s’est risqué l’an dernier avec La Confession, à une nouvelle adaptation du roman de Beatrix Beck, Léon Morin, prêtre. ‘’Dans les années 1970, quand je suis devenu cinéphile, la religion était une thématique récurrente. On découvrait Taxi Driver, film très troublant, et on apprenait que Scorsese avait, comme par hasard, voulu devenir séminariste… A la sortie de 2001, Odyssée de l’espace, le débat était : Est-ce un film qui parle d’extraterrestres ou un film qui parle de Dieu ? Depuis, cette thématique s’est asséchée’’. Désintérêt du public ? Frilosité des producteurs, à commencer par les chaînes de télévision ? Sans doute.
Xavier Giannoli, réalisateur de L’Apparition et grand cinéphile devant l’Eternel, se démarque de cette lecture : ‘’De même qu’il y a toujours eu des films qui racontent des histoires d’amour ou de meurtre, il y a toujours eu des films qui parlent d’une quête spirituelle, et ceux que je préfère sont ceux qui ne sont pas du tout chrétiens. Je pense qu’Apocalypse Now met en scène une quête spirituelle. Je pense que Le Loup de Wall Street, de Scorsese, est travaillé par ces questions. C’est le film d’un chrétien effrayé et fasciné par la débauche et la folie matérialiste d’un certain monde’’. Bruno Dumont, auteur du récent Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc, penche également pour une permanence du sujet, estimant que ‘’la vie spirituelle doit s’épanouir dans l’art, hors de la religion’’. La question serait donc moins celle d’un retour du religieux que de la dénomination du film spirituel. ‘’On n’est pas obligé de filmer une église ou un monastère pour parler de la foi, précise Xavier Giannoli. Le cinéma est un art spirituel. A partir du moment où l’on s’intéresse à la chose humaine et où on interroge le spectateur sur son sens du bien et du mal, son aptitude à la compassion ou pas, on suit déjà une démarche spirituelle’’. Frédéric Théobald, journaliste à La Vie.
Je vous invite à retrouver l’intégralité de ce passionnant dossier ‘’Filmer la foi’’ sur le site du journal : www.lavie.fr
Filmer la foi
par le doute, le questionnement, les regards, le jeu intériorisé des acteurs… ?
LA PRIERE
Film français de Cédric KAHN – 2018
 Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière et le travail. Il va y découvrir l’amitié, la règle, l’amour et la foi...
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière et le travail. Il va y découvrir l’amitié, la règle, l’amour et la foi...
Entre beauté mystique et nature sauvage, Cédric Kahn décrit avec une infinie pudeur le combat douloureux et rédempteur d’un jeune homme aux prises avec la vie.
‘’La prière’’ ne va pas sans audace : raconter l’histoire de Thomas (Anthony Bajon), toxicomane qui, à contrecœur, rejoint, quelque part dans les Alpes, une communauté dont la règle tient en trois mots : le travail, l’amitié et la prière. Cette fiction se déroule comme une renaissance, qui questionne la foi : foi en Dieu, foi en la vie, foi dans le cinéma. Comment ‘’filmer la foi’’, interroge le journal La Vie (15-21 mars 2018) ?
Laissons le réalisateur, Cédric Kahn, nous présenter son film :
‘’N’étant ni croyant, ni chrétien, ni ex-toxicomane, il fallait que je trouve ma propre porte d’entrée. Avec Fanny Burdino et Samuel Doux, nous avons repris la documentation, les rencontres avec les jeunes gens qui ont vécu ce genre d’expérience et la lecture des psaumes. On a parlé avec des ‘’anciens’’, des types sortis d’affaire, qui nous ont parlé de leur rapport persistant à la foi. L’écriture a pris corps à ce moment-là et nous avons pris quelques décisions fortes, comme de centrer le récit sur la trajectoire d’un seul garçon, dont on ne saurait rien et qui deviendrait, au fil du récit, comme un symbole de tous les autres, une figure emblématique…
Les rapports entre les jeunes pensionnaires, c’est le vrai sujet du film : la reconstruction du lien. Ils arrivent dans une solitude absolue, une grande détresse affective. Ce qu’ils apprennent, ce sont les règles, le partage, la vie en communauté, la prière. Et c’est probablement ce qui les sauve. Pourtant, ils viennent de tous les horizons ; il y a un brassage des milieux sociaux et des nationalités, des enfants de bonne famille comme des gamins de la rue, des Espagnols et des Américains. Tous unis par les épreuves et le respect des autres, dans la prière.
Quand ils arrivent, certains sont très loin de la religion, voire totalement récalcitrants. D’autres, au contraire, sont très éduqués, très croyants. Il n’y a pas d’obligation de prier, bien sûr, juste de respecter le temps de la prière, qui peut être vécue comme une simple pause ou une méditation. La religion et la vie communautaire les protègent : ils sont coupés du monde, dans une bulle où ils se réparent de leurs blessures. Et, au bout de quelque temps, ce qui devient inquiétant pour eux, c’est le monde du dehors qu’il faut retrouver, avec ses dangers et ses tentations. L’apaisement advient, mais la fragilité demeure.
Comment filmer la foi ? Par le doute, le questionnement, les regards, le jeu intériorisé des acteurs… Rien n’est imposé au spectateur. Chacun peut toujours se forger sa propre conviction, même dans la scène de miracle. Je tenais à ce que tout reste rationnel, et que les images créent cette subjectivité, cette illusion : les chants à la chapelle, les marches en montagne, l’écho dans le brouillard. Avec les moyens du cinéma, je pensais qu’on pouvait faire ressentir la présence, l’invisible… Personnellement, je me définis comme agnostique : je n’ai aucune certitude. Je respecte les gens qui sont croyants et, par certains aspects, je les envie. La foi est une affaire intime qui, par beaucoup d’aspects, dépasse largement le cadre des religions. Si on y pense, tout est question de foi dans la vie, l’amour, la passion, l’engagement. Moi par exemple, je crois en la mystique du cinéma : une séquence réussie, c’est toujours un miracle, la conjonction magique des divers éléments.
Le personnage de Sybille (Louise Grinberg) est décisif et complexe : c’est elle qui convainc Thomas de poursuivre l’expérience communautaire, mais c’est aussi elle qui le fera douter de son envie de devenir prêtre. C’est le personnage le plus fictionnel du film, et le contrepoint nécessaire, probablement celui qui nous représente le plus. Elle est le monde du dehors à elle seule. Et ce monde, pour les compagnons est une obsession : l’envie de retourner à la vie normale se mêle à la crainte de la rechute. Sybille a une parole très libre par rapport à la communauté, tout en étant capable de le convaincre d’y retourner. Et demeure une ambiguïté qui court tout au long du film : est-ce que Thomas y retourne par conviction ou dans l’espoir de la revoir ?...’’
Cédric Kahn nourrit un intérêt tout particulier pour ceux qui choisissent de mener une vie hors système, les cabossés de la vie, les rêveurs, qu’il se plaît à placer au cœur d’une nature synonyme de liberté et de sérénité, comme on a pu le voir dans Vie sauvage en 2014. Si ce nouveau long-métrage présente la foi comme un chemin possible vers un renouveau de la vie, c’est surtout la force de la fraternité sous-tendant l’intégralité du récit qui lui donne toute son intensité. Mais finalement, ce que l’on retient surtout de cet hymne au dépassement de soi, c’est la force de persuasion d’Anthony Bajon dont le visage est capable de transmettre avec la même évidence la rage destructrice et la candeur enfantine. S’il est de toutes les scènes, ses partenaires de souffrance dont l’impeccable Damien Chapelle (Pierre) forment avec lui un groupe homogène dont on suit avec intérêt les tourments. Ce casting déjà bien étayé est enrichi par la prestation d’Alex Brendemühl (Marco) et encore bien plus par la présence de l’excellente Hanna Schygulla qui, entre autorité et douceur, présente le personnage de la Sœur Myriam. Enfin, le cadre du plateau de Trièves en Isère, espace d’isolement et d’éternité, entouré de montagnes à 360°, nourrit sans conteste le mystère entretenu autour de la rédemption réelle ou illusoire de son héros et laisse toute latitude à l’imaginaire des spectateurs.
Avril 2018 Jn.-C. Faivre d’Arcier
Une internaute nous partage ses réactions à la critique du film la prière.
Jean Claude Faivre d’Arcier a lu cette critique et est heureux de lui répondre.
J'ai lu votre avis sur ce film. Je n'arrive pas à croire que, si vous
êtes une personne ayant la foi, vous puissiez dire que ce film montre ou
filme la foi !!!
Ce mot n'est pas prononcé une seule fois (à mon souvenir) dans le film.
Qu'il nous montre des personnes en prière ou plus exactement mis en
attitude de prière, oui, c'est exact. Mais de là à dire que c'est la
prière qui va sortir ces hommes de leurs souffrances, il y a un monde :
celui de la foi ! Que la fraternité soit ici salvatrice, OK, mais faire
faire des choses totalement inutiles comme creuser un trou (une tombe ?)
et le reboucher, les deux pieds dans la neige n'a aucun sens pour
personne si ce n'est pour faire croire que l'obéissance aveugle est
magique pour la guérison de soi ?
L'ensemble du film donne une impression complètement fausse de que ce
que peut être la prière, ancrée dans la vie quotidienne avec ses joies
et ses difficultés, mais pas dans le semblant d'un monastère qui n'en
est pas un. L'ensemble du scénario est d'une banalité à pleurer et tout
est vu à l'avance : j'ai pu prévoir la suite de chaque scène et ne
jamais me tromper. Heureusement le fin du film est ouverte c'est à nous
de savoir si il sera prêtre ou non.
Quant à l'affiche ! la prière est montrée au travers d'un beau jeune
homme tout de blanc vêtu...le communicant qui a fait l'affiche ne doit
pas connaître grand chose à la prière.
Je peux vous dire que j'ai fait vraiment une contre pub à ce film qui vaudra certainement l'agrément de tout un monde catho, bien ‘comme-il-faut’, qui se réjouira de voir (de croire) qu'avec la prière, -ou sa caricature- on sort tout ces mauvais garçons de leur misère… quelle tromperie!
Néanmoins je suis heureuse d'avoir pu exprimer ici mon opinion de femme
croyante et engagée en communauté chrétienne.
Merci pour cette possibilité donnée
Florence
Réponse à Florence.
Tout d'abord, un grand merci d'avoir pris la peine de nous exposer votre point de vue. Le mien est différent, sans doute parce que nous ne regardons pas les mêmes choses dans ce film. Apparemment, Thomas ne dit pas les ''mots de la foi'', tels qu'un chrétien les attend, mais il fait un cheminement formidable avec ses compagnons et avec Sibylle. Avec eux, il change, il accepte de reconnaître humblement sa misère et qu'il est capable d'en sortir puisque les autres lui font confiance. Et dans la montagne, il fait l'expérience que Dieu ne l'abandonne pas et il accepte de puiser dans cette reconnaissance la force pour redescendre à la maison.
Je crois que son expérience amoureuse avec Sibylle achève de lui faire retrouver confiance en lui et dans les autres, y compris en Dieu qui devient vraiment quelqu'un pour lui, au point qu'il envisage généreusement de lui consacrer sa vie. Et la prière du Christ devient alors vraiment la sienne quand il l'exprime avec sa communauté.
Je vous invite à lire le dossier de La Vie que j'ai signalé : Frédéric Théobald essaie de montrer, en interrogeant les metteurs en scène, comment la foi peut se traduire, cinématographiquement, par des attitudes, des regards, des gros-plans de visages, par une atmosphère, une musique... Je pense, qu'en cela, il rejoint la mentalité contemporaine, où les gens rejettent les discours pieux ou perçus comme moralisants, mais accueillent un regard neuf sur la vie, sur la souffrance et sur la mort.
Les quatre films que j'ai présenté abordent la question de la foi par des chemins divers. Le fait qu'ils soient apparus, en même temps, sur les écrans n'est pas un hasard à mon avis.
Encore une fois, je vous remercie d'animer ce débat par votre questionnement. Cordialement,
Jean-Claude D'Arcier
jeanclaudedarcier@gmail.com
Marie défie sa famille, aux idées traditionnelles
et brave les mœurs de son époque trop rigide pour vivre
MARIE-MADELEINE
Film britannique de Garth DAVIS – 2018
 Marie Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l’un des personnages religieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire. Ce biopic biblique raconte l’histoire de Marie, une jeune femme en quête d’un nouveau chemin de vie. Soumise aux mœurs de l’époque, Marie défie les traditions de sa famille pour rejoindre un nouveau mouvement social mené par le charismatique Jésus de Nazareth. Elle trouve rapidement sa place au cœur d’un voyage qui va les conduire à Jérusalem.
Marie Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l’un des personnages religieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire. Ce biopic biblique raconte l’histoire de Marie, une jeune femme en quête d’un nouveau chemin de vie. Soumise aux mœurs de l’époque, Marie défie les traditions de sa famille pour rejoindre un nouveau mouvement social mené par le charismatique Jésus de Nazareth. Elle trouve rapidement sa place au cœur d’un voyage qui va les conduire à Jérusalem.
Rooney Mara et Joaquin Phoenix incarnent Marie-Madeleine et Jésus dans ce nouveau film de Garth Davis. Après la renommée acquise grâce à Lion (2016), son premier film, plusieurs fois nommés aux Oscars en 2017, le cinéaste tente ici d’aborder la Bible, et en particulier le personnage de Marie-Madeleine, avec un œil neuf. Le film prend la forme d’une réhabilitation du personnage biblique, probablement pour faire écho à la reconnaissance officielle du Vatican de son rôle d’apôtre de Jésus.
Après l’étonnant Lion, l’actrice Rooney Mara retrouve le réalisateur australien Garth Davis dans ce biopic biblique et épique consacré à Marie-Madeleine. Elle incarne avec force et sensibilité ce personnage énigmatique et controversé du Nouveau Testament. Fille d’une famille de pêcheurs, parfois présentée comme pécheresse et assimilée à une prostituée repentie, Marie-Madeleine fut même considérée par certains comme la femme de Jésus.
Mais, en 2016, le Vatican décréta qu’elle devait être reconnue comme ‘’apôtre des apôtres’’, et non comme une pénitente. C’est cette version rectifiée et positive que Garth Davis développe dans son film. Marie va défier sa famille, aux idées traditionnelles, et braver les mœurs de son époque pour rejoindre le mouvement formé par le charismatique Jésus de Nazareth, qui promet que le monde va changer. Marie-Madeleine cherche une autre façon de vivre et une authenticité qu’elle n’arrive pas à trouver à cause d’une société trop rigide. Au fil de ce parcours, elle devient la plus proche fidèle du Messie.
Alors que la notoriété du groupe commence à s’intensifier et que de plus en plus de personnes adhèrent au message de Jésus, Marie-Madeleine poursuit son voyage spirituel jusqu’à Jérusalem. Cette fidélité donne un sens à sa vie et la conduira jusqu’au pied de la croix et à la Résurrection. Elle doit accepter le destin de Jésus et elle se heurte aux apôtres qui lui refusent le droit de répandre sa parole.
Pendant plusieurs siècles, Marie Madeleine a été considérée comme une prostituée et une pécheresse par l’Eglise, après les propos du Pape Grégoire Ier en 591. En 1969, le concile Vatican II revient sur cette interprétation et estime que la jeune femme n’est pas une pénitente mais bien disciple de Jésus.
Finalement, le Vatican l’a reconnue récemment comme étant l’apôtre des apôtres pour avoir été la première à avoir répandu la nouvelle de la résurrection de Christ auprès des autres disciples. Une décision de l'Eglise qui n’empêche pas l’étiquette de prostituée qui lui a été attribuée, de perdurer dans l’inconscient populaire.
Dans son film, Garth Davis rend ainsi ses lettres de noblesse à Marie Madeleine dans un portrait assez fascinant. S’il s’intéresse bien évidemment au parcours de Jésus-Christ, à la foi chrétienne, aux prêches du prophète en terre sainte, Marie-Madeleine raconte d’abord l’émancipation d’une femme : une jeune fille qui préférera tout quitter pour suivre ses propres convictions et ses désirs plutôt que de se laisser dicter son destin par les hommes.
Cependant, si Garth Davis délivre un message puissant et très contemporain à travers son épopée biblique, son œuvre manque de rythme. Il offre de magnifiques paysages, sublimés par la photographie de Greig Fraser (Zero Dark Thirty, Rogue One) et portés par l’ultime partition musicale du regretté Johan Johannsson. Sa mise en scène est soignée, mais ne suffit pas à accrocher durablement le regard d'un spectateur peu habitué à certaines séquences trop contemplatives.
Même avec les belles prestations du casting, les quatre français Denis Ménochet, Tchéky Karyo, Ariane Labed et surtout Tahar Rahim ( un Judas attachant), le discret Chiwetel Ejiofor (Pierre), Joaquin Phoenix (Jésus) et surtout Rooney Mara (sensible et douce Marie Madeleine), le film ne parvient pas à surmonter certaines longueurs du récit.
Si le film de Garth Davis n’est pas entièrement consacré à un prêche religieux, il pèche par des défauts inhérents au genre. Des images léchées, des compositions hallucinées (de Rooney Mara, hébétée, à Joaquin Phoenix, illuminé par son rôle) pour apporter un regard novateur et féministe sur une page d’histoire et de controverse.
La coïncidence de la sortie du film Marie-Madeleine, rudoyée par sa famille pour ne pas se soumettre à la volonté paternelle de la marier à un homme qu’elle n’aime pas, avec le combat des femmes de notre époque pour leur égalité et leur dignité, pourrait apporter une vraie légitimité à cette oeuvre. Toutefois le cinéaste de Lion ne parvient pas toujours à nous faire croire à l’intérêt qu’il porte à cette destinée unique, quand la figure centrale de son film, même durant ses absences, demeure évidemment celle du Christ, autrement plus essentiel et passionnant dans sa complexité mystique et psychologique.
Plus qu’une oeuvre sur Marie-Madeleine, c’est le film sur Jésus-Christ qui nous inspire le plus. C’est bien le rapport complexe de Jésus aux femmes qui interpelle, et non l’inverse ; notamment la relation qu’il a avec sa mère.
Le projet de montrer Marie-Madeleine comme une Apôtre à part entière est intéressante. Dommage que cela manque de dialogues et d’action. Il ne devait pas être facile à l'époque d'être une femme et de suivre Jésus. Pourtant c'est ce qu'a fait Marie Madeleine. Son histoire méritait d’être mieux connue.
Jean-Claude Faivre d’Arcier Avril 2018
Cette enquête sur la résurrection de Jésus est un bijou
Jésus, l’enquête
Film américain, de Jon Gunn – 2017
 Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur l’histoire du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité…
Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur l’histoire du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité…
Jésus, l’enquête est adapté du livre ‘’Jésus, la parole est à la défense’’, écrit par le journaliste Lee Strobel, personnage principal du film. Il s’agit du 5e long-métrage réalisé par Jon Gunn, mais le premier à sortir dans les salles françaises. Le cinéaste a déjà posé la question de la foi dans Do You Believe ? (2015).
Lee étant athée convaincu, il a de plus en plus de mal à voir sa vie de famille changer, et à ne plus être l'élément central du couple. Il va donc tenter de mener l’enquête pour démontrer à sa femme que la résurrection du Christ n'est qu'une vague supercherie. Ce film, réputé fidèle au livre, montre comment les certitudes peuvent évoluer dans un cheminement rigoureux, comment un mariage qui commence à battre de l'aile peut retrouver un nouveau souffle grâce à l’amour, inspiré par Jésus, comment malgré toutes ces tentatives, Lee Strobel, ne parvient pas à faire chuter l'amour naissant de sa femme pour le Christ. Alors bien sûr, il faut avoir un certain intérêt pour la foi chrétienne pour entrer dans ce débat argumenté. D’autres penseront peut-être que tout cela n'est qu'une vaste fumisterie. Moi, je suis sorti content de la salle et j’ai apprécié la qualité de ce débat. Et je ne suis pas le seul puisqu'il y a eu une salve d'applaudissements à la fin du film, ce qui n’est pas si fréquent. Mention spéciale à Mike Vogel et Erika Christensen qui sont très bons dans leurs rôles respectifs. Scénario, acteurs, situations, tout est remarquable.
Il s'agit d'une histoire vraie, qui tient à la fois de l'enquête policière et d'une très belle histoire d'amour, le tout porté par d'excellents acteurs. Les situations, notamment autour de ce conflit familial, sont jouées avec beaucoup de justesse - ce qui était un challenge et le jeu des acteurs est un petit bonheur à lui tout seul. L'enquête de Lee sur les raisons factuelles de croire à la mort et à la résurrection de Jésus, est menée avec une rigueur et une grande ténacité sans rien laisser au hasard - cela n'a rien d'étonnant de la part d'un journaliste d'investigation - mais le résultat est là : on en ressort fortement impressionné. Ce scénario la, on ne pouvait pas l'inventer. Bref, Jésus, l'Enquête est un petit bijou du genre, à aller voir en famille ou avec des amis, et dont on ressort le sourire aux lèvres, et en emportant avec soi de profondes pistes de réflexions. Je le recommande chaudement.
Jean-Claude Faivre d’Arcier Avril 2018
Ce film est une enquête sur l’existence de Dieu
L’APPARITION
Film français de Xavier Giannoli – 2018
 Le Vatican est en train de mener une enquête canonique sur Anna, une jeune femme de 18 ans qui affirme avoir vu la Vierge Marie. Il demande à Jacques Mayano, grand reporter dans un quotidien français, de participer à la commission d’enquête. Cet homme de raison se rend dans la petite ville du sud-est de la France où s’est déroulé le phénomène. Il fouille le passé d’Anna et découvre qu’elle a eu une enfance chaotique et sans amour. Le Père Borodine a pris la jeune fille sous son aile et croit dur comme fer à ses visions. En cherchant des preuves, Jacques affronte l’homme d’Eglise. De son côté, Anna, qui a su le percer à jour, commence à le faire douter…
Le Vatican est en train de mener une enquête canonique sur Anna, une jeune femme de 18 ans qui affirme avoir vu la Vierge Marie. Il demande à Jacques Mayano, grand reporter dans un quotidien français, de participer à la commission d’enquête. Cet homme de raison se rend dans la petite ville du sud-est de la France où s’est déroulé le phénomène. Il fouille le passé d’Anna et découvre qu’elle a eu une enfance chaotique et sans amour. Le Père Borodine a pris la jeune fille sous son aile et croit dur comme fer à ses visions. En cherchant des preuves, Jacques affronte l’homme d’Eglise. De son côté, Anna, qui a su le percer à jour, commence à le faire douter…
Dans L’Apparition, le rôle du journaliste est remarquablement interprété par Vincent Lindon. Il se retrouve rapidement devant des coïncidences dont il se demande si elles ne sont pas des signes. Info ou intox ? Réalité ou superstition ? Le film, construit comme un thriller, tient plus du cinéma de genre que de la réflexion théologique. Le réalisateur de Marguerite s’intéresse certes à la foi, mais de façon ludique, en entraînant le spectateur dans les investigations de son héros. Il n’est pas besoin de croire en quoi que ce soit pour se laisser happer par une intrigue aussi passionnante que bien documentée.
« Je me suis inspiré des enquêtes canoniques tout à fait sérieuses auxquelles se livre l’Église, qui préfère, comme le dit quelqu’un dans le film, passer à côté d’un vrai phénomène plutôt que de prendre le risque de valider une imposture », confie Xavier Giannoli à 20 Minutes. Son héros, sceptique par nature et totalement étranger au milieu religieux, se laisse progressivement gagner par le mystère qui entoure cette fille lumineuse (Galatea Bellugi). Le cinéaste a ainsi pu constater que certaines manifestations miraculeuses sont validées par les autorités ecclésiastiques, comme ce fut le cas très récemment, le 11 février 2018, avec la guérison d’une religieuse paralysée : ‘’Mon héros est un honnête homme qui va découvrir qu’il existe des choses qu’on ne peut pas expliquer’’, précise Xavier Giannoli. Le roman L’Exorciste de William P. Blatty et le film Zodiac de David Fincher lui ont aussi servi d’inspiration. ‘’Je voulais que le film soit construit comme un polar, comme un divertissement à suspense’’, a-t-il déclaré.
On s’identifie immédiatement à ce reporter curieux qui voit ses certitudes voler en éclats. ‘’Il n’y a pas de bondieuseries dans mon film. Je préfère insister sur le fait que la foi est quelque chose d’intime, un message que je crois important à notre époque. En fin de compte, c’est une enquête sur l’existence de Dieu’’, précise le réalisateur. Comme le personnage principal, chacun se fera son opinion à la fin de cette histoire intrigante dont on ressort agréablement secoué.
Le réalisateur sonde le mystère de la foi dans un monde où la quête de la vérité est de plus en plus difficile. Le sujet de la foi fait penser au film de Xavier Beauvois "Des hommes et des dieux" (2010), dont Giannoli n’est pas très éloigné dans son approche cinématographique. Leur approche de la foi est différente : Beauvois raconte la vie et l’assassinat des moines de Tibhirine (1996), tandis que Giannoli traite d'une apparition de la Vierge Marie, comme d'un fait divers très documenté. La recherche de la vérité d’un fait et la vie de foi ne sont pas sur le même plan. La foi n’est pas une déduction rationnelle ; elle est vécue comme une conviction intérieure. La recherche de la vérité passe par l’accumulation de preuves démontrables. Le scénario de Giannoli joue sur ces deux plans en confrontant le scepticisme de l’enquêteur au mysticisme de la voyante (étonnante Galatea Bellugi), avec un prêtre dominateur (excellent Patrick d’Assumçao), un fanatique inquiétant (Anatole Daubman) et une foule de pèlerins plus non moins exaltés.
La description de la complexité de la situation, avec l’ambiguïté des prêtres qui entourent Anna, les méthodes de la commission d’enquête ou le recours à des techniques scientifiques pour sonder le mystère reflètent le souci du réalisateur de se situer au plus près de la réalité. Mais la rencontre entre Jacques et Anna va faire basculer le film dans une autre dimension. Tandis que le tumulte grandit autour d’eux et que les pressions se font de plus en plus fortes, leur relation s’approfondit, laissant la place aux questionnements et aux doutes. Ceux du reporter qui traque l’imposture mais aussi ceux de l’homme, qui est touché par la sincérité de la jeune fille. La présence et le jeu tout en retenue de Vincent Lindon et de l’étonnante Galatea Bellugi font de leur rencontre un moment d’une rare intensité. Le réalisateur oppose la force massive de Vincent Lindon à la grâce légère de sa jeune actrice.
L’impatience de Jacques à trouver des réponses tandis qu’Anna semble de plus en plus dépassée par son histoire, nous entraine, sur un rythme fiévreux, jusqu’à un épilogue surprenant et déconcertant.
Dans ce film, sans doute le plus personnel de X. Giannoli, il a concentré toutes ses obsessions. Peu importe au fond la résolution de l’histoire, c’est le mystère de la foi qui se passe de preuves, qui l’intéresse. Cette « intuition d’une transcendance » le passionne et elle s’est très tôt mélangée à son désir de cinéma. Mais aussi la quête de vérité et de sens dans un monde hyper médiatisé où la frontière avec le mensonge a de plus en plus tendance à s’estomper.
Jean-Claude Faivre d’Arcier Avril 2018
Être épanouie afin de trouver notre place dans le monde
LA FIANCEE DU DESERT
Film Argentin de Cécilia ATAN et Valeria PIVATO – 2017
 Renvoyée après des années de bons et loyaux services au sein d’une même famille, Teresa, 54 ans, est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage en bus, à l’autre bout du pays, à travers l’immensité du désert argentin, sans savoir que ce trajet va profondément bousculer sa routine. Le début d’une nouvelle vie ?...
Renvoyée après des années de bons et loyaux services au sein d’une même famille, Teresa, 54 ans, est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage en bus, à l’autre bout du pays, à travers l’immensité du désert argentin, sans savoir que ce trajet va profondément bousculer sa routine. Le début d’une nouvelle vie ?...
La fiancée du désert est le premier long-métrage réalisé par les deux argentines Cécilia Atan et Valeria Pivato. Dans le rôle de Teresa, on retrouve Paulina Garcia, véritable star au Chili. Le duo des réalisatrices explique son intention principale : ‘’A une époque où l’on cherche à nous convaincre que tout ce qui n’a pas été tenté dans notre jeunesse ne pourra jamais l’être plus tard, nous avions souhaité réaffirmer l’importance de la quête, du temps qui passe, du travail nécessaire à notre épanouissement afin de trouver la place qui est la nôtre’’. Le film a été présenté au festival de Cannes 2017 dans la section ‘’Un Certain Regard’’.
En 2013, Paulina Garcia séduisait les spectateurs du monde entier avec Gloria. Sebastian Lelio y renouvelait une figure féminine en suivant une quinquagénaire chilienne, désemparée face au vide qui s’ouvrait devant elle, après un divorce. Garcia incarnait, avec une incroyable présence, ce personnage qui réapprenait à être sûre d’elle et à maîtriser le second souffle de sa vie de senior. La fiancée du désert lui donne un nouveau rôle de femme au moment où la fleur de l’âge commence à se faner.
Hormis ce parallèle générationnel, Teresa n’a pourtant pas grand-chose en commun avec Gloria, si ce n’est de se trouver à la croisée des chemins. Le film de Cécilia Atlan et Valeria Pivato l’affirme encore plus, en plaçant Teresa au milieu de nulle part, sur une route qui traverse le désert, dans un bus qui tombe en panne ; de quoi perturber cette employée de maison sans histoire, qui se retrouve sans aucun repère. Au service de la même famille depuis tant d’années qu’elle en a oublié sa propre vie, la voilà occupée à chercher à joindre son nouvel employeur à San Juan. Un trajet qui n’aurait dû qu’être un petit interlude dans sa vie rangée, mais qui va devenir une parenthèse plus large, puis une réelle épopée lorsqu’elle oublie son sac dans le camion de Gringo (Claudio Rissi), un vendeur ambulant de vêtements. Teresa part à sa recherche, le retrouve et il lui propose de l’aider à retrouver son sac en rebroussant chemin.
On ne sait pas trop ce qu’il y a dans ce sac auquel Teresa tient tant, mais c’est sa tête et son cœur qu’elle parvient à vider auprès de Gringo, qui a fait le choix d’une vie itinérante. Leur rencontre rappelle celle d’une touriste autrichienne, larguée dans un motel au milieu du désert, dans Bagdad Café (1987). La fiancée du désert invite, de la même manière, cette femme à s’ouvrir à un autre monde que le sien, à se laisser gagner par lui pour s’y réchauffer. Paulina Garcia se transforme à vue d’œil, d’une dame craintive et cloîtrée sur elle-même, en une femme qui découvre qu’on peut s’épanouir en profitant des petits plaisirs de la vie. Alors qu’elle était perdue dans ce désert, voilà que son horizon s’élargit peu à peu : elle découvre qu’elle n’était pas si malheureuse dans la famille où elle avait travaillé, mais qu’elle s’était laissé enfermer inconsciemment dans une routine quotidienne.
Où ira-t-elle après cette traversée inattendue ? Le film ne le dit pas. Mais un vrai sourire, encore bien discret, est apparu sur son visage et nous rassure sur sa vie future.
L’amour n’a pas d’âge. Et le talent non plus. Ce premier film de deux réalisatrices argentines parle avec une profonde tendresse de l’amour entre seniors. Du voyage de cette employée de maison, magnifiquement interprétée par Pauline Garcia, qui va rencontrer l’amour après avoir toujours vécu pour les autres, il émane une beauté́ singulière, un goût pour le cinéma des grands espaces et une émotion pleine d’humanité́. Un road-movie de la sagesse, un petit bijou hors du temps, une belle rencontre, dans des paysages vides mais étrangement chaleureux, entre une femme lasse et un colosse au cœur tendre. Les deux réalisatrices semblent perpétuer la délicatesse de la ‘’nouvelle vague’’ argentine, tant célébrée en France il y a quelques années.
Jean-Claude Faivre Mars 2018
Comment lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
UN HOMME INTEGRE
Film Iranien de Mohammad RASOULOF – 2017
 Reza, installé en pleine nature dans le sud de l’Iran avec sa femme Hadis, directrice du lycée local et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais comment lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
Reza, installé en pleine nature dans le sud de l’Iran avec sa femme Hadis, directrice du lycée local et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais comment lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
Au début du film, on voit Reza (Reza Akhlaghirad) injecter à la seringue de l’alcool dans des pastèques qu’il entrepose à l’abri des regards. Du pourrissement du fruit et de sa macération, il obtient une boisson (interdite) dont il s’enivre seul à l’abri d’une grotte. Une nuée d’oiseaux voraces. Un lac constellé de poissons rouges le ventre en l’air. Un essaim de motards casqués. Une maison en flammes… Ce sont quelques-unes des images à la fois sublime et terrifiantes qui émaillent Un homme intègre de Mohammad Rasoulof. C’est l’histoire d’un homme, Reza, qui vit avec sa femme Hadis (Soudabeh Boizaee) et leur petit garçon. Après avoir refusé de donner un pot de vin à un banquier, il ne peut pas échapper à l’énorme majoration qu’on lui inflige pour retard de paiement. Et c’est le début d’une série de catastrophes dont certaines font penser aux plaies d’Egypte.
Le réalisateur iranien de La Vie sur l’eau (2005) est assigné à résidence dans son pays depuis octobre 2017. Il s’est vu confisquer son passeport après la présentation de son dernier film dans de nombreux festivals, dont celui de Cannes en mai dernier, où il a reçu le Prix Un Certain Regard. Son sixième long-métrage de fiction est un implacable constat de la terreur sourde que fait peser sur la population, l’Etat iranien à tous les échelons de la hiérarchie. La mise en scène est précise, délicate ; elle ménage des moments de chaleur humaine d’une belle simplicité, entre les parents et leur fils, et aussi dans leur couple où l’amour circule. Elle fait exister une multitude de personnages secondaires, parmi lesquels une famille chrétienne dont on apprend qu’elle ne peut ni scolariser ses enfants, ni même obtenir une sépulture pour l’un de ses morts. Certains viennent encore nous informer sur le passé de Reza et Hadis, autrefois installés à Téhéran. L’enchaînement des désastres ponctue chaque renoncement, celui de Hadis d’abord qui tente d’agir de son côté, puis celui de Reza, qui décide d’agir… Beau et terrible, le film ne cesse de sombrer avec ses personnages dans un abîme de plus en plus profond…
Citadins, Reza et Hadis ont tenté d’échapper au sort qui, en Iran, voue chacun à se retrouver du côté des oppresseurs ou des oppressés. Les voilà prisonniers d’une communauté villageoise fermée sur ses intérêts, des potentats mafieux qui la mettent en coupe réglée. Au sommet, sévit une « Compagnie » sans dénomination. Organisme privé, la Compagnie entend faire main basse sur les terres hypothéquées de Reza, entravé par des dettes dont il ne demande qu’à s’acquitter. La trajectoire de cet honnête homme va s’emballer comme dans un film noir : Services Publics, banques, assurances, police, tribunaux, la circulation de l’argent pourrit l’ensemble des échanges, broie tout espoir d’un pacte social, lamine au plus intime. Le silence condamne les vivants à son tombeau. Le système détient le pouvoir sur les terres, les armes, les corps, l’eau et le feu. Il écrase les pauvres sous son joug. Celui qui se rebelle paie le prix du sang.
La dramaturgie du pire à venir emporte Reza dans un combat frontal qui l’oppose au chef du clan criminel du lieu. Sous ses ordres et ceux de la Compagnie, l’eau qui alimente la ferme de Reza est brusquement coupée. Plus tard, une altercation l’opposera au despote local, conduira Reza en prison et le placera sous le coup de poursuites et d’exigences financières insensées. Face aux menaces, aux rumeurs mortelles et aux faux témoignages, Reza lutte avec toute son intégrité morale. Sa femme Hadis le comprend profondément mais se montre plus encline à jouer le jeu du compromis pour protéger sa famille. Elle franchira la ligne jaune en usant même de sa position de directrice de lycée pour faire pression sur une élève. Reza, de temps à autre, va renouveler ses ressources morales dans le secret de sa grotte où, tout en se baignant, il boit le vin de sa fabrication. Mais quelle vérité peut-elle sortir de cette impasse ? Au royaume du mensonge et de violence, la vérité peut-elle être reconnue comme une preuve ?
Le choix du sujet de Mohammad Rasoulof pour Un homme intègre lui a été inspiré par son expérience personnelle. Il a subit un contrôle policier de routine qui s’est conclut par une demande de pot de vin, puis un séjour en prison après son dépôt de plainte, preuves à l’appui, contre ses opposants… D’après lui, ce type de corruption serait généralisé en Iran. Cette pratique ne se limite pas à ce pays, loin s’en faut, elle règne partout. Mais la dénoncer dans un pays musulman ne peut que déranger l’Etat islamique, même si celui-ci se moque de la diffusion de tels films, tant que ce n’est pas dans ses frontières intérieures.
On aimerait voir un tel sujet traité en Europe, par rapport à l’influence des lobbys dans le Parlement français ou européen par exemple… Dans "Léviathan" Andreï Zvyagintsev dénonçait la corruption d’un maire russe pour s’approprier la maison d’un garagiste. Dans "Un homme intègre", il s’agit d’une compagnie des eaux qui cherche à déloger un pisciculteur gênant. Mais Mohammad Rasoulof va au-delà de la corruption simple en interrogeant ses conséquences dans la vie d’un couple et la réponse à y donner.
Cette corruption va jusqu’à corrompre la vie de couple de Reza et Hadis et de leur jeune fils. Elle va gâcher leur vie, les amener à se disputer, alors qu’ils s’aiment et cherchent à avoir une conduite droite. Mais la pression est telle que Reza, mis en doute par son épouse, va devoir appliquer les méthodes-mêmes de ses opposants pour les contrer. En ce sens Un homme intègre, au-delà de la question sociétale qu’il pose, rejoint une question plus profonde : peut-on faire usage des méthodes de ses ennemis pour les contrer ?
On aimerait voir un tel sujet traité en Europe, par exemple sur l’influence des lobbys sur le Parlement français ou européen… Dans son film Léviathan, Andreï Zviaguintsev dénonçait la corruption d’un maire russe pour s’approprier la maison d’un garagiste. Dans Un homme intègre, il s’agit d’une compagnie des eaux qui cherche à déloger un pisciculteur gênant. Mais Mohammad Rasoulof va au-delà de la corruption simple en interrogeant aussi ses conséquences dans la vie d’un couple et dans la dégradation des relations sociales de son pays. Ce grand film mérite vraiment d’être vu.
Jean-Claude Faivre Mars 2018
Un portrait varié de la fascination du mal qu’il peut exercer
MARIANA (LOS PERROS)
Film Franco-Chilien de Marcela SAID – 2017

Mariana, une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie chilienne, s’efforce d’échapper au rôle que son père, puis son mari, ont toujours défini pour elle. Elle éprouve une étrange attirance pour Juan, son professeur d’équitation de 60 ans, ex-colonel suspecté d’exactions pendant la dictature. Mais cette liaison ébranle les murs invisibles qui protègent sa famille d’un passé compromettant…Jusqu’où Mariana, curieuse, insolente et imprévisible ira-t-elle ?
La réalisatrice, Marcela Said s’explique sur son film : ‘’Lorsque j’ai abordé l’écriture du scénario, j’ai réalisé que ce n’était pas une histoire d’amour entre le Colonel et Mariana que j’écrivais, mais l’histoire d’une femme encerclée par quatre hommes, féroces comme des chiens (d’où le titre original du film) : le mari, le père, le colonel et le policier.
Le monde de Mariana est complexe. A travers ses yeux, nous pénétrons dans la haute société chilienne, une société marquée par la violence et le déni de ses responsabilités concernant l’établissement de la dictature, sa perpétuation et les crimes commis. Le contexte du film est ainsi celui d’un pays gagné par une violence sourde, où les quarantenaires bien-nés qui entourent Mariana méprisent la junte militaire salie par les affaires, tout en fermant les yeux sur l’origine de leur propre prospérité.
Malgré le fort ancrage contextuel du film, il s’agit d’une histoire qui n’est pas spécifiquement chilienne. L’idée que la valeur d’un homme ne peut pas être réduite à celle de ses actes est centrale de ce point de vue. Des connexions peuvent aisément être faites, par exemple avec la bourgeoisie de la vieille Europe à forte tendance patriarcale.
Avant de réaliser L’été des poissons volants (Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2013), j’avais réalisé trois documentaires qui traitent de sujets politiques : I love Pinochet, portrait d’un fascisme ordinaire en 2001, Opus Dei, voyage au cœur d’un mouvement intégriste catholique, et El Mocito, où j’ai fais la connaissance de Juan Morales Salgado, ex-colonel de l’armée, qui était à ce moment-là, maître d’équitation dans un centre équestre proche de Santiago et qui fut le chef du centre de répression Simon Bolivar, duquel des centaines de personnes avaient disparu…’’
Le cinéma chilien ne lâchera pas facilement le morceau. L’impact des années de dictature de Pinochet continue à hanter les réalisateurs et les artistes. Ce qui n’empêche pas de suivre des axes différents pour faire le portrait varié de la persistance du mal et de la fascination qu’il peut exercer sur ses victimes, comme sur ses bourreaux. Plus une grande bourgeoise s’approche de l’ex-colonel qui lui donne des cours d’équitation, plus c’est une plaie collective qui remonte à la surface. Mariana rouvre cette plaie, ce tabou, non pas pour faire le procès de cet ancien militaire, mais celui du milieu patriarcal familial quand l’époux et le père de cette femme lui demandent de cesser de voir cet homme, afin que la réputation de la famille ne soit pas ternie. Mariana défie ces ordres, autant par envie de mener sa propre enquête que par volonté d’émancipation. Peut-on se libérer d’un tel poids en tombant dans les bras d’un homme qui symbolise la chape de plomb qui a verrouillé le Chili ? La question est difficile. Marcela Said la pose de manière encore plus provocante avec son personnage principal qui va jusqu’à menacer de ne plus protéger la lignée familiale. Mariana dérange en proposant de couper net les branches pourries d’un arbre généalogique, tout en auscultant les racines pour voir jusqu’où le poison les a atteintes.
Cette émancipation familiale et politique permet à Marcela Said de dresser le portrait attachant d’un personnage sur la brèche, incarné avec générosité par Antonia Zegers tour à tour fragile ou insolente, touchante ou intrigante qui écrase de son imprévisible énergie son partenaire, Alfredo Castro, dont la capacité à passer sans encombres de l’ombre à la lumière force pourtant l’admiration.
Dans une atmosphère de tension et de mystère, soutenue par une musique aux sons languissants et par des images métaphoriques, la narration se fait discrète afin de favoriser le ressenti du spectateur, tandis qu’une mise en scène épurée distille une violence sourde provenant de ces classes aisées qui méprisent les militaires salis par les affaires, tout en fermant les yeux sur les origines de leurs passe-droit. Tout cela transmet, au spectateur tenu en haleine, le sentiment d’une insécurité permanente. En choisissant finalement de donner à son personnage principal un aspect plus servile qu’héroïque, la réalisatrice remplit avec brio la mission qu’elle s’est fixée : faire du cinéma non pas pour plaire mais pour faire réfléchir.
Dans ce monde d’hommes et cette société patriarcale, la moindre décision de Mariana est observée, commentée, contrariée le plus souvent : faire entendre sa volonté et ses convictions s’oppose le plus souvent aux conseils qu’elle reçoit, qu’ils soient sincères et de bons sens, ou uniquement dans le but de préserver une tranquillité familiale. Sa relation avec le Colonel lui révélera son attirance vers le mal en même temps que sa présence latente et cachée dans le pays actuel, particulièrement dans le mensonge et le déni de responsabilité des classes aisées de la société chilienne durant la dictature. Si Pinochet n’est plus là, la lâcheté des personnes impliquées et leur peur d’être découvertes, gangrènent le pays. Le titre original Los Perros est venu d’El Mocito lui-même, à qui la réalisatrice a consacré un documentaire du même nom, qui disait : ‘’On était des chiens’’. Chacun peut se révéler un jour le bourreau de l’autre. A mesure que les complicités civiles affleurent, Mariana découvre ce nouveau monde pourtant familier, dernière le masque qu’il a toujours porté, comme c’était le cas déjà dans le film précédent, L’Été des poissons volants, où règne une violence omniprésente. L’éclairage de George Lechaptois qui joue parfaitement avec ces zones d’ombres, ainsi que la musique inquiétante, en apesanteur, de Grégoire Auger, participent à cette tension constante, à cette violence latente au bord de l’explosion. Marcela Said propose une sorte de film d’épouvante ancré dans le réel. Mariana dérange, ébranle nos certitudes, pour notre plus grand bien.
Jean-Claude Faivre Mars 2018
Un thriller politique très réaliste
EL PRESIDENTE
Film Franco-Hispano-Argentin de Santiago MITRE, 2017

Hernan Blanco, président argentin, vient d’arriver dans un luxueux hôtel de la Cordillère des Andes, où doit se tenir un sommet des chefs d’Etats latino-américains. Mais, très rapidement, l’homme est confronté à une affaire qui implique sa fille et pourrait bien le mettre en difficulté politiquement. Tandis qu’il cherche une porte de sortie, Blanco doit également tenir bon lors des âpres négociations entre pays voisins ; négociations dont les États-Unis ne sont jamais très éloignés…
Présenté dans la section ‘’Un Certain regard’’ au Festival de Cannes, en mai dernier, El Presidente est le 6e long-métrage de Santiago Mitre. Le réalisateur tenait absolument à ce que Ricardo Darin incarne le rôle principal du président : ‘’Pour moi, il est le seul comédien argentin qui ait la stature et l’énergie pour interpréter un tel personnage. Il est très charismatique’’. L’équipe a pu tourner une partie du film au sein de la Casa Rosada à Buenos Aires.
Nul doute, la politique est un sujet qui est cher au réalisateur argentin. Il a déjà exploré cet univers, sous différents aspects dans ces précédents films : El Estudiente, un récit d’apprentissage politique, et Paulina, qui évoquait l’engagement d’une jeune avocate en faveur des populations défavorisées. Avec ce dernier film, Santiago Mitre nous plonge dans les coulisses du pouvoir politique. Dans cet hôtel isolé en altitude, où doit se tenir le sommet des chefs d’Etat latino-américains, d’importantes questions vont être mises sur la table, notamment en matière énergétique. Des enjeux qui pourraient changer l’avenir du continent entier. Hernan Blanco, le nouveau président, est incarné par le saisissant Ricardo Darin, littéralement ‘’en état de grâce’’ dans ce film. Il a une partie importante à jouer dans ces négociations, qui se trouve compromises par l’implication de sa fille dans une affaire de corruption. Santiago Mitre nous livre ici un thriller politico-psychologique au rythme effréné, captivant le spectateur par ses multiples rebondissements et même par d’étonnantes digressions vers le fantastique.
Nous sommes à 3000 mètres d'altitude, dans un luxueux hôtel de la Cordillère chilienne. Les pays latino-américains s'y retrouvent pour parler pétrole, inutile donc de préciser que c'est du sérieux. Objectif : la création d'une OPEP sud-américaine, capable de tenir une position commune sur les marchés. Le Brésil mène le bal avec son leader charismatique, populaire et redouté. L'Argentine est en retrait, avec son président discret, élu sur un slogan "un homme comme vous", un président normal. Cette image de Monsieur Tout le Monde, qui l'a aidée à accéder au pouvoir, le dessert désormais.
La description du sommet est impeccable. Santiago Mitre décrit finement les mécanismes de la négociation et des pressions en coulisse. Derrière le décorum, c’est un jeu d’échec diplomatique subtil qui se met en place dans les salles de réunion du palace. Politicien roué mais président inexpérimenté, Hernán Blanco est ballotté entre la puissance du courant antilibéral porté par le leader brésilien très populaire et l’influence en sous-mains des États-Unis qui mènent le jeu. Un thriller politique somme toute très réaliste...
Santiago Mitre ne force pas le trait, et propose un petit théâtre de la cruauté qui invite à se méfier des faux-semblants et des apparences. Le film transcende alors son contexte politique pour mettre en évidence l’hypocrisie des rapports sociaux : force est de constater que la ruse et le pouvoir de manipulation vont permettre aux plus puissants de dominer. Voici comment l’exprime le cinéaste : ‘’Le film commence de manière documentaire : nous entrons dans la résidence présidentielle par la petite porte, nous déambulons dans le dédale des couloirs, puis nous rencontrons les collaborateurs du président et enfin le président lui-même. Nous le suivons à Santiago du Chili, nous découvrons avec lui l’hôtel où se déroule le sommet, nous faisons la connaissance des autres présidents, et jusque-là le film reste très réaliste. Le ton commence à changer au moment où apparaît la fille de Blanco, Marina (Dolores Fonzi). Ses états d’âme contaminent le film qui devient plus étrange. Les séances d’hypnose viennent renforcer ce décalage volontaire avec le réel. Nous sommes alors dans une construction mentale qui renvoie aux personnages eux-mêmes. Du coup, quand nous revenons au cœur des négociations politiques, l’étrange et le réel se superposent. L’arrivée du conseiller américain est en ce sens très révélatrice de l’ambiance qui habite désormais le film : la rencontre entre lui et Blanco est très ambiguë, chacun agit un peu bizarrement…’’
Ces propos du cinéaste confirment sa démarche, qui est de jouer sur plusieurs registres, sans renoncer pour autant à la charge politique, corrosive mais réelle, pendant toute la durée du film. En dépit de quelques chute de rythme, El Presidente se laisse voir avec intérêt et confirme l’inspiration de son réalisateur.
Est-ce un film politique ? Oui en partie, avec le jeu des alliances entre pays d’Amérique Latine et l'ombre portée des États-Unis. Mais le film est aussi le portrait d'un homme en proie à des soucis familiaux et dont la réputation d'individu "ordinaire" pourrait cacher une personnalité bien plus complexe. Le long-métrage de Mitre ne répond pas à toutes les questions et ce n'est pas plus mal car il laisse planer des doutes dans l'air raréfié à haute altitude. Il y a même un soupçon de fantastique dans deux ou trois scènes marquantes, dont celle d'une hypnose. Toutes les relations sont ambigües dans ce microcosme (le président argentin et sa conseillère, jouée par la remarquable Erica Rivas). Quant à la musique d'Alberto Iglesia (un fidèle d'Almodovar), elle contribue à donner un aspect hitchcockien à ce thriller superbement réalisé. Enfin, Ricardo Darin est encore et toujours parfait.
Qu’est-ce qu’il se passe dans la tête de chacun des personnages lors de ces rendez-vous au sommet ? Tout l’enjeu du film tourne autour de ce point fondamental. Santiago Mitre maitrise parfaitement les silences et les non-dits afin de remettre continuellement en cause ce que le spectateur pense savoir des personnages. Pour tous les amateurs de thriller, c’est un film à ne pas manquer !
Jean-Claude Faivre Mars 2018
‘’Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube,
une promesse qu’elle ne tient jamais’’.
LA PROMESSE DE L’AUBE
Film Français d’Eric BARBIER – 2017
 De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondial, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondial, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
Roman plébiscité, dont la narration s’étale sur 20 ans, La Promesse de l’aube n’est pas, de toutes les œuvres de Romain Gary, la plus facile à adapter à l’écran : Eric Barbier à dû le réduire des deux tiers. Le livre avait déjà fait l’objet d’une adaptation au cinéma en 1970, réalisée par Jules Dassin. Le film a été tourné en Pologne, au Mexique, dans un désert africain, à Nice, Paris et Londres…
Eric Barbier a construit une trame solide pour esquisser la relation fusionnelle entre Nina (Charlotte Gainsbourg) et son fils Romain (Pierre Niney). Une flopée de situations toujours étonnantes, parfois drôles, jamais banales. De rencontres en coups de foudre, d’illusions en déceptions, d’échecs en réussites, cette saga a nécessité trois acteurs pour interpréter les différents âges du personnage de Romain Gary : Pawel Puchalski joue l’enfant, Nemo Schiffman l’adolescent et Pierre Niney l’adulte. De l’autre côté, la mère possessive et romanesque, traverse les scènes avec un maquillage et des artifices qui permettent de n’avoir qu’une seule interprète : Charlotte Gainsbourg. Inattendue dans ce rôle, elle donne une prestation époustouflante. Il a fallu à Eric Barbier quatre années de préparation et une année de montage pour faire aboutir cette épopée filmée.
Alternant passages humoristiques et reconstitutions lourdes, le film est à la hauteur de la vie de l’écrivain et de sa mère, même s’il s’écarte parfois de la vérité. Dans ce film, où l’on n’arrête pas de fumer, on respire une émotion non feinte qui nous aident à oublier quelques longueurs ou cascades peu crédibles. Mais la personnalité de Nina, sa détermination et sa foi indéfectible en la destinée de son fils, cogne avec force : ‘’Je veux que tu sois célèbre de ton vivant ; un jour, tu seras Victor Hugo, tu seras ambassadeur de France’’. Pierre Niney, fines moustaches, excelle dans ce rôle caméléon. Il lui faut se glisser dans la peau d’u Romain Gary, tour à tour aviateur, aventurier, diplomate ou écrivain. A la fois enfantin, masculin, féminin, mêlant le désespoir intense au goût de la séduction, cet enfant qui venge sa mère, tout cela donne le ton de cette œuvre étonnante.
Charlotte Gainsbourg ne fait que confirmer son talent dans son rôle de mère étouffante. Elle avoue s’être souvenue de ses propres grands-parents russes. Elle consacre Nina comme la protagoniste principale de La Promesse de l’aube. A côté de ce duo, on retrouve avec plaisir Jean-Pierre Darroussin en un étonnant Zaremba, amoureux sans succès de Nina, et Didier Bourdon qui fait une courte apparition. Quant à Finnegan Oldfield – qui a le vent en poupe en ce moment avec Marvin ou la Belle Education –, il campe un beau Capitaine Langer.
Trente-sept ans après son suicide, cette adaptation au cinéma aurait de quoi étonner Romain Gary. Le génial natif de Vilnius est devenu une icône… comme le lui avait prédit sa mère. Charlotte Gainsbourg est méconnaissable. Bien loin des personnages larmoyants auxquels elle nous a habitués ces derniers temps, elle vibre sous les traits de Mina, cette mère juive à la fois attachante et monstrueuse. Pour incarner cette femme excentrique, dotée d’une énergie et d’une force de caractère incroyable, elle ose alourdir sa silhouette de vêtements encombrants. Au risque de frôler la caricature, elle adopte une voix rauque teintée d’un accent slave. Et ça marche !
Le couple mère/fils qu’elle forme avec Pierre Niney, dont les nuances de jeu traduisent fidèlement la personnalité multiple de son personnage, reste l’élément central du film, celui autour duquel personne ne s’agrège. Même quand, en dernière partie, tous les codes du cinéma d’action se mettent en place, c’est encore le face-à-face Mina/Romain qui prévaut. Ces deux-là sont liés par une double promesse. Celle que Nina a faite à son fils de l’aimer quoi qu’il advienne, de le soutenir de manière inconsidérée. En échange, Romain lui promet de réussir et de devenir célèbre.
On constate alors que la dynamique du film s’avère être une revanche. Romain a vu sa mère bafouée et humiliée et il veut la venger de toutes ces injustices. Sur fond d’idéalisation de la France de l’entre deux-guerres qui nous réserve quelques belles séquences emblématiques, le film propose un éloge de la volonté, de la tolérance et de l’héroïsme. Entre mélancolie et humour, dépouillé de la moindre trace d’amertume et de cynisme, il exalte une vision de l’existence et permet à chacun d’entre nous de s’identifier au héros à travers ce parcours initiatique sur le thème universel et indémodable de la maternité que cette citation proférée par le principal intéressé résume avec beaucoup d’à propos :‘’Avec l’amour maternel, la vie vous fait, à l’aube, une promesse qu’elle ne tient jamais’’.
Eric Barbier restitue en images la force des mots pour signer une adaptation élégante et bouleversante de La Promesse de l’Aube, cette autobiographie sublimée que l’auteur de ‘’La Vie devant soi’’ a publié en 1960 pour dire que le vrai héros, c’était sa mère, incarnée ici par Charlotte Gainsbourg avec une intensité qu’on lui avait rarement vue au cinéma.
Février 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Un film sur la misère des égarés du rêve américain
illuminée par l’innocence de l’enfance
THE FLORIDA PROJECT
Film Américain de Sean BAKER – 2017
 Dans un motel d’Orlando, Mooney, fillette délurée de 6 ans, fait les quatre cent coups avec ses amis, Scooty et Jancey. Elle passe son temps à embêter les clients, des familles déshéritées, souvent des femmes seules avec leurs enfants, et qui n’ont jamais franchi les portes de Disney World, à quelques centaines de mètres de là. Les enfants enchaînent les bêtises, sous l’œil mi-désespéré mi- amusé de Bobby, le gérant du motel, qui va tenter de venir en aide à la petite fille…
Dans un motel d’Orlando, Mooney, fillette délurée de 6 ans, fait les quatre cent coups avec ses amis, Scooty et Jancey. Elle passe son temps à embêter les clients, des familles déshéritées, souvent des femmes seules avec leurs enfants, et qui n’ont jamais franchi les portes de Disney World, à quelques centaines de mètres de là. Les enfants enchaînent les bêtises, sous l’œil mi-désespéré mi- amusé de Bobby, le gérant du motel, qui va tenter de venir en aide à la petite fille…
Présenté à la Quinzaine des réalisateurs, lors du dernier Festival de Cannes, The Florida Project évoque la situation des familles précaires dans les motels de l’autoroute 192 en Floride. A l’exception de Willem Dafoe, tous les acteurs du film sont inconnus. Sean Baker a bien conscience d’être né du bon côté de l’Amérique. C’est pourquoi il a décidé de donner la parole à ceux que l’on n’entend jamais. Après les immigrés clandestins (Take Out, 2004), les vendeurs à la sauvette (Prince of Broadway, 2008) et les prostituées transgenres (Tangerine, 2015), il raconte le quotidien des habitants d’un motel miteux, en bordure de Disney World, avec Florida Project. C’est une nouvelle chronique de la misère tragique des égarés du rêve américain, cette fois illuminée par l’innocence émerveillée de l’enfance.
Voici comment Sean Baker parle de son film, avec Louis Blanchot de la revue ‘’Trois couleurs’’ éditée par MK 2 :
‘’Comment doit-on comprendre le titre du film ?
SB : Ce n’est pas moi qui ai trouvé ce titre. Il s’agit du nom de code qu’a employé Disney pour promouvoir et vendre son grand projet de Parc d’attractions. Ce titre est donc forcément un peu ironique pour nous ! Mais j’admets que le public l’entende comme ‘’mon projet’’ sur la Floride, comme si j’avais posé ma caméra pour raconter ce lieu. Comme pour Tangerine, j’aime assez l’idée d’un titre qui laisse le spectateur libre. Je veux stimuler votre curiosité pour que vous ayez envie d’en savoir plus et que vous alliez vous renseigner sur ces gens, sur cet endroit. Les films ne devraient pas être une fin en soi, mais au contraire le début de quelque chose.
Votre cinéma s’intéresse aux marges de l’Amérique. Qu’est-ce que la Floride symbolise dans ce portrait ?
SB : Aux États-Unis, on a le droit de se moquer du New Jersey et de la Floride. C’est comme ça, c’est d’accord pour tout le monde. Et c’est justement là où j’ai envie de poser ma caméra. J’ai envie d’aller à l’encontre des discours dominants et de redonner la parole aux gens qu’on enferme dans des cases. Bien sûr, je ne filme pas LA Floride en général. Je filme celle que l’on ne voit pas sur les dépliants et les cartes postales, celle de tous les jours, celle des gens qui se battent pour survivre. Ce sont eux, la véritable beauté des lieux.
Pourquoi avoir choisi la fiction plutôt que le documentaire ?
SB : Pour une raison pratique : le temps. Faire un documentaire, ça prend beaucoup plus de temps que de concevoir une fiction. C’est tellement aléatoire, un documentaire, surtout quand on veut simplement capter la vie des gens. Il faut être au bon endroit au bon moment. Je me considère comme un journaliste : je vais sur le terrain, j’enquête, je rencontre les gens, j’observe. Ce matériau brut construit la fiction, je fais du cinéma local. Je n’ai pas besoin d’écrire ‘’inspiré d’histoires vraies’’ pour qu’on comprenne que mes films sont le reflet d’une réalité sociale, économique, politique très précise. J’ai simplement tendu l’oreille et la main, et les histoires sont venues à moi toutes seules. Les gens ont besoin de se raconter, mais ils ont besoin aussi qu’on les raconte. Comme ce manager de motel qui m’a inspiré le personnage de Bobby (Willem Dafoe). Il avait des tonnes d’histoires à raconter sur les autres, mais il ne voyait pas qu’il était, lui aussi, un personnage passionnant.
Cette manière d’héroïser les gens normaux donne à vos films des allures de conte de fées moderne …
SB : Je ne suis pas très à l’aise avec cette idée de conte ; il y a un côté fantaisie et merveilleux qui me dérange. Ce sont des personnages, certes, mais je ne fantasme pas. Ce serait indécent de réécrire cette vie comme un conte merveilleux. Certains n’aiment pas le film, parce qu’ils trouvent que la mère est un personnage antipathique et qu’elle fait de mauvais choix ; ils trouvent ça obscène. Pour moi, c’est l’inverse : l’obscénité serait de montrer cette mère comme une sainte pure et innocente face à un monde dégueulasse. L’Amérique vit beaucoup trop dans le culte du ‘’storytelling’’ ; il lui faut des histoires à tout prix ! On n’arrête pas de me dire : ‘’il n’y a pas d’histoires dans vos films !’’ Tant mieux. Les histoires qu’on raconte aux États-Unis nous ont trop empêchés de voir la réalité… Le film se construit vraiment au montage. Par exemple, on s’est rendu compte que le bruit incessant des hélicoptères, qui passaient au-dessus de nos têtes pendant le tournage, apporte énormément d’énergie et de force à l’ambiance du film. Comme mon personnage principal est une enfant, je voulais ne pas trop intellectualiser les choses et garder la spontanéité d’un dessin animé. Avec une jeune actrice comme Brooklynn Price, vous n’avez qu’à mettre la caméra en marche pour qu’il se passe quelque chose à l’écran. Elle, c’est l’enfance à l’état pur.
Pourquoi avoir choisi de raconter ce lieu et ces gens du point de vue de l’enfance ?
SB : Il y a dans l’enfance quelque chose de notre innocence à tous. J’aime l’insouciance de Mooney, sa légèreté. En grandissant, on perd cela. Son sourire a beaucoup à nous apprendre…
Vous jouez beaucoup sur les contrastes. Plus les scènes sont tragiques et dures, plus vous mettez de la couleur. On pourrait vous reprocher d’esthétiser la misère…
SB : Certains le font. Mais j’ai du respect pour les gens que je filme. J’admire Ken Loach parce qu’il a toujours su regarder ses personnages sans les filmer de haut. Le cinéma américain s’est toujours intéressé aux marges, mais ça va quand les pauvres ont vraiment l’air pauvre et que tout le monde est à sa place. Dès qu’on donne vraiment la parole aux minorités, ça devient de la pornographie ! Je fais des films pour emmerder ceux qui jugent les autres.
Avec l’élection de Donald Trump, est-ce devenu nécessaire et plus simple de faire des films politiques sur l’état de l’Amérique ?
Pour plaire aux Européens, oui sûrement ! On ne fait pas des films pour donner des leçons ; et l’Amérique de The Florida Project, c’est aussi, et même surtout, l’Amérique de Trump. La majeure partie des gens qui vivent en Floride ont voté pour lui, alors même qu’il les appauvrit encore plus en coupant les financements destinés aux minorités. D’ailleurs, une partie de l’équipe de tournage était pro-Trump. Je pense même que le personnage de Bobby, le gérant du motel, avait voté pour Trump… Peut-être que pour vous, Européens, c’est choquant. Mais ça prouve qu’il y a une vraie différence entre la façon dont vous imaginez ce que sont les États-Unis, l’image construite par les films, les séries, les livres, et la réalité vraie. C’est un pays dont personne ne comprend encore vraiment comment il tient encore debout !...’’
On attendait avec une certaine impatience le nouveau film de Sean Baker, dont on avait découvert le talent en 2015 avec Tangerine, étourdissant exercice de style, tourné avec deux I Phone dans les rues de Los Angeles. Autant dire qu’on n’est pas déçu. Présenté à Cannes, Florida Project est une expérience de cinéma aussi rafraîchissante que radicale, remplie de bruits, de formes et d’émotions. Sous une chaleur qui fait suinter les corps et dégouliner les couleurs, on suit le quotidien d’un motel de la banlieue d’Orlando ; quotidien animé par une bande mômes indomptables et imaginatifs, qui courent partout comme des petites souris en faisant autant de dégâts qu’un troupeau d’éléphants. Une débauche d’énergie tout azimuts, en parallèle de laquelle Sean Baker n’oublie pas d’approfondir une réflexion pénétrante sur l’Amérique des laissés-pour-compte où chacun vivote dans un paradis artificiel, tendu vers son point de rupture.
The Florida Project est quasiment un film sonore, un film de brouhaha permanent, immersif et épuisant. C’est à la fois la force et la limite de ce film, virevoltant et épuisant ; c’est une union des contraires, une ambition grandiose traitée par l’infime et le ludique qui ne fonctionne qu’au charme. Dangereux dans son propos, The Florida Project fonctionne par l’honnêteté du regard de Baker : jamais condescendant, toujours à la bonne hauteur, il semble lui- même avoir trouvé sa place dans ce monde étrange. Pourtant, un peu trop étiré, un peu trop répétitif, le film finit hélas par s’épuiser un peu dans son dernier tiers. Heureusement, une fin magique, magnifique, vient relever d’une touche de douceur terriblement émouvante cette chronique d’un monde fracassé que seule la naïveté de l’enfance préserve : continuer à jouer, à s’amuser, pour éviter de pleurer…
Février 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
L’élément moteur des changements en Chine rural est l’argent.
C’est donc le règne de la survie individuelle et du chacun pour soi.
LE RIRE DE MADAME LIN
Film Franco-chinois de Zhang TAO – 2017
 Dans la province chinoise de Shandong, une vieille dame fait une chute qui la laisse handicapée. Aussitôt, sa famille décide de la placer dans un hospice. En attendant qu’une place se libère, la mère infirme doit résider chez chacun de ses enfants qui, tous, refusent de la prendre en charge et se querellent à son propos. En désespoir de cause ou en guise de défense, la vieille dame est alors prise d’un rire nerveux qui ne veut plus la quitter. Ses enfants, qui ne la comprennent pas et veulent se débarrasser d’elle, s’en étouffent de colère et se comportent mal avec elle …
Dans la province chinoise de Shandong, une vieille dame fait une chute qui la laisse handicapée. Aussitôt, sa famille décide de la placer dans un hospice. En attendant qu’une place se libère, la mère infirme doit résider chez chacun de ses enfants qui, tous, refusent de la prendre en charge et se querellent à son propos. En désespoir de cause ou en guise de défense, la vieille dame est alors prise d’un rire nerveux qui ne veut plus la quitter. Ses enfants, qui ne la comprennent pas et veulent se débarrasser d’elle, s’en étouffent de colère et se comportent mal avec elle …
Le rire de Madame Lin a été présenté au dernier Festival de Cannes, dans le cadre de la sélection de l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID). L’isolement et le suicide chez les personnes âgées vivant dans les zones rurales sont un véritable problème en Chine, où l’on a dû instaurer une loi en 2013 à destination des descendants de ces personnes. Pour ce film, Zhang Tao s’est beaucoup imprégné de la culture populaire de son pays, à la fois dans l’opéra, le cinéma et la littérature.
Le cinéma chinois social n’en finit plus de s’exporter hors de son pays. Le Rire de madame Lin ne fait pas exception à la règle par le biais du distributeur français Sophie Dulac qui nous permet de découvrir le premier long-métrage du réalisateur. La dernière génération des cinéastes locaux se penche de plus en plus sur les changements sociaux en cours, souvent problématiques, mettant en scène leurs idées, souvent en opposition avec celles des autorités de Pékin. Zhang Tao apporte indéniablement une touche particulière à ce mouvement.
Le cinéaste, originaire de la grande province de Shandong au sud de Pékin, déroule une réflexion sur le grand bouleversement opéré depuis des années sur la mentalité de la jeunesse. Le propos évoque l’ennui et la volonté de mouvement, le changement et donc aussi les moyens à mettre en œuvre pour qu’il se produise concrètement. L’élément moteur devient alors, comme partout, l’argent. C’est donc le règne de la survie individuelle et du chacun pour soi. L’une des scènes emblématique de ce que veut montrer le réalisateur Zhang Tao est celle-ci : alors que la vieille Madame Lin (interprétée par Yu Fangyüan) donne 50 Yuan à sa petite fille pour qu’elle s’achète une poupée, elle est obligée, ensuite, de se justifier devant sa famille qui la traite de voleuse car elle voit dans cet acte un geste égoïste, inconscient de la situation matérielle de la famille.
Dans cette séquence, le metteur en scène met en avant la fin d’un partage familial naturel, pour ne pas dire clanique, ainsi que l’infantilisation des vieilles personnes qui, au regard de cette scène, ne sont plus considérées que comme des poids morts, dont il faut se débarrasser au plus vite. Le fond est là, à peine démonstratif, mais tel est le message du film : la société chinoise se divise et met à mal ses racines. Il s’agît d’un danger permanent qui doit être dénoncé. La nouvelle génération se dirige vers un inconnu trouble et elle en subira les conséquences.
Le Rire de madame Lin est d’une facture sobre, les plans sont longs, humbles, contemplatifs et il se dégage, par moments, une petite lumière émotionnelle lorsque les soubresauts de Madame Lin commencent, dans un sorte de rire étouffé, signe d’un désespoir profond et d’une meurtrissure à la hauteur du drame qui se joue dans le plus grand secret du village. Pour un premier film, la réalisation est absolument maitrisée et le propos est d’une limpidité qui ne laissera pas indifférent.
La vieille dame, qui est trimballée entre les différents foyers de sa progéniture, n’est pas dupe. Puisque son amour maternel et sa santé défaillante l’empêchent de se plaindre ou de protester contre son sort, elle va rire, d’une sorte de rire nerveux, dont on ne sait s’il est causé par la lucidité de cette femme sur sa situation tragique ou par une sénilité précoce. Zhang Tao a visiblement le goût de l’ironie noire et présente une vision décapante de cette société villageoise en promotion. Qu’il ait fait appel à d’authentiques villageois comme interprètes ne fait que renforcer le côté désespérant de cet état des lieux social. Dans le dos de Madame Lin, la tambouille familiale bouillonne à petit feu, faisant mijoter rancœurs et jalousies, mêlés de remords. L’image de la famille chinoise, unie et prête à tout pour préserver ses aînés, est bien ternie dans cette invraisemblable mise à jour des mœurs réels : ici, on parle plus d’argent que de sentiments. Jusqu’à laisser planer un doute sur la véritable réaction de Madame Lin : et si ce n’était pas un rire qui émanait d’elle, mais d’inextinguibles sanglots ? Les mêmes que ceux qu’on a envie de verser devant la finale, aussi absurde que révoltante, de ce film magnifique.
Février 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Quand le passé entraîne un vieux cow-boy dans une quête spirituelle …
LUCKY
Film américain de John Carroll LYNCH – 2017
 Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville du sud des États-Unis, perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans passés l’entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique…
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville du sud des États-Unis, perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans passés l’entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique…
Apparu dans de nombreux films et séries en tant qu’acteur (Fargo, Zodiac, American Horror Story), John Carroll Lynch signe avec Lucky son premier film en tant que réalisateur. Un cap qu’il rêvait de passer depuis longtemps : ‘’J’ai toujours été attiré par la narration et la construction d’un récit. C’est une chose de comprendre une histoire quand on la lit, mais quand on passe du côté de la réalisation, il faut réussir à l’orchestrer. Le film a été écrit spécialement pour Harry Dean Stanton.
Le générique s’ouvre sur la mention ‘’Harry Dean Stanton is Lucky’’. Une ironie renforcée par le décès de l’acteur, en septembre 2017, ayant rendu ce film posthume. Stanton aura effectivement eu la chance de conclure sa carrière avec ce projet devenu le magnifique éloge d’une vie. Quasi portrait d’un acteur ayant traversé le cinéma américain depuis les années 50, Lucky est plus qu’un western philosophique sur le sens de la vie : c’est un nécessaire éloge poétique et solaire à Harry Dean Stanton, et à la vie.
La mort de l’acteur ne pourra plus être dissociée de ce beau film, surtout quand il est question de la disparition de ce vieux cow-boy à la face lézardée, qui semble fossilisé dans ses habitudes : aller s’asseoir à la table d’un restaurant pour faire des mots croisés, discuter avec Joé, la patron de l’établissement, ou avec les serveuses, rentrer dans son mobil-home pour se poser sur le canapé et regarder des jeux télévisés. Puis ressortir pour aller boire un pot au bar du bled avec ses vieux copains ; sans oublier d’aller acheter ses trois paquets de cigarettes à l’épicerie en draguant gentiment la caissière mexicaine.
Lucky semble avoir toujours été là et destiné à y rester. Même son médecin considère que l’ancêtre est toujours en pleine forme, même s’il a fait une chute inquiétante, il va enterrer tous les habitants de la ville. Mais cette nouvelle ébranle Lucky, athée de toujours : quel peut bien être le sens de la vie ?
Stanton a nourri le film par ses anecdotes et ses réflexions. Par exemple, quand le personnage évoque son passé de soldat dans l’US Navy pendant la Seconde Guerre Mondiale ou sous les attaques des kamikazes japonais, ça pourrait aussi bien être Stanton qui le raconte. Quand Lucky commence à se poser la question du bilan de sa vie, c’est tout autant Stanton qui le fait. Il semblait avoir toujours fait partie du cinéma, depuis 1950 à travers plus de 200 films, dont Paris-Texas, en 1984 avec Wim Wenders, et paraissait immortel. Il s’accrochait malgré lui à la vie, à l’image de cette tortue centenaire, baptisée ‘’Théodore Roosevelt’’, qui s’échappe pour vivre sa vie. Lucky est coincé par l’idée de cette mort qui ne vient pas, par la peur de la solitude, de ne plus trouver à qui se confier, ni personne à aimer. Le film cherche à conjurer ces angoisses, en utilisant la chanson de Johnny Cash ‘’I see a darkness’’ (je vois l’obscurité), dont le sens apparaît clairement dans ce contexte : il faut se préparer à la mort qui est l’aboutissement naturel de la vie. Lucky est quelqu’un de très solitaire. Pourtant, tous les habitants de la ville ont de l’estime et de la tendresse pour lui. C’est comme si les habitants connaissaient mieux Lucky que lui-même. Il ne se voit pas comme un membre de la communauté, alors qu’il en fait intimement partie ; par exemple dans cette fiesta où il est invité pour l’anniversaire d’un jeune et où spontanément, il se met à chanter une chanson qui est reprise par tout le monde. Au fond, il souffre de cette illusion d’indépendance, qui le maintient à l’écart, alors qu’il est au cœur de ce réseau de relations communautaires.
Comme le dit le réalisateur JC Lynch : ‘’Lucky est un solitaire, amoureux des puzzles et de la vie. Il aime croire qu’il est maître de son destin. Il a confiance en lui, en son autonomie et se croit plus intelligent que les autres. Mais il doit faire face à sa propre vulnérabilité ; sa première réaction est de pester et de se renfermer dans cette sorte d’autosuffisance, en rejetant toute connexion humaine’’.
Le film est ainsi teinté d’une relative noirceur, atténuée cependant par une touche agréablement goguenarde. Harry Dean Stanton, très amaigri, déambule comme dans le désert de Wim Wenders, mais cette fois d’une manière bien moins assurée, se rendant successivement dans un café, une supérette, un bar, où les auteurs de ce film fort sympathique l’encouragent à exprimer sa philosophie de la vie. La photo, aux tons chauds, est très soignée et signée par Tim Suhrstedt ; la réalisation de John Carroll Lynch est discrète, constamment au service des comédiens ; le montage, quant à lui, est sobre et bien rythmé, comme une sonate. Le film, dans son avant-dernier plan, nous montre Harry Dean Stanton qui scrute un très haut cactus, encore plus desséché que lui, puis qui nous regarde longuement, finit par sourire et s’en va sur ce sol aride, tandis que la tortue rentre à la maison. Beau départ testamentaire qui nous invite à méditer sur nos propres déserts.
Récit et mise en scène convoquent une imagerie ancrée dans la culture américaine : la lumière écrasée de soleil, les longues landes désertiques, les lieux de rencontre où les personnages viennent mettre en valeur la figure du vieil homme… Au cœur de ce dispositif, Harry Dean Stanton trimbale plus de cinquante ans d’histoire du cinéma et à travers elle le mythe d’un pays dont les coins les plus reculés nourrissent la légende.
Incarné par un acteur qui trouve ici le second premier rôle de sa carrière, Lucky suscite la sympathie. Et puis, il suffit de voir Harry Dean Stanton prendre son téléphone pour raconter un souvenir à un ami pour que les images de Paris, Texas viennent se superposer à la scène… Refusant de faire vibrer les cordes de la nostalgie tout en assumant ses résonances, le premier long métrage de l’acteur John Carroll Lynch partage avec le spectateur une connivence communicative. À ce titre, la présence au casting de David Lynch (et de sa tortue) ne semble évidemment pas due au hasard.
Bien que remis de sa chute, Lucky ne s’encombre d’aucune illusion, il sait qu’il n’en a plus pour bien longtemps. Et, pour lui qui affirme ne pas croire en l’âme, il n’y a rien à espérer de plus que la vie présente. Tout passe, tout est éphémère, comme il l’affirme, et il vaut mieux sourire que se lamenter. C’est ce que l’on retient de cet homme : son sourire, c’est la réponse qu’il a trouvée à sa question du sens de sa vie. Que l’on partage ou non son scepticisme, ce qui compte, c’est qu’on a affaire à un très beau personnage d’homme qui approfondit sa quête en s’ouvrant au partage avec ceux qui l’entourent.
Février 2018 Jean-Claude Faivre d’Arcier
Durant la guerre 14-18, les femmes ont pris le flambeau
LES GARDIENNES
Film français de Xavier BEAUVOIS – 2017
 Pendant la Première Guerre Mondiale, les hommes ont quitté les villages pour le front. Les femmes reprennent le flambeau comme Hortense, travailleuse infatigable, qui embauche Francine, une jeune femme de l’Assistance Publique, chargée de la seconder à la ferme. Sa propre fille Solange rechigne aux travaux des champs. Entre Hortense et Francine, un respect et une reconnaissance mutuels s’établissent d’emblée. D’ailleurs, après la guerre, Hortense aimerait garder la jeune femme auprès d’elle. Quand Georges, un des fils d’Hortense, revient lors d’une permission, il tombe sous le charme de Francine. Alors que leur histoire commence, il doit repartir à la guerre…
Pendant la Première Guerre Mondiale, les hommes ont quitté les villages pour le front. Les femmes reprennent le flambeau comme Hortense, travailleuse infatigable, qui embauche Francine, une jeune femme de l’Assistance Publique, chargée de la seconder à la ferme. Sa propre fille Solange rechigne aux travaux des champs. Entre Hortense et Francine, un respect et une reconnaissance mutuels s’établissent d’emblée. D’ailleurs, après la guerre, Hortense aimerait garder la jeune femme auprès d’elle. Quand Georges, un des fils d’Hortense, revient lors d’une permission, il tombe sous le charme de Francine. Alors que leur histoire commence, il doit repartir à la guerre…
Au Paridier, Hortense (Nathalie Baye) et sa fille Solange (Laura Smet) labourent les champs, veillent aux récoltes, tiennent les comptes. Elles s’occupent de la ferme pendant que père, frères et maris se battent dans les tranchées. Nous sommes en 1915 : voilà un an que la guerre a éclaté, et aucune issue proche ne se laisse entrevoir.
Lorsqu’il découvre le roman éponyme d’Ernest Perochon, par l’intermédiaire de la productrice Sylvie Pialat, le cinéaste Xavier est séduit par cette histoire de femmes qui luttent, seules, pour faire prospérer la terre…
Les deux fils d’Hortense, Constant (Nicolas Giraud) et Georges (Cyril Descours), ainsi que le mari de Solange, sont au combat. A l’image de toutes les autres femmes, mère et fille sont dans l’attente. L’attente d’une rare visite en permission, ou de l’annonce d’un nom qui viendra s’ajouter à la longue liste des
morts.
C’est sur cette image de mort que Xavier Beauvois ouvre son récit. A l’inverse des films mettant en scène les hommes ‘’faisant’’ la guerre, l’image est ici immobile, comme une nature morte. Les soldats sont allongés au sol, inertes, dans la boue et le brouillard, ‘’pour raconter en un plan la boucherie de la Grande Guerre’’, explique le cinéaste. Mis à part le cauchemar d’un soldat en permission, le réalisateur ne fera pas d’autre incursion sur le front. L’histoire se concentre sur ces ‘’gardiennes’’, qui assument en silence l’effort de guerre. Afin de les aider dans leur labeur, Hortense décide d’engager une jeune fille de l’assistance publique, Francine (Iris Bry). ‘’Les gens de cette époque vivaient complètement avec la nature. Ils se levaient avec le soleil et se couchaient une fois la nuit tombée. Il y avait un respect de la terre’’, commente le cinéaste. Malgré la lutte quotidienne, les paysannes évoluent en osmose avec la nature qui les entoure, filmée dans toute sa splendeur par Caroline Champetier, directrice de la photographie. A voir cette entente avec la terre, on pense au magnifique Sunset Song du Britannique Terence Davies, qui traite de la même période historique, mais dans les landes écossaises. Les promenades dans les bois de Francine, son amour pur et franc, rappellent le Tess de Roman Polanski.
Mais c’est au western que X. Beauvois se réfère en parlant de ses héroïnes : ‘’Au lieu d’avoir des cow-boys, on a des cow-girls. J’adore les westerns de John Ford.’’ Rio Bravo est un de mes films préférés. Hortense occupe le rôle phare du cow-boy menant son troupeau à bonne destination. ‘’Hortense est faible et forte à la fois. Elle fait de grands efforts pour tenir tout ça et elle se transforme progressivement’’. Nathalie Baye, actrice principale du cinéma de Beauvois (Selon Matthieu, Le Petit Lieutenant), incarne cette chef de famille, habitée par une angoisse silencieuse. ‘’Avec elle, on ne peut pas appeler ça du travail ; c’est vraiment du plaisir ! Elle est intelligente, elle est arrivée en ayant bien réfléchi au personnage. Au début, elle a eu un peu peur parce que j’ai coupé beaucoup de dialogues. Ces gens-là sont des taiseux’’. L’actrice incarne avec finesse ce personnage complexe, qui vacille au gré des épreuves mais résiste, portant sur ses frêles épaules le lourd poids de la destinée familiale.
L’autre forte influence évoquée par X. Beauvois est celle des Parapluies de Cherbourg. ‘’J’adore Jacques Demy. Pour moi, c’est le cinéaste français qui a pris le plus de risques. C’est un très beau film qui montre ce qui se passe à l’arrière pendant la guerre d’Algérie, ce qu’on voit rarement. Une lettre du Guy des Parapluies parle d’attentat à la grenade et, quand il revient, il est devenu irritable et alcoolique. Le traumatisme de la guerre transparaît dans Les Gardiennes, lors d’un retour en permission de Georges, hanté par l’horreur qu’il a vécu dans les tranchées. Mais, comme Demy vivait l’attente avec son héroïne Geneviève, Beauvois fait de la jeune Francine son personnage principal et pose sur elle un regard d’une grande douceur. Digne héritière des héroïnes romantiques, Francine croit trouver au Paridier un amour familial qu’elle n’a jamais connu. Les scènes les plus lyriques lui sont consacrées et la musique de Michel Legrand vient rompre le silence de la ferme et les bruits des champs… avant que la vie de cette petite communauté et la guerre ne viennent mettre fin au conte de fées.
Pour les Parapluies de Cherbourg, J. Demy avait trouvé son héroïne dans la beauté de madone d’une jeune actrice alors inconnue, Catherine Deneuve. Xavier Beauvois a trouvé la sienne dans les traits lumineux d’Iris Bry, repérée par hasard dans une librairie. ‘’La caméra est amoureuse de cette fille, c’est magique. Iris n’avait jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma et se retrouve avec ce rôle qu’elle interprète magnifiquement. Ca, c’est un vrai conte de fées’’.
D’un film sur les douleurs muettes d’une guerre, Les gardiennes passe à la difficulté de revenir aux valeurs d’une époque révolue. Le vieux monde dans lequel Hortense aspire à retourner n’est plus compatible avec la liberté que Francine veut continuer à vivre. Le son des canons s’est tu, mais celui du duel entre ces deux femmes protégeant férocement leurs acquis peut se mettre à gronder. Et la fresque de Xavier Beauvois s’ouvre sur un autre champ de bataille, tout aussi dévasté…
JANVIER 2018 Jn-C Faivre D’Arcier
